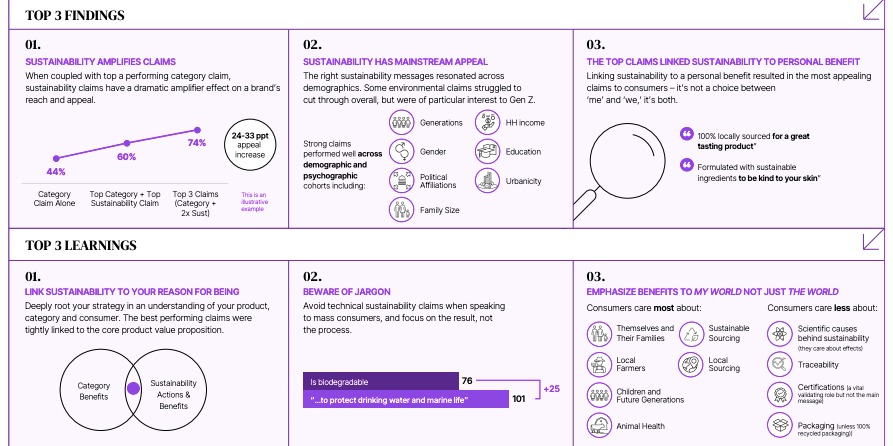La SNCF prévoit un milliard d’euros pour produire de l’énergie solaire
La SNCF a longtemps possédé des barrages, elle va se mettre au photovoltaïque. L'entreprise publique a annoncé ce jeudi la création d'une nouvelle filiale, baptisée « SNCF Renouvelables », destinée à la production d'énergie solaire pour couvrir une partie de ses besoins en électricité. Elle compte pour cela s'appuyer sur les ressources de son immense patrimoine foncier, qui comprend 12 millions de mètres carrés de bâti et plus de 100.000 hectares. Le groupe a déjà identifié plus de 1.000 hectares « éligibles à l'installation de panneaux photovoltaïques ». « L'équivalent d'un gros réacteur nucléaire » L'objectif est d'installer, sur ces 1.000 hectares, une capacité de 1.000 MWc (Mégawatts-crête) d'ici à 2030, « soit l'équivalent d'un gros réacteur nucléaire », a affirmé le président du groupe ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, lors d'une conférence de presse. « C'est la production du leader actuel de l'énergie solaire », a-t-il rajouté sans le nommer. De quoi permettre à l'entreprise d'assumer elle-même une part de ses besoins en électricité, qui sont énormes. La SNCF est, en effet, le premier client industriel d'EDF, avec une consommation annuelle de 9 TWh, dont 8 pour assurer la circulation des trains. Ce qui a créé une grosse angoisse chez les financiers du groupe lorsque les prix ont explosé l'an dernier, augmentant de 700 millions d'euros sur un an la facture pour l'énergie de traction. LIRE AUSSI : Train, autocars, covoiturage… vers un été record pour les transports longue distance La SNCF veut prolonger la durée de vie de ses TGV Avec ces 1.000 hectares de panneaux solaires, le groupe affirme qu'il sera capable de produire, en moyenne annuelle, l'équivalent de 15 à 20 % de ses besoins actuels en électricité. Seule une part servira à de l'autoconsommation : la production du solaire atteint son maximum en milieu de journée, alors que les pics de besoins du ferroviaire se trouvent au début et en fin de journée.