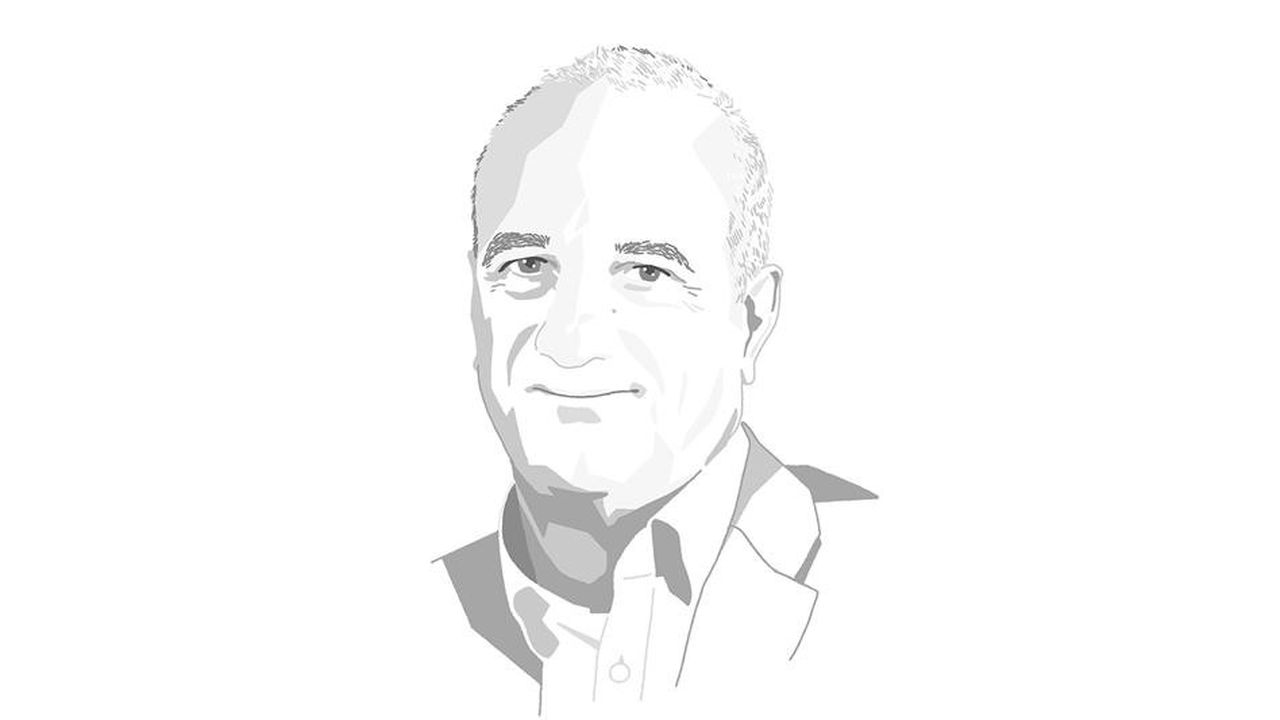Usbek & Rica – L’IA pourrait entraîner une hausse de 80 % des émissions mondiales de CO2
« L’IA aura un rôle vraiment majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. » Voilà ce que promettait Kate Brandt, responsable du développement durable chez Google, dans un communiqué publié en décembre dernier. Projections chiffrées à l’appui, le géant américain tablait alors sur une baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 10 % grâce aux « progrès » liés au développement des intelligences artificielles. Optimiste ? C’est peu de le dire. A rebours de ces prévisions enthousiastes, un rapport publié début mars par une coalition de plusieurs associations environnementales, dont Greenpeace et Les Amis de la Terre, met en garde contre les « dangers de l’IA qui pèsent sur le climat ». Parmi les scénarios envisagés : si le secteur « multiplie par deux le nombre de data centers » nécessaires à sa production « tout en améliorant de 10 % son efficacité énergétique » globale, il en résultera une hausse d’environ 80 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) dans les prochaines années. « Battage médiatique » Comme le souligne The Guardian, le principal facteur de cette hausse est simple : qui dit sophistication exponentielle des IA dit aussi demande exponentielle en énergie. « L’impact carbone d’une intelligence artificielle englobe les émissions associées au cycle de vie du matériel sur lequel son modèle algorithmique est exécuté – des matériaux extraits à leur transport, en passant par l’énergie nécessaire au fonctionnement du modèle – ainsi que la phase d’entraînement du modèle, responsable de la majeure partie des émissions et plus énergivore que l’inférence », nous expliquait en avril 2023 Priya Donti, directrice exécutive de l’association Climate Change AI et spécialiste de l’apprentissage automatique. Selon plusieurs études, la génération de requêtes via l’IA nécessite ainsi jusqu’à 10 fois plus de puissance qu’une recherche en ligne classique. À elle seule, la célèbre ChatGPT consommerait autant d’énergie que 120 foyers américains sur une année. Or qui dit production d’électricité dit potentiellement énergies fossiles – à l’exception notable de la France, où l’essentiel du mix provient du nucléaire. Résultat, « d’ici seulement trois ans, les serveurs des IA pourraient consommer autant d’énergie que la Suède », selon une étude publiée dans la revue scientifique Joule en octobre dernier. « On entend tout le temps dire que l’IA pourrait sauver la planète, mais il n’y a aucune raison de croire à ce battage médiatique », décrypte dans les colonnes du Guardian Michael Khoo, l’un des membres des Amis de la Terre ayant participé à la rédaction du rapport, qui reconnaît seulement « des légers gains d’efficacité ». Et de renchérir : « Dans les années à venir, les gens seront indignés de voir combien d’énergie sera consommée par l’IA, ainsi que de voir à quel point elle nous inondera de désinformation. » Risque de désinformation Car c’est là l’autre principal enseignement du rapport : pour ses auteurs, l’IA générative rendra bientôt la production de campagnes de désinformation sur le climat « plus faciles, plus rapides et moins coûteuses, tout en leur permettant de se propager plus loin et plus rapidement ». En guise d’exemple, l’étude cite notamment cette fausse information largement diffusée sur les réseaux sociaux et les médias américains en 2023, selon laquelle des morts de baleines, échouées sur la côte Est des Etats-Unis, auraient été provoquées par des projets éoliens offshore. « L’IA est l’outil idéal pour inonder les réseaux de ce genre de conneries produites rapidement et à moindre coût », assène Michael Khoo. « Ces technologies devraient être déployées dans le cadre d’un ordre économique et social très différent du nôtre » Naomi Klein, essayiste Partager sur Twitter Partager sur Facebook De fait, ce rapport n’est pas le premier à tirer la sonnette d’alarme, loin s’en faut. En décembre 2023, une étude menée par la start-up Hugging Face et des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie avait démontré que générer 1 000 images avec un modèle d’IA puissant tel que Stable Diffusion XL rejette autant de CO2 que de rouler sur 6,6 kilomètres avec une voiture à essence de taille moyenne. Quelques mois plus tôt, l’essayiste Naomi Klein plaidait pour une régulation stricte du secteur, au service d’une économie fondée sur le bien-commun. On lui laissera l’honneur de la conclusion : « Il existe un monde dans lequel l’IA générative, en tant que puissant outil de recherche prédictive et d’exécution de tâches fastidieuses, pourrait en effet être mise au service de l’humanité, des autres espèces et de notre maison commune. Mais pour que cela se produise, ces technologies devraient être déployées dans le cadre d’un ordre économique et social très différent du nôtre, un ordre dont l’objectif serait de répondre aux besoins humains et de protéger les systèmes planétaires. »