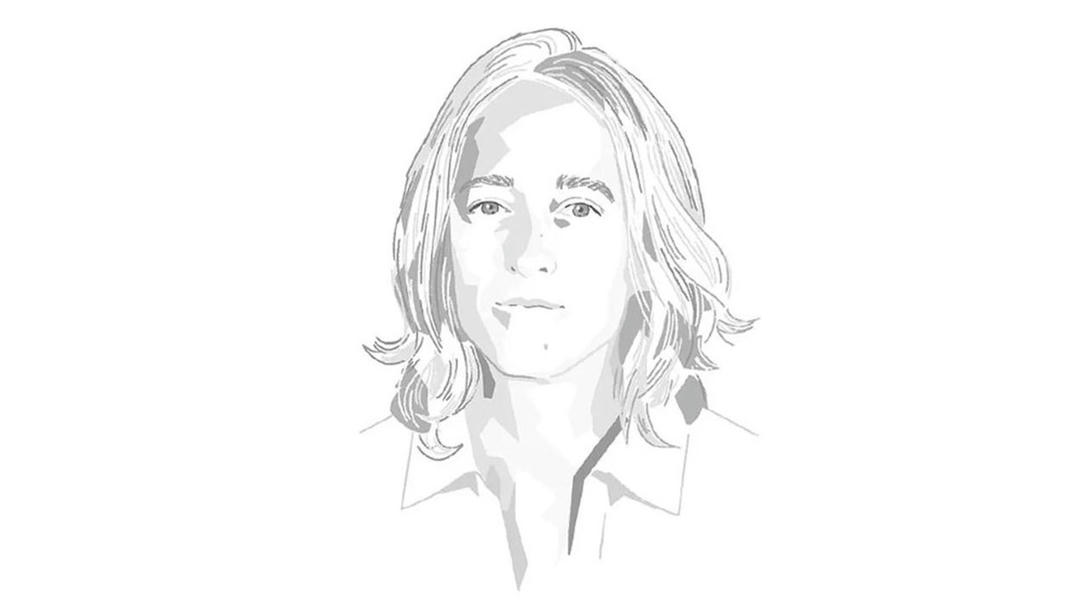Agriculture : cessons d’opposer bio et productif
Parmi les crises qui se succèdent à un rythme épuisant dans notre pays, il faut de temps en temps ouvrir l'oeil en quête de bonnes nouvelles. Les promeneurs remarquent ainsi depuis quelques semaines le renouveau des coquelicots dans les champs de blé et en bordure de route. A une époque où tout se comptabilise, cette rumeur reste délicieusement imprécise, mais suffisamment colportée par la presse régionale, et attestée par nos propres yeux, pour que l'on puisse y accorder foi. Plutôt que d'ennuyantes étendues d'un jaune monochrome, nous retrouvons dans nos campagnes des tableaux pointillistes, semblables à ceux des gravures anciennes. Dans « Les Très Riches Heures du duc de Berry » par exemple, célèbre manuscrit enluminé du XVe siècle qui décrit les travaux agricoles au cours de l'année, on peut voir au mois de juin, en arrière-plan d'une scène de tonte des moutons, un champ d'épis parsemé de coquelicots et de bleuets. Il n'y a pas de raison de penser que nos ancêtres étaient moins sensibles que nous à l'esthétique des paysages agricoles. Un motif de réjouissance Cette réapparition inattendue représente incontestablement un motif de réjouissance. Pour les pollinisateurs qui reviennent butiner. Pour la biodiversité, puisque le coquelicot offre le gîte à certains insectes, que ses graines nourrissent les oiseaux, et que ses débris organiques enrichissent le sol. Et pour nos esprits tourmentés qui ont bien besoin de profiter d'un peu de beauté gratuite. Nous sommes tous comme Proust : le coquelicot nous fait battre le coeur. Voici ce qu'en dit le narrateur de « La Recherche » à Combray : « La vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le coeur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s'écrie, avant de l'avoir encore vue : La Mer ! » Quant aux agriculteurs, leurs rendements ne devraient pas trop en pâtir (même si la question fait toujours débat). LIRE AUSSI : Agriculture bio : l'Etat débloque une « enveloppe de crise » de 60 millions d'euros Agriculture : les trois drames du bio selon la Cour des comptes Les coquelicots se font remarquer depuis déjà quelques années. Les botanistes expliquent ce phénomène principalement par la transformation des pratiques agricoles. Les cultivateurs utilisent davantage de fumier et, réglementation aidant, moins de pesticides. Et les surfaces cultivées en bio ne cessent d'augmenter, malgré la crise qui traverse actuellement le secteur. Selon les derniers chiffres fournis par le ministère de l'Agriculture, plus de 14 % des fermes françaises sont désormais converties en bio, pour une surface totale de près de 3 millions d'hectares. Une évolution substantielle dont les effets positifs se constatent dorénavant à l'oeil nu. Une nécessité environnementale La nature n'est donc pas rancunière : il suffit de la laisser en paix un moment pour qu'elle retrouve sa forme. On estime par exemple à cinq ans le temps nécessaire au retour des vers de terre dans un sol pollué. Les images de Tchernobyl, ville fantôme devenue en trente ans une luxuriante forêt primaire peuplée d'espèces sauvages, présentent une illustration extrême de cette reconquête. Voilà qui devrait nous encourager à poursuivre à bon train la transition vers une agriculture qu'il faut cesser d'appeler « bio », en réservant plutôt à l'agriculture conventionnelle le label de « chimique ». C'est une nécessité environnementale, vitale, et aussi légale : le tribunal administratif de Paris a récemment condamné l'Etat pour le préjudice écologique lié à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, en lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires d'ici à un an. Pour réussir cette transition et en convaincre agriculteurs comme consommateurs, cessons tout d'abord d'opposer le « naturel » au « productif ». Les maraîchers de Paris avaient développé au XIXe siècle, pour nourrir la capitale, des méthodes parmi les plus productives de l'histoire agronomique, encore étudiées aujourd'hui. On vante désormais les fermes « bio-intensives », comme celle du Bec-Hellouin, dont le modèle fut validé il y a quelques années par une célèbre étude de l'Inrae. Rien n'est plus productif qu'un sol vivant. Encore faut-il des bras pour l'entretenir et en prendre soin. A l'échelle de la France, des centaines de milliers de bras, d'autant que la moitié des exploitants actuels vont prendre leur retraite d'ici à 2030.
Le gouvernement lève le voile sur les milliards d’euros derrière sa stratégie écologique
Sept milliards d'euros d'argent frais en plus de la part de l'Etat dès l'an prochain. La Première ministre a finalement placé un chiffre face au nerf de la guerre de la transition écologique, son financement. Elle en avait fait l'annonce dans une interview au « Parisien » le week-end dernier, mais sans développer. Elle a levé un peu plus le voile ce mercredi. Alors que la présentation du grand plan du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays a de nouveau été repoussée « à l'été », Elisabeth Borne, qui avait fait un point d'étape en mai , s'est résolue à livrer quelques détails supplémentaires à l'occasion d'un Conseil national de la transition écologique (CNTE), instance de dialogue qui regroupe des représentants de syndicats, d'organisations patronales, d'ONG, de collectivités et des parlementaires, orchestré par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Et d'assurer d'abord que cette hausse de crédits allait permettre « d'accélérer dans tous les domaines ». 4 milliards pour MaPrimRenov' L'argent sera donc fléché à la fois vers la rénovation thermique des bâtiments, la décarbonation des transports, le développement des énergies renouvelables, la transition agricole, ainsi que vers la gestion des forêts et de l'eau et la préservation de la biodiversité. Pour connaître l'affectation et les montants précis de ces moyens supplémentaires, il faudra toutefois patienter jusqu'au projet de loi de finances pour 2024. Mais le gouvernement promet déjà de porter le budget de MaPrimRenov' de 2,4 à 4 milliards d'euros. Une hausse « sans précédent », a souligné la cheffe du gouvernement, qui a également annoncé une hausse de 1 milliard d'euros (+25 %) des moyens de l'Etat dans les infrastructures de transport. En parallèle, 264 millions d'euros de crédits supplémentaires seront consacrés à la biodiversité. LIRE AUSSI : PORTRAIT - Antoine Pellion, chef d'orchestre de la planification écologique L'Etat ne sera pas le seul à mettre la main à la poche. Ces 7 milliards, qui représentent une hausse des crédits « de près d'un tiers » devraient générer des investissements additionnels des collectivités, de la Caisse des dépôts, des entreprises et des ménages. « L'objectif est que ces 7 milliards permettent de mobiliser autour d'une vingtaine de milliards d'argent public supplémentaires, et que ces 20 milliards génèrent eux-mêmes environ trois fois plus d'investissements dans l'économie », explique l'eurodéputé (Renew) Pascal Canfin. Au total, quelque 60 milliards d'euros, en ligne donc avec les recommandations du rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz , a tenu à souligner la Première ministre. LIRE AUSSI : Transition écologique : les transports, le bâtiment et l'industrie concentreront deux tiers des efforts Il faut une « logique » dans le fléchage de l'argent public, a fait entendre la directrice des programmes de Réseau action climat, Anne Bringault. « Ce qui est rentable le plus rapidement peut être fait par des acteurs privés. L'argent public doit aller là où la rentabilité est très lente, dans les passoires thermiques ou les transports publics », souligne-t-elle. Taxe sur les billets d'avion Plusieurs options existent pour financer les 7 milliards, mais là encore, le curseur n'est pas arrêté. Une partie devrait venir du redéploiement de crédits, lié aux économies que peuvent réaliser d'autres ministères ( réclamées par Matignon en avril ). Une autre au « verdissement » du système fiscal, avec une baisse des niches fiscales brunes d'un côté et des recettes additionnelles de l'autre. Cet hiver, Elisabeth Borne avait ainsi évoqué une hausse de la taxe sur les billets d'avion pour financer les infrastructures de transport. La question est loin d'être tranchée, mais Pascal Canfin défend également des mesures de justice fiscale climatique afin « d'envoyer un signal nécessaire pour dire que l'effort est juste, sans pour autant remettre en cause la politique de l'offre ». LIRE AUSSI : Taxe sur le patrimoine, dette : les pistes pour financer la transition climatique A l'Institut de l'économie pour le climat-I4CE, on salue « un effort inédit sur un seul exercice budgétaire ». « Néanmoins, on sait que cette hausse de 7 milliards ne sera pas suffisante et qu'il va falloir l'augmenter encore dans les années qui viennent », prévient le directeur adjoint du think tank Damien Demailly, qui note au passage que « la concrétisation de la feuille de route gouvernementale repose très largement sur les collectivités ». Ce mercredi, Elisabeth Borne a promis de définir une trajectoire de financement de la transition écologique sur plusieurs années. « Une excellente nouvelle » pour Damien Demailly. Reste à voir, dit-il, si elle figurera dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) ou dans celle consacrée à l'énergie et au climat.
Train : l’Espagnol Renfe se lance à grande vitesse entre Lyon et Barcelone
La grande vitesse espagnole se lance sur les rails français. Le premier train de l'opérateur Renfe commence à circuler ce jeudi 13 juillet, entre Lyon et Barcelone, et reliera les deux villes en cinq heures. C'est la première aventure internationale en solo pour la compagnie espagnole, qui devient ainsi le deuxième acteur à profiter de la libéralisation du rail français pour entrer en concurrence avec la SNCF, après Trenitalia, qui a lancé en 2021 ses trains Frecciarossa sur Paris-Lyon et Paris-Turin-Milan. Une liaison par jour Pour sa part, Renfe a choisi d'opérer en France en utilisant comme marque commerciale AVE, le nom de son train à grande vitesse, déjà connu des touristes qui ont voyagé à bord en Espagne. Dans un premier temps, une liaison par jour dans chaque sens est prévue, entre Lyon et Barcelone, les vendredis, samedis, dimanches et lundis, durant les mois d'été, avant d'adopter un rythme de circulation quotidienne à partir du 1er septembre. Dans la foulée, la connexion Madrid-Barcelone-Marseille en huit heures, sera inaugurée le 28 juillet, sur quatre jours par semaine également en été, puis sept jours sur sept après le 1er octobre. A partir de cette date, la compagnie espagnole maintiendra au total 28 circulations hebdomadaires entre les deux pays, soit une offre de 9.716 places par semaine.
L’odeur des mains peut révéler le sexe d’une personne
Dans La vie des formes, le philosophe et historien Henri Focillon écrit : "la main est action : elle prend, elle crée, et parfois, on dirait qu’elle pense". En effet, dès la naissance, la main nous permet de découvrir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Par la suite, nous les utilisons quotidiennement, pour écrire sur un clavier, utiliser des couverts, s'agripper à une barre de métro, jouer au basket, tenir son téléphone portable ou encore inconsciemment dans le langage non verbal. C'est pourquoi, pour la photographe Tim Booth, dans un article publié dans BBC, les mains révèlent la personnalité et l'histoire d'une personne. Une récente étude menée par Kenneth Furton, le directeur scientifique de la Florida International University, et publiée le 5 juillet 2023 dans la revue en libre accès Plos One, des chercheurs ont découvert que l’odeur des mains pourraient même révéler le sexe d’une personne. Le sexe est à différencier du genre. D’après la sociologue Ann Oakley dans Genre et société, le sexe renvoie à la distinction biologique entre mâles et femelles, tandis que le genre renvoie à la distinction culturelle entre les rôles sociaux, les attributs et les identités psychologiques des hommes et des femmes. La présente étude ne fait pas une évocation au genre. Un taux de précision de 96,7 % Les chercheurs ont utilisé une technique d'analyse appelée spectrométrie de masse pour examiner les composés odorants volatils présents sur les paumes de 60 individus, répartis à parts égales entre hommes et femmes. Les participants de l’étude étaient en majorité d'origine afro-américaine, hispanique et caucasienne, âgés de 18 à 46 ans. Cette technique a été réalisée à l’aide d’un spectromètre de masse qui détecte et identifie des molécules d’intérêt par mesure de leur masse, puis caractérise leur structure chimique.
Morphobot, huit robots en un seul
Les quatre roues du Morphobot peuvent pivoter à l'horizontale pour se transformer en quatre rotors. E. SIHITE ET AL., NATURE COMMUNICATIONS Il sait tout faire, ou presque. Voler, rouler, ramper, marcher sur quatre pattes ou se tenir debout sur deux. Appelé M4, ou Multi-Modal Mobility Morphobot, ce robot est un projet du Centre pour les systèmes et technologies autonomes, un laboratoire du California Institute of Technology (CalTech), aux Etats-Unis. Son principe-clef réside dans sa capacité à se transformer pour changer de comportement de locomotion, sans ajout ni suppression d’accessoires ou de composants. Un drone quadricoptère en fibre de carbone Le projet a été présenté dans la revue Nature Communications fin juin 2023. Au total, il peut adopter huit comportements différents, traverser des terrains pleins d’obstacles ou négocier des pentes à 45 degrés. Concrètement, l’engin se présente comme un drone quadricoptère en fibre de carbone pesant 5,6 kg au concept très familier. Mais les quatre rotors de 25 cm de diamètre peuvent pivoter et se rabattre à la verticale, donnant alors au robot l’apparence et les facultés d’un petit véhicule à quatre roues. Le Morphobot peut se redresser pour se tenir sur deux roues seulement S’il s’avère trop haut pour passer sous un obstacle, les quatre roues peuvent pivoter en avant et en arrière pour abaisser la taille du robot. Selon les situations, ces roues peuvent non plus servir à rouler, justement, mais à imiter des pattes sur lesquels la machine prend appui. Ou encore, le Morphobot peut se redresser pour se tenir sur deux roues seulement, soit totalement droit (il mesure alors 1 mètre de haut) soit en restant incliné le temps de passer un obstacle au sol. Dans ces deux cas de figure, les deux autres roues redeviennent des rotors qui maintiennent l’équilibre de la structure. PUBLICITÉ C’est le M4 qui détermine le comportement à adopter en fonction du terrain. Incapable de flotter, il se met en mode drone volant pour passer une pièce d’eau par exemple. Il est doté d’un ordinateur de bord, de capteurs, dont des caméras et une centrale à inertie pour le calcul de l’orientation, et d’un système de communication Wifi. Le robot est en effet contact avec des ordinateurs externes qui lui envoient des informations. LIRE AUSSIUN ROBOT CAPABLE D'IMITER L'ABEILLE À LA PERFECTION Car il n’est pas forcément en pilotage autonome : pour le test, visible dans la vidéo de démonstration, où il franchit en volant une pièce d’eau, l’engin est commandé à distance par un opérateur. Dans d’autres situations, un dispositif de capture de mouvement lui transmet les données sur sa position dans l'espace pour l’aider à se piloter tout seul. Le comportement de marche, lui, est encore rustre et nécessite d'être fluidifié mais sa faisabilité est démontrée. Pour l’équipe, ce projet a des usages évidents en matière de secours lors de catastrophes occasionnant des bouleversements du terrain (séismes, inondations, éboulements …) et des dommages sur le réseau routier. Au lieu de dépêcher plusieurs robots pour explorer les lieux d’un sinistre, un nombre réduit pourrait remplir l’ensemble des missions.
Thomas Buberl, la grande transformation
Il s'est levé à 5 h 15 du matin pour monter son cheval Folgoët, mais lorsqu'on le rencontre quatre heures plus tard dans la tour AXA de la Défense, il a l'air frais comme un gardon. Thomas Buberl, le patron du géant de l'assurance, est encore galvanisé par les trois jours qu'il vient de passer avec les 300 leaders de son groupe à Samoëns, dans les Alpes. L'échange avec ses troupes est sans doute la clef du management de cet ovni du capitalisme français, dont il est devenu un pilier malgré ses origines allemandes. « Il faut avoir des équipes dans lesquelles la confiance est totale et qui ont envie de travailler ensemble pour que le directeur général puisse jouer son rôle de chef d'orchestre. On est beaucoup plus dans l'empathie que dans le 'Je sais tout, je fais tout et je décide tout.' » Il appelle cela « l'empowerment », un concept pas facilement traduisible qui signifie donner le pouvoir aux troupes. « J'ai appris cela grâce à l'équitation. Si vous voulez sauter ou franchir des obstacles, il faut relâcher les rênes plutôt que tirer dessus. Sinon, le cheval se crispe. Mais c'est très contre-intuitif », dit le patron de 50 ans. Tous ceux qui faisaient partie de l'équipe de son prédécesseur, Henri de Castries, n'ont pas adhéré. Certains, qui soutenaient plutôt son concurrent Nicolas Moreau, ont quitté le navire avec fracas avant même sa prise des commandes, en septembre 2016. Et sur la durée, tout le monde n'a pas l'air de suivre le rythme non plus : le patron a modifié plusieurs fois son état-major en sept ans. « Payer to partner » Mais la méthode semble porter ses fruits : après un passage à vide durant le Covid, AXA a renoué avec les sommets en Bourse, même si le groupe vaut encore 24 milliards d'euros de moins que son grand rival allemand, Allianz, valorisé 86 milliards. Au-delà de la méthode, cette réussite repose d'abord sur la stratégie définie par Thomas Buberl dès son arrivée. Pour lui, l'assureur ne doit pas seulement « payer les factures », mais accompagner ses clients s'il veut se différencier des nouveaux concurrents issus notamment du numérique. Un vrai changement de rôle « payer to partner », aime à résumer l'ancien consultant au BCG. Surtout, il veut réduire massivement le risque financier d'AXA, en réduisant le poids de l'assurance-vie, et augmenter à l'inverse l'exposition au risque dit technique, c'est-à-dire la couverture des dommages. Mais ce qui semble limpide en théorie doit être mis en pratique. Thomas Buberl commence par céder progressivement Life Equitable, la prestigieuse filiale américaine. Son plus gros coup sera l'acquisition de XL Groupe, en mars 2018. Sur le papier, celle-ci répond à la stratégie : XL est le leader mondial de l'assurance des grands risques industriels.
Innovation et ruralité : le match prometteur pour le développement du tourisme durable en France
Véritable clé de l’économie française depuis de nombreuses décennies, le tourisme a basé ses innovations sur les méthodes traditionnelles de développement économique. Une approche qui présente les territoires comme des réserves statiques de ressources naturelles, humaines ou culturelles, destinées à être exploitées, et qui a provoqué un grand nombre d’impacts négatifs sur l’environnement et les populations locales. Le développement du tourisme durable étant devenu une priorité pour préserver les richesses naturelles et culturelles du pays, la ruralité apparaît alors comme un potentiel levier pour aligner l’innovation sectorielle sur les enjeux actuels. Entre changement sur l’approche de l’innovation, les nouvelles attentes du marché et les initiatives du gouvernement, nous allons voir comment la ruralité et l’innovation forment une alliance prometteuse. Le développement territorial et touristique doit s’adapter au contexte rural La dégradation des conditions environnementales et sociales en dépit d’une croissance fulgurante dans le secteur du tourisme a considérablement renforcé le déséquilibre territorial de la France. Notamment par la vision d’un développement économique envisagé au prisme des secteurs d’activité, des filières économiques, des équipements ou des infrastructures, qui sont peu adaptés aux territoires de faible densité. Une étude conduite par la Caisse des dépôts a par ailleurs pointé du doigt l’inadéquation des outils classiques du développement territorial à des contextes ruraux. Il en est de même concernant l’approche métropolitaine de l’innovation, centrée sur les questions technologiques, de concentration des talents et d’équipements. Une lecture « technicisée » de l’innovation, adoptée par les principaux acteurs (les clusters, les technopoles et les districts technologiques) ne permettant pas de prendre en compte la complexité des interactions entre les différents acteurs et les ressources latentes. Il est essentiel d’adopter une définition très ouverte de la notion d’innovation pour observer les besoins et les solutions qui émanent localement des territoires eux-mêmes. Ce qui favorise le développement des différentes facettes de l’innovation, qu’elle soit technologique, socio-économique, culturelle, environnementale ou organisationnelle. Comment repérer les acteurs informels, les idées latentes et les innovations ? Les incubateurs se représentent comme un lieu d’échange et une structure d’innovation permettant l’accompagnement de proximité des acteurs informels qui dynamisent les territoires ruraux, dans la commercialisation, la digitalisation, la communication de leur projet. Pour répondre à son ambition de faire de la France la première destination touristique durable et innovante, France Tourisme Lab a développé 9 structures d’accompagnement. Plusieurs d’entre elles se spécialisent dans les territoires ruraux et jouent un rôle important dans l’émergence de nouvelles formes de tourisme. Grégory Davaillaud, responsable du Slow Tourism Lab, affirme le dynamisme du développement touristique durable des territoires face aux nombreux projets qui se positionnent chaque année pour une demande d’incubation. Mis à part le respect et l’engagement envers les trois piliers du développement durable, qui est assez simple à cerner, étant un incubateur au positionnement fort et porteur de sens, l’accent est mis sur la vraie valeur ajoutée du projet. Une valeur qui se déploie au travers de l’articulation entre les tendances de consommation du marché et l’écosystème local, se différenciant de la concurrence, raconte t-il. “Rendre de l’attractivité à la ruralité de la France” telle est l’ambition du Slow Tourism Lab selon Grégory Davaillaud, voyant de belles perspectives pour la structure. Avec notamment une ouverture vers l’international, aux côtés des territoires de Québec et Montréal, véritables pionniers de l’agritourisme, permettant un échange de vision et d’expertise. Pour le responsable du Slow Tourism Lab, l’un des projets les plus marquants que le Slow Tourism Lab a accompagné jusqu’à présent est Destination parcs 2022 avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Un beau projet toujours en cours de réinvention cette année, qui s’articule autour des formes de tourisme à propulser afin de promouvoir l’attractivité naturelle et culturelle des parcs nationaux de France. L’innovation les yeux rivés sur les zones rurales Longtemps caractérisée par ses activités outdoor, aujourd’hui la campagne possède une image revalorisée, en accord avec les nouvelles demandes du marché. Il s’agit pour les touristes d’un territoire possédant des valeurs, des savoir-faire, des traditions, des paysages et des patrimoines variés, mais également des activités nombreuses qui tendent à évoluer (randonnée, vélo, équitation, voies navigables). Ces territoires deviennent des destinations phares pour les courts séjours, dites micro aventure, aux côtés des séjours insolites et ludiques, renforcés par l’œnotourisme et l’agritourisme. Ces zones rurales représentent 80% du territoire français et 30% des nuitées du secteur, de quoi donner de la matière à la diversification de l’offre grâce à des innovations, à des acteurs et des réseaux locaux. Dans un secteur dans lequel la ruralité se positionne au carrefour des grandes tendances de consommation, les réflexions se rejoignent sur les synergies à développer pour concevoir et maintenir un projet dans une approche durable. La prise en compte de la spécificité territoriale dans son intégralité et l’intégration des acteurs locaux, permettent au tourisme d’innover dans des projets en phase avec le développement local. Les incubateurs dans le tourisme responsable apportent une première grosse pierre à l’édifice, en favorisant l’émergence et le développement d’entreprises et en leur offrant un accompagnement personnalisé et des ressources adaptées à leurs besoins.
Aberration écologique
Les énergies renouvelables restent l'apanage des pays riches. Une absurdité qui doit beaucoup à la frilosité des bailleurs privés, et hypothèque sérieusement nos objectifs climatiques. Lire plus tard Commenter Partager Brésil Environnement Par Lucie Robequain Publié le 6 juil. 2023 à 7:03Mis à jour le 6 juil. 2023 à 7:04 L'Afrique est le continent le plus ensoleillé du monde, et paradoxalement celui qui compte le moins de panneaux photovoltaïques. Elle représente la moitié du potentiel solaire de la planète et seulement 1 % de l'énergie dégagée. Cet écart constitue l'une des grandes aberrations de notre politique environnementale : compte tenu de son potentiel et de sa croissance qui en fera le continent le plus peuplé dans les vingt ans qui viennent, l'Afrique devrait être au coeur de l'action. Pour elle et tout autant pour nous, qui vivons dans l'illusion que les grandes avancées occidentales seront forcément suivies ailleurs. A quoi bon faire tant d'efforts en Europe si nos voisins carburent toujours au charbon ? Le problème est plus largement celui des pays émergents qui concentrent deux tiers de la population mondiale et seulement un cinquième des énergies renouvelables. La situation ne s'améliore pas. Pire, elle se dégrade : les investissements étrangers consentis dans ces pays au titre des renouvelables ont chuté de plus de 10 % l'an dernier. Frilosité financière Les barrières pour les investisseurs sont évidemment nombreuses. L'instabilité politique et réglementaire, la lenteur bureaucratique, la faiblesse du prix de l'électricité et l'absence de subventions découragent nombre d'entre eux de franchir la Méditerranée. Certains pays ont suscité d'immenses espoirs, tels le Sénégal et la Tunisie, avant de se refermer sous la pression des « EDF » locaux qui défendaient leur monopole. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - L'Afrique mise sur les hydrocarbures pour son développement D'autres exemples prouvent néanmoins que cette transition énergétique est possible. Le Brésil et l'Uruguay constituent des modèles du genre : ils ont développé des projets renouvelables représentant l'équivalent de 4 à 5 centrales nucléaires, via des appels d'offres et une mise en concurrence totalement assumée. Idem en Egypte et en Afrique du Sud, qui s'imposent comme les deux « terres promises » africaines. Les fonds publics, qu'ils proviennent de la Banque mondiale, de la BPI ou des agences de développement, ne manquent pas pour réussir cette transition. Les capitaux privés font, en revanche, cruellement défaut. Les banques européennes, et singulièrement les françaises, se sont nettement désengagées d'Afrique - jusqu'à provoquer l'indignation récente d'Emmanuel Macron. Le risque est de rater le « pétrole » du XXIe siècle pour rester concentré sur celui du XXe. Et qu'à force de frilosité financière, on fasse encore chauffer la planète.
La SNCF propose 200.000 billets à tarif réduit sur les Intercités
Le gouvernement fait tout pour convaincre les Français d'opter pour le train cet été. Dernière annonce en date : la mise à disposition pour juillet-août de 200.000 billets à 19 euros pour des trajets en Intercités (les grandes lignes hors TGV de la SNCF). La mesure sera financée par l'Etat, qui subventionne ces trains. Elle a été dévoilée par le ministre des Transports, Clément Beaune, ce vendredi depuis la gare d'Austerlitz où est traditionnellement donné le top départ des vacances d'été. Pour ceux qui n'ont toujours pas fait leur réservation, il faut être rapide : ces billets sont mis en vente dès ce vendredi et jusqu'au samedi 15 juillet seulement, pour des trajets jusqu'au 31 août. Ils concernent les lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore Paris-Briançon en train de nuit. Les Intercités sont, certes, bien plus lents que les TGV, a concédé Clément Beaune, mais ils sont « des trains de vie », « de vraies lignes qu'il faut aujourd'hui réhabiliter », a-t-il expliqué. Et d'après lui, cette « offre populaire » devrait permettre de « diviser par deux » le coût des billets. De quoi faire réfléchir les vacanciers. « Si l'opération marche bien, on continuera », a-t-il même promis. De nombreuses places encore disponibles Cette annonce arrive au moment où le débat sur la cherté du train ressurgit. Un sondage publié en avril montrait que pour deux Français sur cinq, le train était trop cher et que, pour 57 % des sondés, la première mesure à instaurer pour les pousser à prendre davantage ce moyen de transport serait la mise en place de politiques tarifaires plus avantageuses.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.