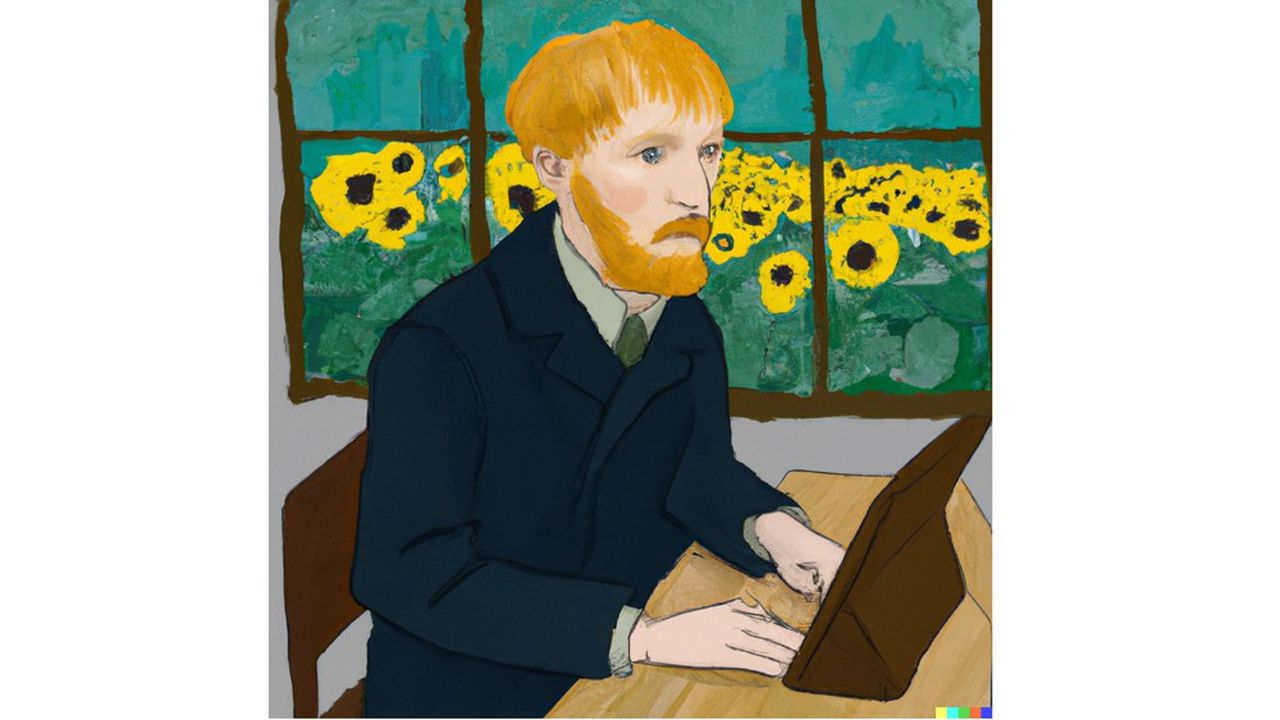Netflix se lance dans le coaching sportif avec Nike
Netflix marche dans les traces de Véronique et Davina. Misant sur les bonnes résolutions de ses abonnés après les fêtes, la plateforme californienne va proposer pour la première fois, à partir de vendredi, une série de programmes d'entraînement sportif, le « Nike Training Club ». Dispensées par une douzaine d'entraîneurs certifiés par Nike, ces sessions, produites à l'origine par l'équipementier américain pour sa propre application de coaching, offriront aux sportifs de tous les niveaux des exercices de fitness d'intensité variée - cardio, renforcement musculaire, etc. - mais aussi de yoga. Cinq premiers programmes, comprenant 46 cours au total pour 30 heures de transpiration, seront proposés, avant une seconde salve plus tard dans l'année qui complétera un catalogue de 90 cours. Elargissement du catalogue Les leçons seront disponibles en 10 langues dans les 190 pays où Netflix est présent. Destinés à être suivis à domicile, ces entraînements ne demanderont généralement aucun équipement. Ces sessions du Nike Training Club visent en effet à « rencontrer les athlètes là où ils sont », indique le communiqué de Nike. En d'autres termes, dans leur salon. Avec cette première incursion dans l'univers du coaching sportif, Netflix enrichit encore sa palette pour continuer à se positionner en acteur généraliste, présent dans tous les genres et s'adressant à tous les publics. La plateforme tente de construire un catalogue varié et complet, pour répondre à toutes sortes d'attentes et de besoins différents, confirme un porte-parole de Netflix en France.
Sept usages de l’intelligence artificielle au service des professionnels des industries créatives
Traducteur, illustrateur, développeur, journaliste, scénariste… Tous ces métiers peuvent déjà s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Tour d'horizon des usages. Traduction Les outils de traduction automatique ont fait beaucoup de progrès. Google Translate et Bing Translator, de Microsoft, proposent ainsi des traductions automatiques assez fiables dans une centaine de langues. Limitée aujourd'hui à 29 langues, leur concurrent Deepl, une société spécialisée allemande, revendique le titre de « traducteur automatique le plus précis et le plus subtil au monde. » Des progrès restent à faire dans les langues moins utilisées. Google a lancé cet automne un nouveau projet appelé « 1.000 Languages Initiative », pour couvrir un millier d'idiomes. De son côté, Meta travaille notamment depuis février sur un système de traduction universel en temps réel, qui fonctionne y compris avec les langues non adossées à un système écrit. Ecriture de textes sous différents formats Le site spécialisé Futurepedia.io référence 186 services différents de génération de texte s'appuyant sur l'IA. Le plus célèbre est ChatGPT, l'interface de dialogue développée par la start-up OpenAI, qui s'appuie sur le puissant réseau de neurone GPT-3.5. D'autres services sont très performants, comme Jasper.ai ou Rytr.me. Récemment mise à disposition du public, ChatGPT permet de produire à la demande tout type de texte - article, communiqué, fiction… -, de résumer des contenus ou de fournir des idées pour un plan. Ses résultats sont bluffants . Mais ses réponses contiennent le plus souvent des erreurs et sont parfois obsolètes, les données de base de l'algorithme s'arrêtant à 2021. Elles peuvent aussi être biaisées. « Cela reste une retranscription assez scolaire de réflexions déjà disponibles sur Internet », ajoute Kati Bremme, la directrice de l'innovation et de la prospective chez France Télévisions. ChatGPT ne peut pas encore rédiger un billet d'humeur à la place de son auteur, le chroniqueur de 01Net et Radio Classique, David Abiker, en a fait l'expérience. « Le dosage, la sensibilité, la mauvaise foi… On ne peut pas déléguer cela à une IA, » témoigne-t-il. Pas question de remplacer les journalistes, donc. Sauf, comme c'est déjà le cas, sur des brèves factuelles automatisables, comme France Télévisions l'a fait avec les résultats des élections régionales. Microsoft génère aussi des textes par l'IA pour les résultats de matchs de NBA. LIRE AUSSI : Intelligence artificielle : les nouveaux métiers clé dans les entreprises Aide au scénario La créativité reste-t-elle l'apanage des humains ? L'IA propose en tout cas aux scénaristes en mal d'inspiration des « intrigues » et autres « histoires créatives », qui font partie des cas d'usage respectivement mis en avant par Rytr.me et Jasper.ai. L'algorithme GPT-3 d'Open AI soutient de son côté le service AI Dungeon, spécialisé dans les univers de science-fiction, sur lequel il suffit de sélectionner un genre (fantasy, apocalypse, zombies etc.), un type de personnage (survivant, soldat ou scientifique) et de taper le nom du personnage principal pour se voir proposer une épopée inédite. « Sur tout ce qui est créatif, le robot peut être assez puissant, car il se nourrit de beaucoup de références », souligne Benoît Raphaël, le fondateur de la newsletter personnalisée par l'IA, Flint. LIRE AUSSI : L'IA, un outil déjà indispensable pour les métiers créatifs Recherche d'information et « fact-checking » A mi-chemin entre Wikipédia et Google, ChatGPT peut jouer le rôle de moteur de recherche. A tel point que Google s'en inquiète. Pour l'instant, cette utilisation reste limitée par le fait que l'algorithme n'est pas à jour des informations postérieures à 2021 et qu'il n'indique pas ses sources. Capables d'analyser automatiquement de grandes quantités d'images et de sons, l'IA peut aussi servir à repérer des « deepfakes », ces vidéos truquées… par l'IA. La cellule de fact-cheking de France Télévisions, « Les Révélateurs », s'appuie ainsi sur l'IA pour vérifier les images et vidéos modifiées ou manipulées. LIRE AUSSI : Reface, la start-up ukrainienne qui a fait sensation à Slush Création d'images Dall-e, développé par Open AI, mais aussi Jasper Art, Midjourney ou Stable diffusion, ces outils conçoivent des images originales à la demande, en entrant comme requête une simple description. « Ils peuvent faire économiser de l'argent à ceux qui passaient par des banques d'images », note Benoît Raphaël. A titre d'expérience, le magazine «T», du journal suisse « Le Temps », a publié cet automne un numéro dont 95 % des visuels ont été créés par des algorithmes. Les images produites par l'IA peuvent aussi servir de source d'inspiration à des illustrateurs par exemple. Ecriture de lignes de code Entraîné sur des milliards de lignes de codes, le système d'Open AI, Codex, maîtrise une douzaine de langues de programmation. Des applications basées sur celui-ci, comme Github Copilot, permettent de générer de codes en tapant des requêtes en anglais. Attention aux bugs, car, comme pour les textes générés par l'IA, les réponses peuvent contenir des erreurs. Les développeurs peuvent donc s'appuyer sur ces outils pour aller plus vite, mais la phase de révision demeure indispensable. Transcription de l'audio vers l'écrit… et inversement Les chaînes européennes du service public européen, rassemblées au sein de l'European Broadcasting Union (EBU), ont lancé une initiative commune, Eurovox, pour capter le son des vidéos et les sous-titrer automatiquement. En France, France Télévisions, qui a testé l'outil sur le direct de France Info, et l'INA l'utilisent pour leur besoin de transcription, à des fins d'accessibilité. De nombreux outils de retranscription à partir d'enregistrements vocaux - réunion, interview… - existent également, comme Otter.ai ou tout simplement Google, qui propose son service « speech to text ». L'IA sait aussi faire l'inverse, et transformer des textes en contenus audio. L'application « La Matinale » du Monde le propose depuis novembre avec le soutien de Microsoft.
Un scandale pour l’environnement : les low cost, grandes gagnantes du rebond du trafic aérien européen en 2022
Si 2022 fut l'année du grand rebond pour le transport aérien, ce fut aussi celle du grand bond en avant pour les compagnies low cost européennes. Celles-ci ont non seulement tiré la reprise, qui a permis au trafic aérien européen de retrouver 83 % de son niveau de 2019, selon Eurocontrol , mais elles ont également fait, pour la première fois, jeu égal avec les compagnies traditionnelles. De janvier à fin novembre, la part de marché des low cost a représenté 32,3 % des vols dans l'espace aérien européen, contre 32,4 % pour les compagnies internationales traditionnelles, selon les dernières statistiques d'Eurocontrol. Le solde étant généré par les compagnies régionales classiques (13,3 %), les vols charters, l'aviation d'affaires et les vols cargo. En 2019, avant la crise, la proportion était de 36 % pour les compagnies traditionnelles, contre 32 % pour les low cost. Les low cost ont renoué avec la croissance Mais le redressement de ces dernières a été beaucoup plus rapide que celles des compagnies internationales dites de « hub », pénalisées par la reprise plus tardive de certains marchés internationaux. Sur l'ensemble de l'année, les low cost européennes ont ainsi retrouvé, en moyenne, 85 % de leur niveau d'activité d'avant- crise, contre 75 % pour les compagnies long-courriers. Encore ne s'agit-il que d'une moyenne. Dans le cas de Ryanair , la première compagnie low cost européenne a déjà renoué avec la croissance en 2022, avec 9 % de vols de plus qu'en 2019 (soit quelque 77.000 vols supplémentaires sur l'année) et 160,4 millions de passagers (contre 148 millions en 2019). Sa rivale d'Europe centrale, Wizz Air, affiche même une progression de 14 %, de même que la turque SunExpress. La britannique Jet2.com est en hausse de 10 %, de même que l'espagnole Volotea . Les compagnies traditionnelles sont distancées En revanche, aucune compagnie traditionnelle n'a encore retrouvé son niveau d'activité d'avant. La plus performante, Turkish Airlines , est encore à 93 % de son niveau de 2019, KLM à 82 % et Air France, à 80 % sur l'ensemble de l'année 2022. Lufthansa et British Airways sont à 71 %. Et si Ryanair et easyJet dominaient déjà le classement des 10 premières compagnies européennes en 2019, Wizz Air et Vueling ont rejoint ce Top 10, respectivement à la 7e et à la 9e place. Selon les données d'Eurocontrol, Wizz Air est désormais dans les talons de KLM, avec 672 vols par jour en moyenne, contre 703 pour la compagnie néerlandaise et Ryanair opère deux fois et demie plus de vols quotidiens qu'Air France (2.536 contre 953).
Selon Amadeus, le métavers va transformer le tourisme –
« La vérité est que le métavers existe déjà depuis quelques années. Mais maintenant qu’il y a plus d’investissements de la part d’autres industries dans ce secteur, ses possibilités vont sans aucun doute s’étendre. », explique Diego Heredia, Head of Corporate Strategic Projects chez Amadeus, dans un article de blog consacré au potentiel du métavers dans le tourisme. Selon lui, le métavers pourrait entraîner une réorganisation d’Internet et des réseaux sociaux, en bousculant les acteurs établis et en influençant notre société de différentes manières : celle dont nous socialisons, celle dont nous faisons nos achats, la manière dont nous travaillons et dont nous collaborons. Il est déjà une réalité pour de nombreux gamers. Par exemple, le jeu World of Warcraft est un monde virtuel persistant dans lequel les joueurs peuvent acheter et vendre des biens entre deux parties. Des concerts virtuels ont également eu lieu dans le jeu Fortnite. Mais il faudra du temps pour que les marques et les utilisateurs s’approprient ces monde virtuels et trouvent des usages pertinents. « Tout comme l’adolescence d’Internet dans les années 90, il faudra peut-être un certain temps pour que le métavers prenne forme, mais ses principales caractéristiques sont déjà là. », écrit Diego Heredia. Sa démocratisation pourrait survenir entre 2026 et 2030, quand les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée seront plus accessibles. Le potentiel du métavers dans le tourisme Pour le Head of Corporate Strategic Projects chez Amadeus, le métavers pourrait compléter, remplacer et/ou ouvrir de nouveaux moyens de profiter de l’expérience du voyage. A court-terme, il peut être intéressant pour inspirer les consommateurs à travers des tours virtuels. A mesure que des progrès, notamment graphiques, voient le jour, il sera possible de proposer des expériences immersives au sein du métavers. « Peut-être qu’un voyage réel en Égypte pourrait être accompagné d’un voyage virtuel dans le temps, à l’apogée de l’ancienne civilisation égyptienne ? Ou pourquoi ne pas réserver un voyage sur la lune ? », s’interroge-t-il. A terme, le métavers pourrait devenir un nouveau canal de distribution proposant des voyages physiques ou mixtes, avec des leviers d’inspiration et de recherche plus personnalisés, grâce à des informations en temps réel et des données enrichies. « Les agents de voyage pourraient interagir en temps réel avec les voyageurs potentiels dans le métavers et avoir un accès direct à leurs commentaires : comme le capitaine à la barre d’un navire, ils pourraient emmener les voyageurs dans différentes villes ou destinations à ce moment précis, pour les inciter à planifier et à réserver l’ensemble du voyage réel dans le métavers. », illustre Diego Heredia. Si on ne peut pas prédire comment et quand va évoluer le métavers, Amadeus affirme que « compte tenu de son énorme potentiel économique, ne rien faire semble être un choix risqué. ».
Le Danemark met les braqueurs de banques au chômage
Le Danemark est devenu le cauchemar des braqueurs de banques, qui ne peuvent même plus travailler décemment. L'an dernier, aucun hold-up n'a été recensé dans le pays, comme l'indique l'agence Bloomberg. Du jamais vu dans l'histoire du grand banditisme danois. En 2021, l'honneur était encore sauf pour la profession avec un braquage tout de même, selon des données de Finans Danmark, le lobby des banques danoises. Rien à voir néanmoins avec les quelque 135 hold-ups encore recensés en 2010. Si les braqueurs ne s'intéressent plus aux banques, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à y voler - même si les professionnels mettent aussi en avant l'amélioration de la sécurité. Avec la concurrence des cartes bancaires et des paiements mobiles, l'usage du cash a en effet fondu ces dernières années au Danemark, de façon encore plus importante qu'ailleurs. LIRE AUSSI : En Suède, la résistance grandit contre la société sans cash Entre 2017 et 2021, la proportion des transactions réalisées en espèces a été divisée par deux, passant de 23 % à 12 %. En valeur, le cash représente seulement 9 % du montant des paiements réalisés, selon des chiffres de la Banque du Danemark. En France, les paiements en cash concernent encore la moitié des transactions en magasin. Les DAB n'intéressent plus les voleurs L'évolution des usages, encore accélérée par la crise du Covid, a poussé les banques à limiter la présence de cash dans leurs agences. Beaucoup n'en proposent même plus au guichet. Seule une vingtaine d'agences dans tout le pays peuvent encore délivrer des espèces. Les Danois peuvent évidemment retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques de billets (DAB), mais là aussi l'offre se raréfie. Résultat, les voleurs ont également délaissé les DAB avec un nombre d'attaques réduit à zéro dès 2021, contre 18 encore en 2016. La situation au Danemark contraste avec celle de son voisin allemand. Outre-Rhin, plus de 800 braquages de distributeurs automatiques de billets (DAB) à l'explosif ont été recensés en 2020 et 2021. Les banques réfléchissent à fermer l'accès à leurs automates la nuit pour limiter ces attaques, de plus en plus violentes.
Usbek & Rica – Biodiversité à la ferme : quel avenir pour les animaux rares ?
L’agriculture du futur pourrait bien dépendre des races dites « locales », dans un contexte d’élevage plus sobre et vertueux. À condition de garder une place à ces animaux dans les étables, alors que plusieurs d’entre eux sont menacés de disparition. Etienne de Metz - 3 janvier 2023 #biodiversité #agriculture Troupeau de Bretonnes anciennes, un rameau de la race Bretonne pie noir © Marie-Jo Le Berre Ses cornes sont en forme de lyre et son pelage d’un joli blanc tacheté de noir. Ses membres sont ciselés et ses yeux brillants. Du haut de son mètre vingt au garrot, elle a tout d’une tragédienne. Une tragédienne rustique, qui a failli être reléguée au rang des souvenirs. Pourtant la Bretonne pie noir, petite vache née sur les sols granitiques du Finistère et du Morbihan, fut un temps la vedette des fermes françaises. Vantée par les paysans pour son adaptabilité et la qualité de son lait, la Bretonne pie noir était la première race bovine au début du XXe siècle : on en comptait alors sept cent mille dans l’Hexagone. 90 ans et une révolution du modèle agricole plus tard, on n’en dénombrait plus que quatre cent. Aujourd’hui, près de deux mille d’entre elles pâturent sur les côtes armoricaines et ailleurs en France. Et la vache Fine, fière représentante du cheptel, a même été choisie comme égérie du Salon de l’Agriculture en 2017. La race reprend du poil de la bête, peu à peu. Cette vache, comme d’autres, a failli être définitivement effacée des prés. Heureusement, une association est depuis trente ans au chevet des animaux de ferme en voie de disparition. « Nous avons un rôle de guetteurs. Nous aidons les personnes qui courent la campagne pour faire revivre des races locales menacées d’extinction », explique Georges Jouve, le président de la Fédération pour promouvoir l’Elevage des Races MEnacées (FERME). Dans son viseur également : l’oie du Tarn ou le mouton des Aravis. Leurs destins donnent des sueurs froides aux bénévoles de l’association, qui redoutent que les effectifs de ces races continuent de fondre comme neige au soleil. Oie du Tarn, mouton des Aravis… Des noms peu familiers ? Peut-être que celui du coq gaulois, emblème national, sonnera plus facilement à l’oreille. Manque de pot – ou de plume – le gallinacé est lui aussi menacé de disparition, alors FERME l’a pris sous son aile. Deux moutons marrons des Aravis © Laurene Losso Espèce ou race ? Il est important de différencier une espèce d’une race : la vache est une espèce avec une grande diversité de races (la Nantaise, la Montbéliarde, la Limousine…). Si les critères qui définissent une race sont assez stricts chez les ruminants, ils le sont moins pour les chevaux ou la volaille. Quoi qu’il en soit, on retiendra qu’une race est caractérisée un phénotype (l’apparence physique de l’animal) et un génotype (le patrimoine génétique transmis à chaque génération) « En races à petits effectifs, souvent presque chacun des passionnés a son Histoire et considère qu’il est le véritable acteur de la conservation », selon Coralie Danchin (Idele). Les races animales ont été créées sous l’influence de l’Humain et évoluent en permanence. Figer des standards est donc intéressant du point de vue de la classification, mais il n’est pas toujours pertinent de se baser uniquement dessus. Des pedigree de chevaux de Trait Auxois, ont par exemple permis de démontrer que trois grands-parents sur quatre sont d’une autre race. Une mosaïque d’animaux de la ferme Biquettes et lapins, canards et chiens, couvées de poussins et tripotées de porcelets… Il existe à travers le pays des dizaines et des dizaines de races locales. Autant de vestiges d’une extraordinaire mosaïque de diversité animale rendue possible par plusieurs siècles de sélection au niveau régional, voire cantonal. « La situation de la France est particulière : c’est un carrefour qui favorise des mouvements d’animaux entre le Nord et le Sud avec une grande variété de sols et de climats. Cela a permis de façonner des races très diverses pour des utilisations multiples », présente Coralie Danchin, chercheuse à l’Institut de l’élevage (Idele). « Notons toutefois que l’on s’écharpe sur la notion de race – qui est surtout une construction sociale – depuis qu’elle existe. Peut-être que le plus pragmatique est d’estimer qu’une race est une race à partir du moment où suffisamment de personnes le disent », tempère l’experte en génétique animale. « Si à un moment donné plus aucun éleveur ne s’intéresse à une race, je ne peux pas la sauver depuis mon bureau » Coralie Danchin, chercheuse à l'Institut de l'élevage Partager sur Twitter Partager sur Facebook La chercheuse ne s’émeut d’ailleurs pas tant à l’idée que la Cou-clair du Berry ou le cheval d’Auvergne soient moins visibles dans les champs. « Si à un moment donné plus aucun éleveur ne s’intéresse à une race, je ne peux pas la sauver depuis mon bureau », plaide la scientifique qui comptabilise les populations bovines, ovines et caprines depuis vingt ans. Car en parallèle du travail des instituts (comme la Société d’Ethnozootechnie), la mobilisation des associations spécialisées est le premier levier civil pour tenter de relancer une race. Il y a celle pour le Renouveau de la chèvre du Massif Central (ARCM-C), le Club Français du Lapin Gris de Touraine (CFLGT), la Société du berger de Savoie, l’Association nationale pour la race Casta… Des dizaines de collectifs ont fleuri en France grâce au soutien de FERME. Mais certaines races semblent vouées à l’oubli. Poule et poussins gaulois © Damien Vidart Ni du passé, ni dépassées « Si aucun collectif ne se crée, c’est que la race n’a plus d’histoire à raconter », juge Coralie Danchin. Ces races orphelines (voir encadré) sont parfois qualifiées « d’anciennes », mais le terme ne plaît ni aux scientifiques ni aux associatifs. « Il y a des châteaux anciens mais les vaches anciennes, ça fait longtemps qu’elles sont mortes, plaisante Georges Jouve. « Je ne revendique pas, quant à moi, cet aspect nostalgique convoyé par le terme “ancien” car nous regardons vers le futur. Notre but est de pérenniser un patrimoine génétique le plus large possible pour faire face aux problèmes de demain », ajoute le président de FERME. Ces races ne sont pas en péril par hasard : « Elles ont subi les conséquences de la spécialisation de l’agriculture, qui s’est opérée à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale », explicite Etienne Verrier, professeur de génétique animale à AgroParisTech (Paris Saclay). En effet, le modèle agricole actuel fait toujours la belle part aux races spécialisées. Qu’est ce qu’une race orpheline ? FERME distingue trois catégories d’animaux agricoles. D’abord, les races hégémoniques telles que la vache Holstein, largement représentée dans les étables françaises avec ses 2,5 millions de bêtes. Il existe ensuite les races à faible effectif, appellation qui concerne les 2 500 Bretonnes pie noir qui peuplent les champs de l’Hexagone. Puis les races à très faible effectif, dont fait partie la Bretonne ancienne et ses quelque 200 individus. C’est pour cette dernière catégorie que se mobilise FERME, qui préfère d’ailleurs regrouper les races concernées sous l’appellation « d’orphelines ». Les races orphelines peuvent être des races oubliées (ne bénéficiant d’aucune reconnaissance officielle alors qu’elles sont au seuil de l’extinction) ou prisées par un nombre trop faible d’éleveurs. Il peut aussi s’agir de races reconnues mais n’étant défendues par aucune association, ou des races élevées par des personnes aux démarches marginalisées, comme c’est le cas pour la Bretonne ancienne (en couverture d’article). Cette dernière est un rameau de la race Bretonne pie noir que l’éleveur Marcel Dahiez n’a pas voulu croiser avec des races plus répandues comme il en était alors coutume. Pour sa part, l’Institut de l’élevage (Idele) préfère parler de races menacées sans spécifier l’idée de races orphelines. Le centre de recherche s’occupe des premières principalement et des secondes en marge. L’Idele a par exemple travaillé à réhabiliter la chèvre de Savoie pendant deux décennies, jusqu’à sa reconnaissance officielle il y a deux ans. La vache Holstein, championne du monde des laitières, est par exemple particulièrement plébiscitée par le système d’élevage intensif. Mais c’est un animal sensible à de nombreuses maladies et anomalies génétiques, et dont la viande n’est pas spécialement appréciée des bouchers. A contrario, les races locales sont souvent mixtes, c’est-à-dire qu’elles peuvent être élevées à plusieurs fins : lait, viande, cuir… C’est le cas pour la Bretonne pie noir. « De par sa petite taille, elle supporte mieux la chaleur que d’autres bêtes plus volumineuses », explique Coralie Danchin (Idele). Et la chercheur d’émettre l’hypothèse suivante : « Comme la Bretonne pie noir, la plupart des races non spécialisées se défendront peut-être mieux que les autres face aux aléas climatiques ». Il faut dire que la question de l’adaptabilité du bétail deviendra cruciale dans les prochaines décennies. « On pense que les vaches supportent moins bien les températures élevées. Peut-être cela profitera-t-il à d’autres espèces, telles que le mouton ou la chèvre », avance Coralie Danchin (Idele). Des facteurs plus marginaux comme le retour au bio ou à une forme d’agriculture plus extensive pourraient aussi servir de tremplin aux races locales. « Les personnes qui se lancent dans l’écopastoralisme n’ont pas besoin d’animaux avec une morphologie particulièrement intéressante pour le boucher, sinon des bêtes solides et aptes à marcher. Ils sont donc souvent à la recherche d’animaux de race locale, généralement plus rustiques », note George Jouve (FERME). Rusticité, sobriété, adaptabilité L’idée de rusticité a cependant tendance à être galvaudée, utilisée à tort et à travers : « Si on lit un descriptif de race, il n’y en a pas une qui ne se proclame pas rustique. Y compris la Holstein », prévient Coralie Danchin. Dès lors, quels critères établissent la rusticité d’un animal ? Pour le dictionnaire d’agroécologie, c’est une bête qui « demande peu de soins et peut assurer la pérennité du troupeau et enchaîner les cycles de production tout en vivant dans des conditions où la ressource alimentaire est aléatoire. » Comprendre : l’animal est autonome sur tous les plans et peu demandeur en termes de soins. « Les aptitudes de rusticité et de robustesse seront davantage attendues chez les animaux d’élevage demain, dans un contexte plus incertain où économie et autonomie seront de mise dans les fermes comme ailleurs », précise le Professeur Etienne Verrier. Si l’utilisation du mot « rustique » fait débat au sein de la communauté scientifique, les races locales concernées nécessitent d’être encadrées selon une démarche qui entretient leur étonnante résilience : « Il faut ainsi que les bêtes soient élevées en accord avec le territoire sur lequel elles pâturent. Un agneau dont la mère mange de tout aura l’habitude d’être confronté à une nourriture variée et prendra les mêmes réflexes en grandissant », souligne George Jouve. Un grand avantage des races locales est leur capacité à valoriser tous types de terrains, même les plus austères. C’est-à-dire qu’une brebis fumée (un mouton du Cantal menacé de disparition), n’aura par exemple jamais le ventre vide sur un austère plateau de montagne puisqu’elle trouvera toujours quelque chose à ruminer. Cette carte postale est le premier document retrouvé par FERME pour guider ses recherches au moment du sauvetage de la race de chèvre du Massif Central. Une niche économique s’est ainsi créée avec des exploitations de taille modeste, qui favorisent la polyculture et des modes d’élevage diversifiés et plus vertueux. Cette agriculture s’adapte à chaque terroir, à chaque produit, et redonne une place de choix à ces races à faible effectif dont les besoins sont souvent limités. « Il y a cent ans, la première chose qu’on attendait d’une vache était sa bouse » Georges Jouve, président de l'association FERME Partager sur Twitter Partager sur Facebook Mais de là à révolutionner le système agricole français… il reste encore du chemin. Avec le Covid, de nombreux français se sont précipités vers les circuits courts, à l’avantage des éleveurs de races locales. Or deux ans plus tard, l’inflation leur a coupé l’herbe sous le pied. Les assiettes ont été regarnies de produits d’une qualité moindre mais surtout peu coûteux. Le bio reste un luxe que beaucoup ne peuvent pas s’offrir. « Tant que le prix restera l’élément décisif pour les consommateurs, le modèle ne changera pas », estime Coralie Danchin. Et quand bien même les ménages font de plus en plus l’effort d’acheter « responsable », bio ne veut pas forcément dire issu de races locales. Les races du futur ? « Il y a cent ans, la première chose qu’on attendait d’une vache était sa bouse », raconte George Jouve (FERME). L’utilisation de ce condensé d’engrais naturel permet d’enrichir les champs sans épuiser les sols autant que les intrants chimiques. Et peut faire réfléchir à d’autres valorisations des animaux de ferme. Les races à faibles effectifs pourraient même en tirer parti : le pari a d’ailleurs déjà été relevé ! Chaque année, des canards sont lâchés dans les rizières de la commune de Saint-Gilles, en Camargue. Les palmipèdes se régalent de mauvaises herbes et remuent la vase en nageant entre les cultures. « L’utilisation des animaux domestiques dans le cadre de services écosystémiques peut contribuer à relancer certaines races », indique Etienne Verrier (AgrosParisTech). Ecopâturage sur les digues des étangs ou sur les talus des voies ferrées, traction animale… « Bien entendu, cela pèse moins lourd dans notre monde motorisé », relativise le scientifique. « Mais on sait que ces animaux qu’on a tendance à oublier sont souvent le support de nouvelles pratiques agricoles », justifie encore le Professeur Verrier. Un âne pour porter des cagettes de pommes, vraiment ? L’image n’est pourtant pas régressive : de plus en plus de formations de maraîchage proposent d’apprivoiser un équidé plutôt qu’un motoculteur pour les récoltes. Chaque espèce a un rôle, chaque race un potentiel. La biodiversité agricole n’est pas une sous-biodiversité à traiter avec bassesse, pas plus que la biodiversité sauvage n’est la seule qui mérite d’être protégée (voir encadré). « Les personnes s’intéressant à la biodiversité domestique livrent un “combat” quasi-quotidien pour qu’elle ne soit pas oubliée et pour convaincre les décideurs qu’il faut s’en préoccuper », insiste Etienne Verrier (AgroParisTech). Rencontrer la faune en bas de chez soi peut être galvanisant. « Soyez curieux », répète George Jouve (FERME), qui ajoute « qu’il faut faire l’expérience de la découverte pour comprendre la richesse du monde qui nous entoure ». Morale de l’histoire : la diversité, ça a toujours du bon. La première victoire de l'association FERME est le sauvetage de la chèvre du Massif Central, après près de vingt ans de mobilisation. © La Chèvre Pastorale NB : Si vous connaissez une race ou une population d’animaux agricoles en péril, vous pouvez contacter l’association FERME par mail à l’adresse suivante : ferme2@wanadoo.fr. « Le scandale de la vache d’Amsterdam » Dans les années 1870, les Heurtin – une famille d’agriculteurs réunionnais – débarque sur l’île d’Amsterdam située au beau milieu de l’océan Indien. Ils projettent d’y installer un élevage de bovins et d’y cultiver la terre. Six mois à peine après leur arrivée, le projet tombe à l’eau, en raison des difficiles conditions météorologiques de l’île. Les Heurtin replient bagage et s’en retournent à La Réunion mais laissent six bêtes derrière eux. Cinq vaches et un taureau, qui s’acclimatent aisément à l’île d’Amsterdam. Le cheptel grossit pour atteindre près de 2000 têtes cent ans plus tard. « Le troupeau de bovins s’est développé sur l’île en milieu fermé (endogamie), sans autre apport extérieur, constituant alors une population totalement autonome », précise un numéro spécial de la gazette de FERME. Ces vaches sauvages, devenues trop nombreuses, piétinent alors l’habitat d’autres espèces comme l’albatros d’Amsterdam, le plus rare au monde. Après des tirs de régulation censés diminuer la taille des troupeaux, décision est prise en 2010 (année internationale de la biodiversité) d’éradiquer totalement la population de vaches de l’île. En revanche, aucun programme de sauvegarde de cette jeune race au patrimoine génétique exceptionnel – du fait de son isolement durant des décennies – n’est mis en place, et on estime que la dernière vache d’Amsterdam est abattue en 2011. Or certains moyens auraient pu permettre de conserver la race sans qu’elle ne continue à faire des dégâts : prélèvement de gamètes ou cryogénisation d’embryons, préservation d’un petit troupeau en pâturage fermé sur l’île ou ailleurs…
Voiture connectée, métavers et écologie au programme du CES, plus grand salon technologique du monde
La voiture monte en puissance L’automobile sera une dominante cette année, avec près de 300 exposants issus de l’industrie, réunis dans un hall d’exposition dédié, avec notamment des présentations de Stellantis, BMW, et la présence de cadres de Honda. « Cette année, vous allez quasiment avoir l’impression d’être à un salon de l’auto », résume Kevan Yalowitz, responsable de l’activité logiciels et plateformes au sein du cabinet Accenture. L’accélération technologique de l’automobile fait désormais du CES une destination évidente, sur fond de perte de vitesse du salon de Detroit, suspendu pendant trois ans avant un redémarrage à moindre échelle en septembre dernier. SUR LE MÊME SUJET Innovation. CES Las Vegas 2023 : 24 entreprises de la Nouvelle-Aquitaine dans les starting-blocks Les entreprises de la région qui participeront au Consumer electronic show de Las Vegas, début janvier, sont dans les starting-blocks. L’heure des ultimes réglages avant le grand tourbillon Même si l’arrivée des voitures entièrement autonomes semble plus lointaine que prévu initialement, une bonne partie des innovations présentées cette année vise à substituer le logiciel au conducteur. Parmi les nouveautés, la possibilité de mettre à jour à distance le logiciel de gestion du véhicule, comme un ordinateur ou un smartphone. Ces programmes pourraient « modifier les paramètres d’utilisation du véhicule instantanément, identifier des problèmes qui peuvent être réglés sans même que le conducteur ne s’en soit rendu compte », explique M. Yalowitz. Le métavers s’accroche L’an dernier, le CES avait été dominé par l’idée que la réalité virtuelle, accessible avec un casque, était l’avenir d’internet. Mais l’enthousiasme s’est essoufflé, plombé par la mauvaise année de Meta (ex-Facebook), considéré comme la locomotive du métavers. Le groupe de Menlo Park (Californie) peine encore à convaincre les utilisateurs de franchir le pas, malgré des investissements colossaux. Le métavers « n’est pas encore une catégorie grand public », estime Carolina Milanesi, de Creative Strategies. Les mondes virtuels n’en seront pas moins encore à l’honneur cette année. Plusieurs sociétés et intervenants montreront ainsi les applications possibles de ces univers parallèles. La révolution connectée Les appareils connectés montent en puissance depuis près d’une décennie, mais le marché reste très fragmenté, avec des dizaines de fabricants et de nombreuses normes et standards concurrents. Sous l’égide de l’Alliance des standards de connectivité (CSA), plus de 550 sociétés ont collaboré pour définir un protocole commun, que les experts voient comme une révolution. Avec la nouvelle norme, appelée Matter, dont la première version a été lancée en octobre, il sera désormais possible d’acheter un appareil de toute marque ou presque et de le connecter à l’écosystème existant de votre domicile, qu’il s’agisse des applications Alexa d’Amazon ou Nest de Google. SUR LE MÊME SUJET Guerre en Ukraine : comment reconnaître les images issues du jeu « Arma 3 » dans les vidéos de désinformation ? De nombreuses images censées illustrer le conflit en Ukraine sont en fait tirées du jeu de guerre « Arma 3 », aux graphismes très réalistes, et servent à alimenter le flot de désinformation. Voici comment les reconnaître « Quelques produits ont déjà obtenu leur certification » de conformité à ce nouveau standard « et il y en aura encore bien d’autres dans les allées du CES », annonce Avi Greengart, du cabinet Techsponential. « On va voir des appareils Matter synchronisés avec des sonnettes (d’entrée), des aspirateurs et autres », ajoute l’analyste. La technologie verte A LIRE AUSSI Disparus dans les Deux-Sèvres : Dans la benne de Puyravault, « jamais Leslie n’aurait jeté ces affaires-là » Disparus de Boutiers : 50 ans après, l’énigme d’une famille charentaise évaporée dans la nuit de Noël LES SUJETS ASSOCIÉS Etats-Unis Sciences et Technologie Jeux vidéo International Economie Home Le thème du changement climatique fait partie des grands sujets du CES depuis plusieurs années, même si les événements qui y sont consacrés attirent moins le public que les derniers gadgets électroniques. Cette semaine, la technologie verte aura droit à son propre lieu d’exposition, signe du désir des organisateurs d’accorder au sujet davantage de visibilité.
Eric Larchevêque, l’homme qui croit encore en l’avenir des cryptos
À le croiser dans un palace parisien proche de l'Opéra, il n'a rien du profil type du hipster-baba-geek des cryptos, fan de poker et de surf. Discret, pédago, ce barbu blond à l'allure de viking policé est aux antipodes du style déjanté d'un Sam Bankman-Fried, patron de FTX, l'homme par qui le scandale des cryptomonnaies est arrivé, désormais en prison. Il est pourtant considéré comme le vrai « parrain » de l'écosystème français des cryptos. Fondateur de la Maison du Bitcoin il y a dix ans, ce «serial entrepreneur» _ qui participe à l'émission «Qui veut être mon associé?» sur M6 _ est à l'origine de Ledger, première licorne française spécialisée dans le stockage de bitcoins et la gestion de portefeuilles sécurisés de cryptomonnaies, valorisée à 1,5 milliard d'euros. Avec Pascal Gauthier, un ancien de Criteo auquel il a cédé la barre de Ledger en 2019, il reste persuadé que, malgré son impact désastreux sur la confiance des investisseurs, la faillite récente de FTX n'affecte en rien les fondamentaux du bitcoin et des cryptomonnaies. Mieux : la mission de son entreprise, qui garantit aux utilisateurs de conserver eux-mêmes leurs cryptoactifs sans s'en remettre aux plates-formes d'échange telles que FTX, n'en deviendrait même que plus « pertinente et indispensable ». « On n'a jamais autant vendu que maintenant chez Ledger », confie Eric Larchevêque. « Mais l'état du marché global est catastrophique : le prix du bitcoin a dégringolé [16.000 dollars contre 25.000 dollars en mai 2022, NDLR]. La chute de FTX est un gros coup sur la tête. Notre industrie passe pour une bande de clowns : qui peut nous prendre au sérieux ? » soupire le cofondateur de Ledger, sans cacher sa préoccupation. LIRE AUSSI : Ledger, la nouvelle licorne française 4 choses à savoir sur Ledger Sa principale crainte : la tentation de la régulation dans l'urgence. « Les régulateurs vont dire : c'est le bazar, le far-west… et donc on va faire n'importe quoi. » À la Banque de France comme à la BCE, la chute de FTX est vécue comme le chant du cygne du bitcoin. Les pionniers de la cryptosphère à la française ne le voient évidemment pas ainsi. Pour eux, c'est tout juste un nouvel accident de parcours, huit ans après l'effondrement de Mt. Gox, la société de Mark Karpelès, à la suite d'un piratage informatique. « C'est vrai : il y a pas mal de margoulins dans ce secteur, mais ils sont généralement 'off-shore' », souligne un autre pilier de l'écosystème, Pierre Noizat, le fondateur de Paymium, la première plate-forme d'échange de cryptos française (avec 250.000 clients). Un croisement entre Theranos et WeWork Sam Bankman-Fried, ce mauvais génie des Bahamas, arrêté le 12 décembre et poursuivi pour huit chefs d'accusation, dont fraude par voie électronique et blanchiment de fonds, n'est pas un inconnu pour Pascal Gauthier, le nouveau CEO de Ledger. Il l'avait croisé une première fois en 2021, avant de conclure un accord avec lui en juillet 2022, quatre mois avant la débâcle éclair de la plate-forme de trading emportée par un déficit abyssal de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, il n'a pas de mots assez durs pour la star déchue des cryptos. « Il y avait un vrai décalage entre son ambition et les moyens qu'il se donnait. Quand je l'ai rencontré en 2021, il m'a clairement laissé entendre qu'il pourrait très bien racheter Goldman Sachs avec une équipe de 100 personnes et presque zéro pedigree. Il avait un génie du narratif. C'est Christophe Rocancourt [l'escroc des stars, NDLR] à la puissance N », ajoute le CEO de Ledger. Pour Pascal Gauthier, le bitcoin est né comme une réponse technologique à la chute de Lehman Brothers en 2008. Mais très vite est apparue une forme de dévoiement avec la création de toutes les plates-formes de trading centralisées. « Elles ont voulu appliquer le même modèle que les banques », dit-il. Quant à la chute de Sam Bankman-Fried (SBF) , « le plus grand casse de tous les temps », Pascal Gauthier l'analyse comme un croisement entre les faillites de Theranos et de WeWork : « Un mélange de vrai business et de vraie fraude. Pour moi, c'est Elizabeth Holmes et Adam Neumann qui auraient eu un enfant. Comme Elizabeth Holmes avec Theranos, SBF a réussi à étouffer tous les lanceurs d'alerte possibles en se faisant adouber par l'establishment et en arrosant tous les politiques à Washington. Il était en train de gagner cette bataille : il était considéré comme le golden boy de la crypto. » Itinéraire d'un baroudeur Pour Eric Larchevêque, « tous les dominos ne sont pas encore tombés ». L'annonce de l'arrestation de SBF est plutôt un signal rassurant qui va permettre de faire le tri : « Ce n'est pas juste un génie incompris, mais un criminel. » À ses yeux, un test crucial reste l'avenir de la plate-forme de cryptomonnaies Gemini des jumeaux Winklevoss (valorisée à 7 milliards de dollars) et de Genesis (la plate-forme du Boston Consulting Group), toutes deux lourdement exposées à FTX. En même temps qu'il fondait Ledger, Eric Larchevêque avait créé Coinhouse, une plate-forme de courtage de cryptos qui reste également exposée à FTX via Genesis. Mais il ne faudrait pas jeter tous les bébés des cryptos avec l'eau du bain. Depuis ses débuts dans l'hébergement Internet et les sites de rencontre, Eric Larchevêque a fait de la résilience une vertu. Tout son itinéraire un peu baroque le prouve. Arrière-petit-fils d'un porcelainier de Vierzon, le pape des cryptos à la française a vu du pays avant de cofonder Ledger avec sept partenaires en 2014. Après avoir revendu sa première entreprise à une figure du Web français, Jean-Baptiste Descroix-Vernier (Rentabiliweb), il quitte la France, en 2002, pour créer une plate-forme « off-shore » en Roumanie. Il décide ensuite de se transférer en Lettonie pour tenter d'y récupérer des avoirs dans une banque qui a fait faillite. À Riga, il crée un hôtel design, le Dodo Hotel, et mène une brève carrière de joueur de poker qui le mène au championnat d'Europe. C'est aussi là qu'il rencontre sa femme, avec laquelle il a créé le fonds de dotation Eric et Iveta Larchevêque, destiné à financer des projets éducatifs autour des sciences pour les jeunes. « À la différence de Sam Bankman-Fried, je le fais avec mon argent, pas avec celui des clients », précise-t-il. Pascal Gauthier, CEO de Ledger, dans son bureau à Paris. Il a pris les rênes de l'entreprise en 2019.Edouard Jacquinet pour Les Echos Week-End En 2013, il vend un comparateur de prix, Prixing, à High Co, et décide de plonger dans le monde des cryptos. « Pour moi, cela a été une sorte de révélation mystique. Je me suis dit : il faut en être. Je décide de fonder la Maison du Bitcoin. L'idée, c'était de créer des opportunités. À l'époque, jamais je n'aurais trouvé un investisseur pour y participer », explique celui qui se considère comme un libertarien, sans être un militant pour autant. Le hasard des rencontres fait le reste : il croise la route de ChronoCoin et BTChip avec lesquels il décide de fusionner pour donner naissance à Ledger (« registre » en anglais) en 2014, avec sept autres cofondateurs. Sept ans plus tard, Ledger a levé 380 millions de dollars et compte parmi ses actionnaires Draper Associates, FirstMark Capital, Cathay Innovation, et Korelya Capital, le fonds dirigé en France par Fleur Pellerin. Eric Larchevêque, lui, reste le premier investisseur à 15 %. « L'internationalisation a été décisive. Dès le début, on a décidé d'ouvrir un bureau à San Francisco pour exister aux Etats-Unis, indique-t-il. En 2017, il y a eu l'explosion du bitcoin et des cryptoactifs. Tout le monde voulait sécuriser ses investissements. En un an, notre chiffre d'affaires a été multiplié par cent : un vrai décollage vertical. » Un nouveau portefeuille avec le créateur de l'iPod Aujourd'hui, Ledger estime contrôler « 70 % du marché des portefeuilles de sécurisation des cryptoactifs (hardware wallets) et sécuriser 20 % de toutes les cryptos mondiales », selon son fondateur. La licorne française compte parmi ses concurrents Trezor, créé en République tchèque, mais aussi l'israélien ZenGo, MetaMask ou Coinbase Wallet… Loin de l'abattre, la faillite de FTX lui donne des ailes. L'objectif à terme est ambitieux : créer une société qui atteigne une valorisation boursière de 100 milliards de dollars à l'horizon 2025 (contre 1,5 milliard aujourd'hui). « On a du mal à créer des géants de la technologie en Europe. Le Web3 et la blockchain, c'est l'opportunité de le faire, juge Pascal Gauthier. Il y a un grand moment de douleur. Mais cela va donner aux gens les bons réflexes sur le long terme : contrôler eux-mêmes leurs destinées. » Pour preuve, le 6 décembre, Ledger a annoncé une étape majeure : le lancement de sa nouvelle génération de hardware wallet physique destiné à renforcer la confiance des investisseurs. Baptisé Ledger Stax , ce nouveau portefeuille haut de gamme à « l'ergonomie révolutionnaire » a été réalisé en collaboration avec Tony Fadell, le cocréateur de l'iPhone et concepteur de l'iPod d'Apple, l'homme qui a revendu Nest Labs pour 3 milliards de dollars à Google. Présenté à Paris à la Gaîté Lyrique, ce portefeuille cryptographique, doté d'un écran tactile incurvé de 3,7 pouces, utilisant la technologie E-Ink des liseuses, sera disponible en mars 2023. Ledger a passé un accord avec Foxconn pour produire ce nouveau terminal qui permettra aux utilisateurs de stocker leurs bitcoins et autres cryptomonnaies. « On est très focalisé sur les prochains usages des cryptos : Art NFT ou l'identité décentralisée. On est en train de créer une couche de sécurité par-dessus le Web. Nous visons la sécurisation des données de santé… » Pour Eric Larchevêque, « 100 milliards de valorisation pour Ledger, c'est beaucoup, mais c'est complètement réaliste ».Edouard Jacquinet pour Les Echos Week-End Un pari fou dans un contexte de débandade ? Au contraire. « Avec la chute de FTX, on a réalisé le meilleur mois de tous les temps de l'histoire de Ledger en novembre. D'une certaine manière, on est revenu à la raison », assure le CEO de Ledger, Pascal Gauthier, depuis son bureau près de la Bourse, à Paris, où trône une grande effigie de Dark Vador. Après une série d'échecs en 2022 - la faillite de Celsius, BlockFi, Voyager Digital ou du fonds d'investissement en cryptos 3AC (Three Arrows Capital), le crash de Terra Luna… -, il mise sur une forme d'écrémage. « C'est l'échec des mauvaises pratiques… Il y a trop d'avidité dans le secteur », résume cet éleveur de licornes (Yahoo, Kelkoo, Criteo…), grand fan de l'écrivain de science-fiction américain Isaac Asimov. « 100 milliards de valorisation, c'est beaucoup, mais c'est complètement réaliste. Si Ledger sécurise le monde des cryptos, ce n'est pas du tout une utopie. En revanche, cela prendra plusieurs années », insiste Eric Larchevêque, sans cacher qu'avec l'explosion de FTX, le marché des cryptos risque de reculer de trois ans. Mais à moyen et long terme, il croit plus que jamais en l'avenir de cette technologie. En guise de pont entre la finance centralisée classique et le bitcoin, il se dit favorable à l'euro-stablecoin, un actif numérique indexé sur l'euro, accessible sur une « blockchain » décentralisée, sur le modèle du cryptodollar USDC, adossé au billet vert, lancé en 2018. L'américain Circle a déjà lancé son stablecoin adossé à l'euro en juin dernier. « Ce serait positif que l'euro puisse jouer un rôle dans la finance décentralisée. Mais la régulation européenne reste un obstacle et favorise encore l'hégémonie du dollar », regrette le fondateur de Ledger. Les pionniers de la cryptosphère ne désarment pas.
CES 2023 Liveblog: Samsung’s new Bespoke AI Oven packs
Samsung’s new Bespoke AI Oven packs a slew of smart features including an internal camera with AI capabilities. You’ll have the option to pick from specific cooking modes (like Air Fry, Air Sous Vide, Steam Cook+, and more) using the 7-inch LCD touchscreen on the outside or you can opt for the Sense Inside feature—which utilizes the aforementioned camera and an AI algorithm to recommend optimal cooking settings based on 80 different dishes and ingredients. There’s also a burn-detection feature that’ll send a notification to your phone to prevent overcooking, but that’s limited to European models. To help you keep an eye on your food—without having to constantly open the oven door—you’ll have the ability to monitor the status of your food and control the oven via the SmartThings app on your phone. There’s also the option to live stream your cooking to social media (if you’re into that kind of thing). When coupled with the Samsung Health app, you can use the oven for meal suggestions based on your workout stats, diet goals, and ingredients you have at home. Samsung has yet to reveal exact pricing and availability information, but the company says the Bespoke AI Oven will launch in the U.S. later this year.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.