AWFT24 : Comment financer la transition écologique du tourisme ? –
Le tourisme, en pleine mutation, doit aujourd’hui relever le défi de la durabilité. Si des technologies émergent, leur mise en œuvre nécessite des financements conséquents. Experts et investisseurs ont appelé lors du forum A World For Travel à une collaboration entre fonds publics, entreprises et consommateurs pour soutenir cette révolution verte. Selon Bobby Demri, Fondateur de Roch Ventures, un fonds d’investissement dédié au tourisme, le secteur vit sa 5e révolution. Il y a d’abord eu la révolution des GDS, puis celle des compagnies aériennes low cost. S’en est suivie l’arrivée des OTA, dont Booking, qui ont changé la manière dont on achète un voyage. Airbnb a fait son apparition quelques années plus tard et a encore créé une nouvelle révolution. Désormais, ce sont la technologie et la durabilité qui transforment le secteur. Mais selon lui, il n’existe pas encore de technologie révolutionnaire pour transformer durablement le voyage. « J’encourage les entrepreneurs à penser à des technologies, à des produits, à des solutions qui auraient un réel impact, car les grandes entreprises cherchent désespérément ce type de solutions durables », a-t-il déclaré. La nécessité de standardiser Dans le secteur de l’aérien, Julia Sattel, Partner de Clearsky Fund, affirme que des efforts sont faits. Selon elle, il ne faut pas arrêter de prendre l’avion, car cela aurait des conséquences économiques dévastatrices pour certaines populations, mais transformer le secteur. « L’aviation a un objectif clair : atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Les technologies existent, mais doivent être déployées à plus grande échelle et commercialisées plus efficacement. Il faut un changement d’ordre de grandeur. C’est difficile, mais c’est possible », a-t-elle affirmé sur scène. Plusieurs solutions existent : le carburant d’aviation durable (SAF), les matériaux légers, les nouveaux systèmes de propulsion, l’utilisation de l’énergie solaire dans les aéroports ou encore l’optimisation des trajectoires de vol grâce à l’intelligence artificielle. Trouver un équilibre entre impact environnemental, social et économique Les solutions ne sont pas adoptées immédiatement pour plusieurs raisons selon Nikolaos Gkolfinopoulos, Head of Tourism chez ICF : « Le défi de la durabilité est de trouver un équilibre entre l’impact environnemental, social et économique. Mais souvent, l’impact économique, à court terme, entre en conflit avec les deux autres. C’est pourquoi certaines technologies, bien qu’existantes, ne décollent pas. Par exemple, les solutions électriques ou à hydrogène ne conviennent que pour les courtes distances. Que se passe-t-il si vous êtes en Australie et que vous voulez attirer des touristes des États-Unis ou du Royaume-Uni ? », a-t-il questionné. De son côté, Amadeus, à travers Amadeus Ventures, a commencé à ajouter la durabilité à ses critères d’investissement en 2021. L’entreprise a ainsi investi dans Chooose, qui propose un moteur de calcul d’émission carbone et Caphenia, un futur producteur de gaz de synthèse, matière première du carburant aviation durable (SAF). Faire émerger les émissions de scope 4 Mesurer l’impact carbone d’un voyage, c’est aussi ce que propose Trees4Travel. L’entreprise a choisi de mettre son outil gratuitement à disposition des entreprises. « Nous sommes convaincus que la technologie de mesure du carbone doit être gratuite, car si elle ne l’est pas, on n’arrivera jamais à établir une norme », a affirmé Nico Nicholas, CEO de Trees4Travel. L’entité incite les entreprises à investir cet argent économisé dans des actions en faveur de l’environnement. On parle alors d’émissions de scope 4 ou « émissions évitées » et concernent les réductions d’émissions réalisées grâce à l’utilisation des produits ou services d’une entreprise. « Par exemple, si vous prenez le train plutôt que l’avion, vous pouvez calculer vos émission évitées », a expliqué Nico Nicholas. Ce concept relativement récent permet de mettre en avant les externalités positives des produits ou services d’une entreprise. Mais il n’est pas encore standardisé. Qui doit payer la révolution verte ? Selon Bobby Demri, le financement de la durabilité du tourisme doit d’abord être l’œuvre des institutions publiques. « [Elles] doivent injecter de l’argent dans des fonds d’investissement comme le nôtre, ou dans des fonds dédiés à la durabilité, pour soutenir les nouvelles technologies qui répondent à ce problème », assure-t-il. « L’Europe est sérieuse en matière de durabilité. Qu’elle le prouve. Nous avons perdu la bataille de l’IA, ne perdons pas la bataille de la durabilité ». Pour Julia Sattel, les gouvernements ont un rôle à jouer en finançant des organismes industriels comme l’IATA, mais l’investissement dans des fonds comme ClearSky, dédié à la durabilité de l’aviation, peut également avoir un impact positif. « Les compagnies aériennes, par nature, sont très compétitives. Elles fonctionnent avec des marges très serrées. Elles subissent la pression de leurs actionnaires. Elles ne sont donc pas conçues pour résoudre le problème elles-mêmes », estime-t-elle. Un besoin de clarification Bobby Demri observe que pour beaucoup d’entreprises du tourisme dans lesquelles Roch Ventures investit, il y a un vrai besoin d’éducation et de transparence. « Les jeunes leaders, qui créeront probablement le prochain Booking, ne savent pas ce qui est attendu d’eux. Il y a un grand travail d’éducation à effectuer », a-t-il déclaré. Nikolaos Gkolfinopoulos confirme que l’éducation est un aspect clé. Non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs. « Parce que si les consommateurs ne comprennent pas l’impact de leurs choix, comment peuvent-ils prendre des décisions éclairées ? Je pense que c’est là que la technologie pourrait jouer un rôle crucial », soulève-t-il. Tous les intervenants ont rappelé l’importance de la collaboration entre le secteur privé, le secteur public, les ONG et les consommateurs pour parvenir à transformer les secteur.
Lounge aéroports : Air France et Delta voient grand à New York
Air France, outre sa desserte de New York John F. Kennedy (JFK), relie également Paris CDG à New York Newark. Une ligne relancée fin 2022 après dix ans d’absence, opérée pour l’instant une seule fois par jour. Dans le deuxième aéroport new-yorkais, la compagnie française avait noué un partenariat avec British Airways pour utiliser son lounge du terminal B. La perte de l’accès à celui-ci a accéléré la décision d’AF de se doter de son propre salon, d’autant que JFK est proche de la saturation. Elle aurait ainsi obtenu l’approbation du conseil d’administration de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey qui gère les trois aéroports new-yorkais (JFK, Newark et La Guardia) : la compagnie tricolore va se doter d’un salon de 570m² dans le terminal B. Un bail de sept ans, dont le coût est estimé à 13 millions de dollars pour le transporteur, entrera en vigueur début janvier prochain. Air France s’engage également à investir au moins 3 millions de dollars dans la rénovation des espaces. Un double investissement dont la durée d’amortissement sera limitée, le gestionnaire de l’aéroport envisageant à moyen-long terme le remplacement de l’actuel terminal B par une structure flambant neuve. Air France n’est pas la seule à estimer que le jeu en vaut la chandelle : Lufthansa a rouvert après complète rénovation son salon de Newark, situé lui aussi au terminal B. Un investissement de 10 millions d’euros environ, pour une surface augmentée de 25% (600m² pour une capacité d’accueil de 170 passagers). Aujourd’hui, en attendant son nouveau salon, Air France redirige ses passagers vers le Delta Sky Club ouvert l’an dernier. Mais ce lounge se trouve dans le Terminal A, accessible en empruntant un AirTrain. Le nouveau Delta One Lounge de JFK. photo Delta Air Lines Les deux compagnies ne partagent pas davantage le même terminal à JFK. Air France dispose d’un salon au T1, un espace entièrement repensé en 2018. Delta a pour sa part inauguré en juin dernier son nouveau concept de « salon premium » dans le T4. Le Delta One Club, pour rappel, est le plus grand salon de la compagnie US, un espace de 3500m² comprenant à la fois une brasserie et un buffet concocté par un chef, des espaces de bien-être, une terrasse ouverte toute l’année… Rappelons que la partenaire américaine d’Air France est également la principale utilisatrice de La Guardia, dédié aux vols domestiques. Installée dans le nouveau terminal C, elle dispose d’un vaste Delta Sky Club, le deuxième plus grand salon des Etats-Unis avec ses 3 400m² de superficie et sa capacité d’accueil de 600 passagers. La compagnie d’Atlanta vient d’inaugurer un autre Delta One Lounge à Los Angeles. Trois autres de ces lounge “premium” vont ouvrir dans les prochains mois aux Etats-Unis, l’un à Boston Logan à la fin de cette année, deux autres à Seattle-Tacoma en 2025 et Salt Lake City à une date non encore communiquée. Air France a pour sa part ouvert en juin dernier un élégant nouveau salon dans la “cité des Anges”, au terminal Tom Bradley. Le lounge dispose d’une surface de plus de 1 100 m² et de 172 places assises. La compagnie française opère six salons dans les aéroports américains, à New York JFK, Boston Logan, Houston, Los Angeles, San Francisco et Washington Dulles.
L’Odyssey : nouvelles lignes aériennes au départ de Nîmes et Tours
Edeis, qui gère 17 aéroports en France dont ceux de Tours, Nîmes, Dole, Auxerre et Cherbourg, démarre une collaboration avec L’Odyssey, marque commerciale de Jet Airlines. Cette dernière est une société française créée en 2019 à Paris, dirigée par Clément Pellistrandi et David Roman. Objectif de ce rapprochement, développer les aéroports de Nîmes et de Tours, avec de nouvelles lignes aériennes régulières vers la France et l’Europe. Entre le 27 mai et le 1er juin prochain, L’Odyssey va ainsi positionner un ATR72-600 de 70 sièges à Nîmes, opérant des vols sur Milan avec un stop à Nice, sur Vérone avec un stop à Genève, sur Barcelone, Ajaccio et Bastia. Au départ de Tours, le seul aéroport de la région Centre Val de Loire, la compagnie va également desservir Ajaccio et Bastia, là encore dès le prochain programme d’été ; ces deux destinations corses étaient reliées à la cité tourangelle avant la pandémie de Covid-19, dans le cadre de vols affrétés par Corsicatours. Victoire Totah, directrice Stratégie et Développement d’Edeis, et Martin Meyrier, directeur général d’Edeis Concessions L’Odyssey devrait assurer deux vols par semaine sur ces dessertes (à l’exception de la Corse reliée par un vol hebdomadaire), tout en envisageant d’opérer à l’année et d’augmenter les fréquences dans un avenir proche. Et d’annoncer déjà, à l’horizon du printemps 2027, l’ouverture de nouvelles routes directes vers des destinations comme Nantes, Rome, Strasbourg et Zurich. L’aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée (anciennement Nîmes Alès Camargue Cévennes) se positionne comme une alternative à Montpellier Méditerranée, la métropole héraultaise n’étant pourtant distante de la cité gardoise que d’une cinquantaine de kilomètres. Les compagnies legacy et les low-costs privilégient les grands aéroports régionaux, à quelques exceptions près tel Ryanair qui opère elle aussi depuis ces aéroports « territoriaux », y compris Tours et Nimes. «Avec les nouveaux vols L’Odyssey, l’offre double au départ de Nîmes», a précisé Victoire Totah, directrice Stratégie et Développement d’Edeis, lors d’un point presse ce mercredi à Paris. Celle qui a effectué une bonne partie de sa carrière dans l’aviation d’affaires (chez TAG Aviation, Wijet, Aero Capital SAS) précise que l’offre de L’Odyssey intéressera les voyageurs d’affaires mais visera d’abord la clientèle loisir. La commercialisation des nouvelles lignes est ouverte dès ce 21 novembre, en direct sur le site internet de L’Odyssey, via les agences de voyages (partenariat avec Resaneo), les OTA et les GDS (Worldticket) et les tour-opérateurs dans le cadre de packages touristiques. Jet Airlines, pour rappel, s’est spécialisée dans l’exploitation de lignes régulières et ponctuelles. L’Odyssey a notamment opéré une première ligne régulière Genève-Deauville, des charters réguliers Berne-Calvi, ou encore une reprise de délégation de service publique temporaire en Guyane, suite à la faillite d’Air Guyane. Jet Airlines affrétait jusqu’à présent les avions qu’elle utilisait. Elle aurait récupéré un CTA (certificat de transporteur aérien) suite au rachat récent d’une compagnie aérienne, sans plus de précisions.
Taxi volant : la région Ile-de-France retire sa subvention –
Après avoir manqué l’échéance des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’avenir des taxis volants en France est plus qu’incertain. Le secteur essuie un nouveau revers avec l’annonce de l’annulation d’une subvention accordée par la région Ile-de-France. Un nouveau coup dur pour la filière des taxis volants qui n’a pas pu faire décoller les premiers engins à l’occasion des JO. Un retard pour obtenir les certifications nécessaires avait eu raison des premiers vols à Paris l’été dernier mais les acteurs ne s’avouaient pas vaincus. Désormais, c’est au tour de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, d’annoncer le retrait de la subvention censée être accordée au groupe ADP pour installer une plateforme d’envol et d’atterrissage de ces appareils. Cette aide d’une valeur d’un million d’euros devait permettre au groupe associé à Volocopter et Lilium, de réaliser des tests depuis le vertiport d’Austerlitz. La région Ile-de-France continue de soutenir les projets innovants Le principe de ce versement avait été adopté le 17 novembre 2023, mais « à la suite de retards pris à différents niveaux, retard de livraison des moteurs du véhicule par un fournisseur américain, absence de certification de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), l’expérimentation n’a pas pu avoir lieu dans les conditions envisagées », a expliqué Valérie Pécresse. Toujours selon la présidente de la région, cette annulation ne remet pas en cause le soutien à l’innovation et aux eVTOL. « Les eVTOL constituent un mode de transport à propulsion électrique ou hydrogène qui prépare la transition de la filière aéronautique vers des modes de propulsion plus durables », est-il indiqué à travers un communiqué publié par le Conseil Régional d’IDF. De son côté, ADP a certifié à l’AFP que le groupe se tient « prêt à pouvoir mener une expérimentation en décembre, depuis la barge d’Austerlitz »,
Nouvelle taxe “Chirac” : jusqu’à 130% du prix d’un trajet en avion d’affaires…
L’aviation d’affaires s’élève à son tour contre l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Ses arguments chiffrés sont édifiants… Après les compagnies aériennes françaises (Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers), les aéroports (Union des aéroports français et francophones associés), les agences de voyage (Entreprises du voyage) et les tour-opérateurs (Syndicat des entreprises du tour-operating), c’est au tour de l’aviation d’affaires de s’élever contre l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA). Alors que l’amendement concernant cet enchérissement de la taxe dite “Chirac” vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre Projet de loi de finances 2025, le chapitre “France” de l’EBAA (l’European Business Aviation Association (EBAA) France) alerte sur les dangers que ferait peser son adoption définitive sur l’aviation d’affaires. Dans son communiqué, l’association juge cette mesure “largement disproportionnée et fondée sur une méconnaissance des enjeux du secteur”. Car selon elle, sous sa forme actuelle, cette taxation pourrait entraîner “une augmentation déraisonnable des coûts de la taxe, pouvant atteindre jusqu’à 400 fois le montant actuel de celle-ci”. Deux exemples spectaculaires Nous avons interrogé l’EBAA sur cet enchérissement, effectivement disproportionné tel qu’annoncé. Et nous avons obtenu une réponse assez édifiante… Deux exemples nous ont été donnés que nous reproduisons ici : Montpellier / Libreville en Global Express ou Falcon 7X comprenant 14 passagers. Prix actuel : 135.000€. Taxe à 3.000€ * 14 = 42.000€ de taxes supplémentaires (en plus des taxes déjà appliquées aujourd’hui : TSBA, TNSA, TA…). Soit une augmentation de plus de 30% du prix du trajet. Mais c’est finalement dans le cas d’un vol domestique à 3 segments que l’impact de la taxation supplémentaire se fait le plus durement sentir… La Roche-sur-Yon / Lyon / Auxerre / La Roche-sur-Yon : prix actuel : 11.000€ (incluant donc la TBSA actuelle)... A bord d’un turboréacteur de type Phenom 100 ou Citation Mustang. 4 passagers * 3 segments = 12 taxes à 600€ soit 7.200€ de taxes TSBA… à comparer avec les 11.000€ du vol, soit 70% du prix du vol. A bord d’un turbopropulseur de type PC 12 de 6 ou 8 places passagers, 18 ou 24 taxes à 600€ soit de 10.800€ à 14.400€ de taxes TSBA à comparer avec les 11.000€ du vol, soit de 100% à 130% du prix du vol. 100.000 emplois Dès lors, l’EBAA parle de “conséquences désastreuses”, allant jusqu’à la “liquidation de dizaines d’entreprises” de l’écosystème, impliquant “100.000 emplois directs et indirects”. Et propose des pistes pour l’établissement d’un “nouveau barème de taxation, qui permettrait de prendre en compte les objectifs gouvernementaux tout en imposant une charge raisonnable sur l’aviation d’affaires”. Ainsi l’association suggère-t-elle, entre autres : un montant de la TBSA pour son activité deux fois supérieur à celui de la catégorie “Avec Services Additionnels” de l’aviation commerciale régulière, “permettant ainsi une augmentation significative mais juste et supportable”, d’envisager une taxation au niveau européen pour éviter un “désavantage concurrentiel inédit pour les compagnies françaises”, d’assurer la collecte de la taxe auprès de tous les pavillons : que les entreprises étrangères paient aussi cette taxe pour l’ensemble de leurs activités menées sur le sol français.
L’Oréal et Le Louvre proposent un parcours unique du musée pour explorer la beauté à travers l’histoire
Le Musée du Louvre et L'Oréal dévoilent cette semaine une expérience unique : une visite "sur mesure" du musée le plus visité au monde afin d'explorer "la beauté" sous toutes ces formes et selon toutes les cultures.
Bitcoin : Nayib Bukele « nous l’avait dit », son pari BTC rapporte gros au Salvador (+100% !)
Le président Nayib Bukele a constitué une réserve stratégique en Bitcoin au Salvador. Bien lui en a pris : la nation réalise un ROI de +100%.
Les poupées Wicked ou le cauchemar de Noël de Mattel
Le diable se niche vraiment dans les détails. Ou dans la mauvaise relecture d'un packaging. C'est ce qu'a découvert Mattel à son grand désarroi, à quelques semaines de Noël. Ses poupées Wicked, lancées pour la sortie du film du même nom, « préquel » très attendu du « Magicien d'Oz », ont suscité la polémique : l'adresse d'un site Internet mentionné sur ses emballages renvoyait sur un site pornographique au lieu de celui lié au long-métrage. Ce sont les réseaux sociaux qui ont alerté sur le problème, avec la montée en puissance de posts sur le sujet. Le groupe de jouets américains a dû présenter ses excuses pour avoir remplacé WickedMovie.com par Wicked.com. Les poupées sont commercialisées aux Etats-Unis. « Nous regrettons vivement cette malheureuse erreur et nous prenons immédiatement des mesures pour y remédier », a indiqué Mattel dans un message à CNN. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Jeux de construction, licences et peluches portent le marché mondial du jouet L'entreprise conseille aux parents ayant déjà acheté le jouet de jeter l'emballage ou de noircir le nom du site pour adultes. Les poupées ont visiblement été retirées pour l'instant de la vente en ligne, notamment sur les sites d'Amazon ou de Target. En revanche, elles semblent subsister dans certains magasins physiques. Mattel va devoir faire face à des inquiétudes des consommateurs. Sujet ultrasensible Tout ce qui touche aux enfants est particulièrement sensible aux Etats-Unis. Mattel avait dû renoncer en 2017 à commercialiser Aristotle, une enceinte connectée face aux craintes sur la vie privée des enfants. Pour Wicked, il reste à voir ce que va faire le groupe pour commercialiser ses poupées tout en trouvant une solution pérenne pour les packagings concernés. L'enjeu est important à quelques semaines de Noël : le PDG du groupe, Ynon Kreiz avait déclaré en octobre que la société était bien positionnée pour le quatrième trimestre compte tenu de sa gamme d'offres et de lancements, y compris les produits liés à « Wicked » et à « Moana 2 » de Disney. LIRE AUSSI : Jouet : Lego et Nike se lancent dans une collaboration de taille Cette période de l'année est encore plus cruciale que d'habitude pour le groupe après un troisième trimestre ayant enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 4 % et de 3 % à changes constants. Sur les neuf premiers mois de l'année, il était en recul de 2 %. Il reste un gagnant dans cette affaire d'erreur : le site pour adultes Wicked lui-même. Il n'aurait jamais rêvé de bénéficier d'une telle publicité à travers le monde.
« En Ouganda, ce sont les femmes qui se font le plus entendre sur les enjeux climatiques »
Le gouvernement ougandais n'en finit plus de réprimer les activistes climatiques du pays. Après l'arrestation début août de 47 personnes qui marchaient vers le Parlement pour remettre une pétition contre le très décrié méga projet pétrolier EACOP porté par TotalEnergies, la police de Kampala a, de nouveau, arrêté 21 militants, le 26 août. Ils tentaient de rejoindre le Parlement et l'ambassade de Chine – la compagnie chinoise CNOOC est impliquée dans EACOP – pour remettre une nouvelle pétition. Début juin, déjà, l'activiste climatique Stefen Kwikiriza, opposé au projet, avait été enlevé par des militaires en civil, détenu une semaine en un lieu tenu secret, interrogé et passé à tabac avant d'être relâché au bord d'une route de campagne. Face à ces répressions, l'activiste climatique et membre de Fridays for Future Ouganda, Mbabazi Faridah, a répondu aux questions du Point Afrique. Elle alerte sur la répression et les périls environnementaux et climatiques qui menacent son pays alors que s'ouvre la COP29 en Azerbaïdjan. LA NEWSLETTER AFRIQUE Tous les mardis à 16h45 Recevez le meilleur de l’actualité africaine. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. Le Point Afrique : Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir activiste climatique ? Mbabazi Faridah : Mon engagement trouve son origine dans les graves conséquences des changements climatiques dans mon district d'origine, Gomba [en province centrale, NDLR]. En 2009, j'étais âgée de 10 ans. Nous avons été confrontés à des sécheresses prolongées et à de graves inondations qui ont dévasté notre communauté. La chaleur était si intense que l'herbe des pâturages où paissaient nos vaches a pris feu. Nous avons parcouru de longues distances à pied pour trouver de l'eau pour les animaux qui avaient survécu et pour boire. La faim était si forte que certains membres de ma famille n'ont pas survécu. Nous dépendions de l'aide du gouvernement qui envoyait des camions de nourriture, chaque personne ne recevant qu'un kilo de farine de posho et une tasse de haricots, ce qui n'était pas du tout suffisant. Je nous vois encore faire la queue. En cherchant à comprendre ces défis climatiques, j'ai rejoint Fridays for Future Ouganda, dans le cadre de son programme annuel de mentorat pour les jeunes. Il vise à sensibiliser les jeunes Ougandais à devenir des activistes, tout en plaidant en faveur de la justice environnementale et du développement durable. Ainsi, j'ai pu sensibiliser ma communauté à ces questions et à l'importance d'agir. Pouvez-vous rappeler les principaux enjeux climatiques et environnementaux posés par la construction du projet pétrolier EACOP ? Le premier enjeu concerne le déversement d'hydrocarbures. L'oléoduc doit s'étendre d'Hoima, dans l'ouest de l'Ouganda, à Tanga en Tanzanie, traversant des zones sensibles – lacs, rivières et autres sources d'eau – le long de son tracé. Il y a des risques de déversements et de fuites de pétrole, qui pourraient entraîner une contamination du sol et des sources d'eau dans ces régions et, par conséquent, dévaster l'agriculture, nuire à la vie aquatique et affecter l'approvisionnement en eau potable des communautés situées le long du tracé de l'oléoduc. Une exposition prolongée aux polluants provenant de ces déversements ou de fuites potentielles pourrait entraîner de graves problèmes de santé, notamment des problèmes respiratoires et cutanés, pour les populations locales des régions touchées. Ensuite, faciliter l'extraction et le transport des combustibles fossiles va contribuer aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et accélérer le changement climatique. Aussi, la construction du pipeline entraînera probablement le déplacement de communautés [118 000 personnes auraient déjà été expropriées dans des conditions décrites comme « catastrophiques » par de nombreuses associations, NDLR] dans des régions où la population est déjà confrontée à des conditions complexes. Nous avons été confrontés à des sécheresses prolongées et à de graves inondations qui ont dévasté notre communauté L'impact de l'oléoduc sur l'environnement risque d'exacerber les problèmes d'inondation, ce qui entraînera de nouvelles perturbations dans l'agriculture et les économies locales. Les opérations de forage dans le parc national de Murchison Falls [plus de 400 puits sont prévus, dont un tiers dans le parc national, NDLR] vont entraîner une destruction importante de l'habitat, mettant en danger des espèces sauvages telles que les éléphants, les lions et les girafes, et perturbant l'équilibre écologique de cette zone critique. Pour finir, le processus de forage présente des risques pour les sources d'eau locales, notamment le Nil Albert (ou Nil Blanc) et le bassin du lac Albert. La contamination par les produits chimiques et les déchets aura des répercussions sur la faune et les communautés humaines qui dépendent de ces sources d'eau pour la boisson et l'agriculture. À lire aussi Le groupe français Total mis à l'index pour ses activités en Ouganda Le gouvernement mène une répression intense des activistes climatiques, notamment de ceux mobilisés contre le projet EACOP. Comment continuer la lutte ? Beaucoup de gens ont été trompés sur ce projet EACOP. Il est triste que ses dangers n'aient pas été portés à la connaissance de la population. Les gens n'ont aucune idée de ce projet EACOP, on leur a menti en leur disant qu'il s'agissait d'un petit oléoduc qui leur serait bénéfique, et certains ont été trompés par de fausses promesses d'emploi. Heureusement, de très nombreuses personnes sont moins compatissantes et sont sorties pour parler de ce sujet. Mais elles ont fini par être arrêtées. Nous, les activistes, voulons être la voix de ces personnes sans voix qui n'ont aucune idée de l'EACOP. Nous arrêter ne nous empêchera pas de dire la vérité. Malgré les efforts déployés pour nous réduire au silence, nous restons déterminés à nous exprimer. La suppression de la vérité est inacceptable lorsque les écosystèmes sont en danger et que la vie des gens est menacée. L'arrestation récente de militants, dont des membres de Students Against EACOP et de Project Affected Persons (PAPs), alors qu'ils voulaient seulement remettre une pétition contre EACOP, souligne l'urgence d'agir et de faire preuve de transparence. Ils sont actuellement détenus à la prison de Luzira dans l'attente d'une libération sous caution. À lire aussi Climat : « Il faut mettre en exergue la spécificité de l'Afrique » Le rapport « Survivre à EACOP », de l'Observatoire des multinationales, démontre que les femmes sont les premières à souffrir de ce projet. Comment l'expliquez-vous ? En Ouganda, les femmes sont souvent les premières à subvenir aux besoins de leur famille. La construction de EACOP déplace de nombreuses femmes de leur maison et de leur ferme, augmentant ainsi leur fardeau. Les déplacements obligent les femmes à vivre dans des conditions dangereuses et réduisent leur accès aux moyens de subsistance et aux ressources traditionnelles, ce qui les enfonce encore plus dans la pauvreté. En outre, le processus d'indemnisation de l'EACOP favorise souvent les hommes. Il en résulte des risques accrus de violence et d'exploitation, ainsi que des séparations familiales dues à une mauvaise gestion des fonds. Nous, les activistes, voulons être la voix de ces personnes sans voix qui n’ont aucune idée de l’EACOP Paradoxalement, ce sont les femmes qui se font le plus entendre sur les enjeux climatiques et environnementaux dans le pays. L'exclusion des femmes des processus de prises de décision contribue à expliquer pourquoi les femmes des jeunes générations prennent la tête de l'activisme climatique. Des leaders comme Vanessa Nakate et Nakabuye Hilda en Ouganda ont inspiré de nombreuses jeunes femmes à se lever et à plaider pour le changement. Leur voix et leurs actions nous ont donné les moyens de rejoindre le mouvement et d'avoir notre propre impact. Par exemple, le projet « Jeunes femmes pour l'agriculture et l'égalité des sexes » de Fridays for Future est une excellente initiative qui, non seulement, enseigne aux femmes des pratiques durables, mais leur offre aussi des plateformes pour s'impliquer et se faire entendre. En créant ces opportunités, on contribue à amplifier nos voix et à garantir que les femmes et les filles jouent un rôle central dans la lutte contre la crise climatique. À lire aussi Fonds vert pour le climat : enfin plus utile à l'Afrique ! Peut-on considérer que la mauvaise gestion des décharges publiques est une nouvelle bombe environnementale de plus, qui menace votre pays ? Après de fortes pluies, la principale décharge publique de Kampala, Kiteezi [dans la banlieue nord de la capitale, NDLR], qui accueille 1 500 tonnes de déchets par jour, s'est effondrée sur des habitations, tuant au moins 35 personnes selon un bilan largement sous-évalué. La gestion des déchets en Ouganda est une préoccupation essentielle. Le gouvernement a proposé l'incinération des déchets pour la décharge de Kiteezi, mais cette approche présente de sérieux inconvénients. Elle peut accroître la pollution de l'air en libérant des toxines nocives, ce qui exacerbe la crise climatique au lieu de l'atténuer. En outre, cette méthode présente des risques pour la santé en raison des émissions de polluants et des dangers qu'elle comporte. Cette situation est particulièrement décourageante compte tenu de l'impact tragique de la catastrophe de la décharge de Kiteezi, où plus de 35 personnes ont perdu la vie, certaines n'ayant toujours pas été retrouvées. La zone est en proie à des odeurs nauséabondes et les survivants, qui vivent désormais sous des tentes, sont confrontés à des problèmes de santé, en raison de l'insalubrité des lieux. Mais ce problème ne se limite pas à Kiteezi. La gestion des déchets en Ouganda est une préoccupation essentielle Kampala, comme le reste du pays, est submergée de déchets, qui sont souvent déversés de manière inappropriée dans divers endroits, ce qui contribue aux problèmes d'environnement et de santé publique. Et la situation s'aggrave de jour en jour. La pollution atmosphérique et plastique contribue au changement climatique et nuit à l'écosystème. La présence de produits chimiques dangereux et de métaux lourds dans les déchets contamine et dégrade la qualité des sols et constitue une menace importante pour la santé des plantes et des êtres humains. Ensuite, la décomposition des déchets organiques produit des gaz à effet de serre, tels que le méthane, qui contribuent au changement climatique. Nous, activistes, plaidons pour une stratégie de gestion qui donne la priorité au recyclage, à la réutilisation et à la réduction des déchets. Ces pratiques offrent une approche plus durable et peuvent contribuer à résoudre les problèmes environnementaux plus vastes auxquels nous sommes confrontés. À lire aussi One Forest Summit : après la feuille de route, le plus dur reste à faire À découvrir Le Kangourou du jour Répondre Comment jugez-vous l'action du gouvernement en matière d'environnement ? L'approche du gouvernement en matière de climat et d'environnement laisse sérieusement à désirer. La crise actuelle de la décharge de Kiteezi met en évidence cet échec : des corps restent enfouis sous des tas d'ordures, et les déchets eux-mêmes ont été laissés sur place depuis l'incident. Bien que les politiques aient été témoins de cet incident, des tas de déchets sont encore déversés dans la ville, mais rien n'est fait. Ce mépris flagrant révèle un profond niveau de négligence et d'inefficacité dans la résolution des problèmes environnementaux et climatiques. Mais c'était déjà le cas en 2019, lorsque le niveau des eaux du lac Victoria a commencé à augmenter et inonder le marché de Ggaba [situé dans un quartier de Kampala qui borde le lac, NDLR]. Une partie des 2 000 vendeurs du marché sont partis et travaillent désormais sur le bord de la route, tandis que d'autres se sont tournés vers d'autres activités et ont quitté le marché en raison des inondations persistantes qui ont submergé les stands. Les politiciens, le gouvernement et la Kampala Capital City Authority (KCCA) sont tous restés silencieux. Alors même que des déchets sont déversés dans les canaux d'eau, y compris des déchets humains, que le nombre d'espèces de poissons a diminué et que l'augmentation du niveau de l'eau a conduit à la destruction des habitations. Une planification et une gestion inadéquates, de mauvais contrôles environnementaux et un manque d'entretien ont contribué à la crise humaine et environnementale actuelle. L'absence de consultation des communautés concernées et de mise en œuvre de réglementations environnementales strictes met en évidence un problème systémique profond. Nous avons besoin de réformes urgentes et globales pour remédier à ces défaillances et prévenir d'autres dommages.

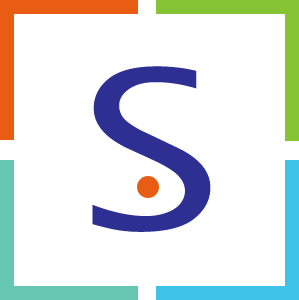 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.






