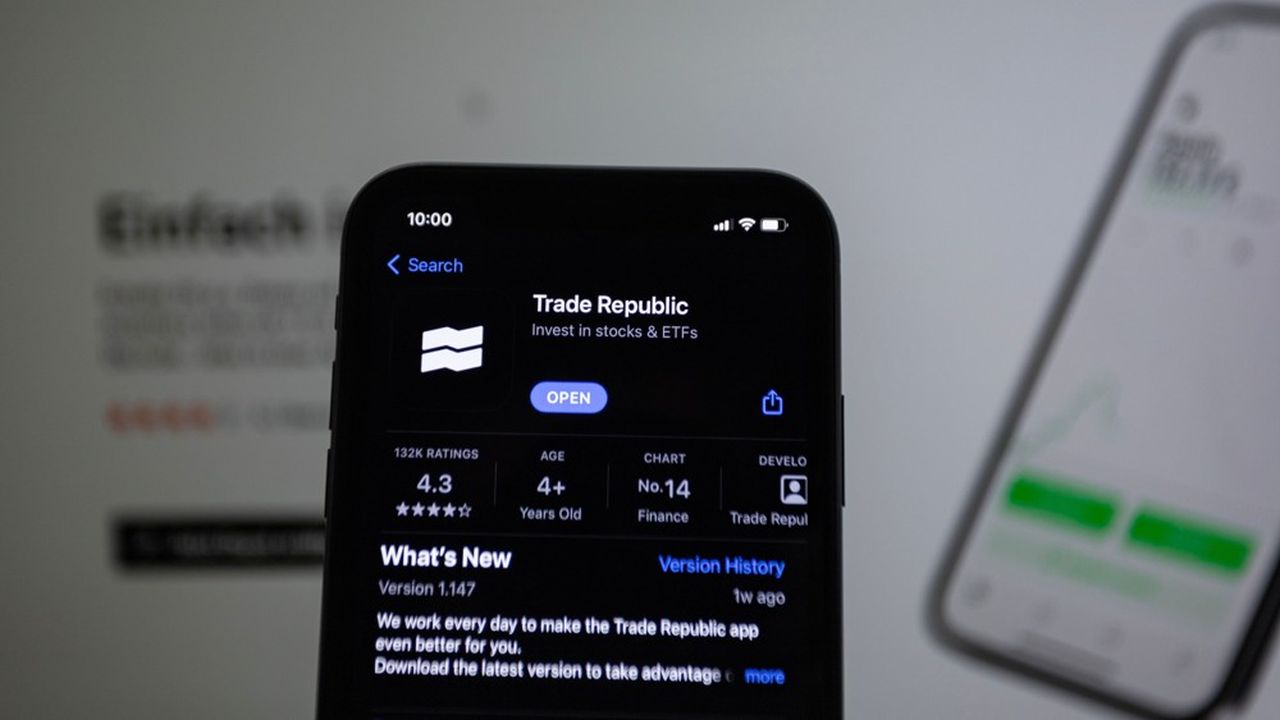Les émissions de carbone de Google explosent à cause de l’IA
L'avènement de l'IA pourrait devenir une épine dans le pied des géants de la tech. Les émissions de carbone de Google ont augmenté de près de moitié (48 %) depuis 2019, en majeure partie à cause de ses avancées dans l'intelligence artificielle, d'après son rapport annuel publié mardi. Et le plus grand moteur de recherche du monde n'est pas le seul : en mai dernier, c'est Microsoft qui affichait une hausse de 30 % de ses émissions en trois ans, largement portée par l'IA. Google, qui vise la neutralité carbone en 2030, voit son objectif s'éloigner à mesure que ses investissements s'accélèrent. Le géant de Mountain View a émis quelque 14,3 millions de tonnes équivalent CO2 en 2023, soit 13 % de plus que l'an dernier. La hausse des émissions de Google pendant quatre années consécutives coïncide parfaitement avec ses investissements, de plus en plus massifs, dans le secteur de l'IA. « À mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile », reconnaît Google. Rien qu'entre janvier et mars 2024, il a investi 12 milliards de dollars dans cette nouvelle technologie, véritable coqueluche de la Silicon Valley. Un pari qui s'est par ailleurs révélé payant sur les marchés pour l'entreprise, dont la capitalisation boursière tutoie les 2.300 milliards de dollars aujourd'hui. Le titre a pris plus de 33 % depuis le début de l'année, et près de 60 % sur la seule année 2023. Consommation sans fin Une grande partie du rapport environnemental de Google explique que l'IA est en elle-même, à terme, un moyen d'atténuer le réchauffement climatique en réduisant de « 5 à 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2035 ». Un discours globalement mis en avant par les entreprises de la tech, mais qui cache une réalité moins reluisante : l'intelligence artificielle est une technologie incroyablement consommatrice en électricité et en eau. L'entraînement des grands modèles d'IA demande une très importante puissance de calcul apportée par des data centers qui tournent sans arrêt, tandis que les hangars doivent être refroidis, nécessitant énormément d'eau . LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Climat : les émissions cachées de l'intelligence artificielle INTERVIEW - « Avec l'intensification de l'IA, c'est un tsunami de carbone qui se prépare » « Un data center de Google est, en moyenne, environ 1,8 fois plus économe en énergie qu'un centre de données d'entreprise classique, assure l'entreprise. Par rapport à il y a cinq ans, nos centres de données fournissent près de quatre fois plus de puissance de calcul avec la même quantité d'énergie électrique. » Même si les technologies s'améliorent, la question de la consommation de ces hangars géants inquiète : elle tire à la hausse la demande d'électricité et pourrait même dépasser, dans certains Etats comme l'Irlande ou l'Arabie saoudite, la capacité de production du pays en électricité quand tous les nouveaux data centers seront achevés, d'après les estimations de Bloomberg.
Opinion | L’intelligence artificielle ne peut faire l’économie de l’humain
La tenue, actuellement, à la Cinémathèque française, d'une rétrospective consacrée au cinéaste visionnaire James Cameron , fasciné par l'intelligence artificielle, nous donne l'occasion de nous interroger sur la manière dont les entreprises doivent aborder cette technologie. En particulier, quelle est la place de la responsabilité humaine dans l'équation ? La révolution numérique façonne nos sociétés et si l'émergence de l'intelligence artificielle est une étape d'un continuum, il est cependant impossible de nier qu'elle constitue un tournant décisif. Cette technologie est intrinsèquement porteuse de risques, sur le plan éthique, pour nos concitoyens. Ainsi, la réguler est indispensable, d'autant plus avec le développement exponentiel de l'IA générative. Un potentiel indéniable L'Europe a su, la première, se saisir du sujet avec l'AI Act , législation inédite au niveau mondial. Devant être publiée mi-juillet, elle encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle, et plus précisément ses cas d'usage, à partir d'une classification définissant quatre niveaux de risque , sans pour autant entraver son développement, préservant ainsi l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes. LIRE AUSSI : IA : la Cour des comptes européenne fustige le manque d'investissement de l'UE INTERVIEW - IA : « L'Europe doit rester dans la course » La rétrospective que j'évoquais en préambule nous montre que l'usage que nous faisons de la technologie relève de la seule responsabilité humaine. Il y a bien plus longtemps, Rabelais, déjà, écrivait que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je suis convaincu que l'intelligence artificielle est un facteur de rupture et que son potentiel est considérable, par exemple dans le secteur de l'assurance . Elle peut notamment faciliter l'automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée et permettre aux équipes d'être toujours plus efficaces dans leurs missions de protection et d'accompagnement des assurés. Et l'humain ? Cependant, une question demeure essentielle : quelle place donner à l'humain , dans le développement des différents systèmes, d'une part, et dans leur déploiement, d'autre part ? LIRE AUSSI : TRIBUNE - IA Act : l'Europe est un exemple, à défaut d'être un modèle Si le cadre européen interdit les systèmes d'intelligence artificielle qui présentent des risques inacceptables, il donne une place à l'humain pour encadrer ceux à haut risque en prévoyant, parmi les exigences, la mise en place d'une « garantie humaine » (human oversight). Elle consiste à appliquer une supervision humaine sur des points identifiés comme critiques dans la phase de conception mais aussi d'utilisation des systèmes. L'IA dans le secteur assurantiel Dans le secteur de l'assurance, la majorité des usages de l'intelligence artificielle ne sont pas classés à haut risque. En tant que groupe mutualiste, nous sommes convaincus de son potentiel mais aussi de la dimension éthique du sujet. Ainsi, ma conviction est que nous devons, quoi qu'il en soit, nous saisir du concept de garantie humaine pour porter une approche humaniste du sujet. En effet, la notion de garantie humaine engage l'entreprise dans son utilisation de l'intelligence artificielle . L'entreprise sera redevable, notamment auprès des autorités de régulation, du cadre de garantie humaine mis en place au travers d'éléments qui pourront être reportés et audités. La transparence, la responsabilité des entreprises, introduites par la garantie humaine, en termes de compétences techniques et de formation, sont essentielles. LIRE AUSSI : EXCLUSIF - Comment le capital humain est devenu indissociable de la performance de l'entreprise Face aux inconnues, nombreuses, véhiculées par cette technologie et au risque de dérives éthiques , je suis convaincu que la garantie humaine et le cadre réglementaire sont une opportunité de la faire prospérer de façon équilibrée, dans le respect des droits humains et de la vie privée. En renforçant la confiance entre les entreprises, notamment du secteur assurantiel, et les consommateurs, et plus largement les citoyens, nous avons une opportunité de bâtir un modèle au service du progrès et du bien commun.
Trade Republic, la fintech qui réconcilie les Européens avec la Bourse
Ce n'est pas l'approche des Jeux Olympiques ou Roland Garros qui les ont amenées à Paris cette année. Venus et Serena Williams ont fait sensation au salon VivaTech, accueillies telles des rock stars sur la scène du Dôme de Paris, pour parler finances et investissement en Bourse. Les deux soeurs, désormais éloignées des courts, sont les égéries de Shares, l'un des derniers néocourtiers à se lancer en France. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la Bourse. La chute des cours durant la panique boursière de mars 2020 a poussé des centaines de milliers de jeunes épargnants à se lancer pour la première fois sur les marchés. C'est notamment le cas de Benjamin Chemla, le serial entrepreneur qui a fondé Shares après avoir créé Stuart, un pionnier de la logistique du dernier kilomètre cédé à La Poste en 2017. « En France, le marché est en pleine explosion, il y a un véritable enjeu de captation d'un nouveau public », explique-t-il. « L'espace se creuse entre les courtiers à l'ancienne et les néocourtiers ». Grâce aux soeurs Williams, associées par un contrat d'image avec sa jeune marque, Shares a bénéficié d'un coup de projecteur dont rêverait n'importe quelle fintech. Un marché potentiel immense Si les deux célébrités ont accepté de se joindre à l'aventure, c'est que le potentiel est immense. Les Européens - et les Français ne font pas exception - épargnent énormément, mais sont relativement peu présents sur les marchés. Fin 2022, ils conservaient près de 14.000 milliards d'euros, soit 40 % de leur patrimoine financier, sur leurs comptes bancaires, selon l'EFAMA, le lobby des sociétés de gestion européennes. Mais les choses commencent à changer, en particulier en Allemagne, qui a vu naître certaines des fintechs les plus accomplies du Vieux Continent. Le plus grand néocourtier d'Europe, Trade Republic, s'y est lancé en 2019. Cinq ans plus tard, la jeune pousse berlinoise s'est imposée comme l'une des principales plateformes d'investissement continent. Arrivée en France en 2021, la fintech allemande y compte déjà plus de 550.000 clients, selon nos informations, ce qui en fait l'un des premiers acteurs du pays. Trade Republic, aujourd'hui présent dans 17 pays, a conquis plus de 5 millions de clients avec une promesse simple : démocratiser l'investissement en Bourse en supprimant la quasi-totalité des frais associés au trading. La fintech allemande prélève un frais fixe de 1 euro par transaction, quel que soit le nombre de titres concerné. Une vraie révolution par rapport aux acteurs traditionnels dont les frais augmentent selon la taille des transactions. « Nous essayons d'automatiser au maximum et de développer notre technologie en interne », explique Christian Hecker, le fondateur de Trade Republic, dans ses bureaux berlinois. Il a créé la société en 2015 dans un incubateur de start-up de la Commerzbank à Munich avec Thomas Pischke et Marco Cancellieri, rencontrés quelques mois auparavant lors d'un « hackathon ». Le coût d'une transaction peut grimper jusqu'à 1,2 euro dans une banque, nous l'avons fait descendre à quelques centimes. Christian Hecker Cofondateur de Trade Republic Les trois cofondateurs se rendent compte que la manière dont les banques traitent les ordres de Bourse est inefficiente, entre les vérifications manuelles et les divers sous-traitants impliqués. « Le coût d'une transaction peut grimper jusqu'à 1,2 euro dans une banque, nous l'avons fait descendre à quelques centimes », se félicite-t-il. Trade Republic se voit avant tout comme une entreprise tech. L'internalisation de l'infrastructure technologique sur l'ensemble de la chaîne de valeur reste un facteur différenciant face à ses concurrents. L'autre aspect essentiel de son modèle est son application épurée, très simple d'utilisation, permettant à n'importe qui d'investir facilement à partir de son smartphone.
Elicit Plant, l’entreprise qui rend les cultures moins gourmandes en eau
Si les cieux sont plutôt généreux en pluie depuis le début de l'année, permettant aux agriculteurs de connaître une rare et relative sérénité, cette parenthèse humide ne saurait occulter la tendance de fond. Alors qu'il faudra nourrir près de 10 milliards d'individus d'ici la fin du siècle, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) affirme que, du fait de la multiplication des sécheresses, les rendements agricoles dans le monde ont baissé de 25 % entre 1961 et 2006. Le réchauffement climatique renforce bien évidemment cette dynamique et les agriculteurs ne s'y trompent pas, comme le montre une récente étude du géant allemand de la chimie Bayer réalisée auprès de 500 exploitants du monde entier. Ceux-ci, à une écrasante majorité, plaçaient la sécheresse au premier rang de leurs préoccupations, loin devant l'augmentation des températures ou la présence de nuisibles. Cependant, l'espoir reste permis. Olivier Goulay, Jean-François Déchant et Aymeric Molin,Elicit Plant Depuis quelques décennies, la littérature scientifique s'intéresse à une variété de molécules présentes naturellement au sein des plantes, les phytostérols. Ces lipides, résidant dans les membranes des cellules, jouent un rôle dans la croissance des plantes et dans leur défense contre le stress, notamment hydrique. Mais personne n'avait encore réussi à trouver la formulation pour faire pénétrer cette molécule dans les plantes et augmenter ainsi artificiellement le taux de phytostérols, afin de booster leurs défenses et leur croissance. Jusqu'à ce qu'Olivier Goulay, cadre d'un laboratoire travaillant pour le secteur de la cosmétique et utilisant ces précieux lipides, parvienne enfin à mettre au point la bonne recette. Il comprend alors très vite le potentiel colossal de son produit pour l'agriculture et s'allie avec l'entrepreneur Jean-François Déchant et l'ingénieur agronome Aymeric Molin pour fonder la société Elicit Plant en 2017. L'équipe de la jeune pousse installe dans la ferme charentaise d'Aymeric Molin trois laboratoires de chimie, de biologie et d'agronomie pour développer leurs solutions au plus près des cultures. Pendant plusieurs années, ils potassent leurs recettes à l'abri des regards. 300.000 hectares couverts dans le monde Et la sortie de l'anonymat est spectaculaire. En 2021, la société obtient sa première autorisation de mise sur le marché pour son produit destiné à la culture du maïs. En 2022, elle lève pas moins de 16 millions d'euros auprès de Sofinnova Partners, Bpifrance, ECBF, Naco, Crédit Agricole CPE et la région Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la commercialisation de sa solution. Deux ans plus tard, ses produits sont utilisés sur 300.000 hectares dans le monde, en France, au Brésil, en Ukraine et dans d'autres pays européens, et elle vient récemment de recevoir les autorisations nécessaires pour accéder au marché américain dans quelques Etats de la « corn belt ». Voici la fiche d'identité de ces biostimulants au succès foudroyant, dont le principal atout est d'améliorer la croissance des plantes en les rendant résilientes à la sécheresse. LIRE AUSSI : Sand to Green, cette start-up qui sème dans le désert Agriculture régénératrice : Intact, une nouvelle filière ambitieuse dans le Loiret « Nous identifions le type de phytostérols que nous voulons dans les plantes, puis nous les extrayons avant de les formuler dans nos produits afin qu'ils puissent pénétrer dans la plante en plein champ, résume Jean-François Déchant, PDG et cofondateur d'Elicit Plant. Notre formulation spécifique, une suspo-émulsion, permet de pulvériser le produit sur la plante afin qu'il soit absorbé par les feuilles. » La start-up a développé une gamme de biostimulants destinés au maïs, au tournesol et à diverses céréales dont le blé et, surtout, l'orge de printemps. « Nous ciblons en priorité les grandes cultures d'été, gourmandes en eau, assume le dirigeant. Si l'on veut sauver la planète, c'est par là que l'on doit commencer. » A l'échelle du globe, ces cultures représentent près de 90 % des surfaces agricoles - hors prairies et pâturages - et 25 % du territoire en France - dont la majorité, dans l'Hexagone, ne sont pas irriguées. D'où l'importance de cette solution, à mi-chemin entre le vaccin et l'immunothérapie, pour rendre les plantes plus résilientes à la sécheresse. Naturel mais pas (encore) bio Les produits d'Elicit Plant agissent sur les plantes de plusieurs manières. Déjà, en accroissant les racines des végétaux, ils permettent à ceux-ci d'étendre la zone où ils peuvent puiser de l'eau. En outre, en cas de stress hydrique, la molécule limite l'ouverture des stomates - l'équivalent feuillu des pores de notre peau - afin de restreindre l'évapotranspiration de la plante, qui conserve ainsi l'eau à son usage. Un atout majeur, quand on sait que le maïs, par exemple, peut évacuer en transpirant jusqu'à 98 % de l'eau qui lui est donnée ! Résultat, les cultures testées présentent en moyenne une augmentation de 10 % des rendements et une économie de 20 % dans l'usage de l'eau. Pour l'agriculteur, l'usage du produit est simple. Vendu en bidon de 5 ou 10 litres, « il s'insère parfaitement dans l'itinéraire technique de l'exploitant qui peut l'appliquer avec son pulvérisateur », assure Jean-François Déchant. Il suffit de répandre le produit préventivement une seule fois au début du cycle de croissance de la plante, à raison d'un litre par hectare. Le tout pour un coût d'environ 40 euros/ha, avec un retour sur investissement moyen de trois fois la somme engagée pour le traitement grâce à la hausse des rendements et à l'économie en eau. En outre, il n'interfère pas avec les autres traitements utilisés sur les parcelles. Elicit Plant La recette exacte du produit est un secret bien gardé, mais Elicit Plant assure qu'il est composé à 99 % d'ingrédients naturels : les phytostérols et deux autres composants d'origine végétale. « Notre biostimulant a été classé sans risque pour l'environnement et la santé humaine par plusieurs agences de réglementation, en Ukraine, aux Etats-Unis ou encore par l'Anses en France, se réjouit le PDG de la société, grâce à des dossiers scientifiques très complets étudiant l'absence d'effet du produit sur l'environnement et la santé. » En revanche, les conditions d'extraction des phytostérols ne permettent pas pour l'instant son usage en agriculture biologique, mais la start-up assure travailler sur un nouveau produit compatible avec les normes du bio. La vigne et le soja ciblés Pour la gestion du cycle de l'eau, en revanche, l'impact de ce biostimulant pourrait être important si le produit venait à être généralisé, en limitant le recours à la ressource en eau pour les cultures irriguées ou en cas de sécheresse. En revanche, pour le moment, l'utilisation de cette molécule ne permet pas de se substituer aux produits phytosanitaires, qui agissent pour éliminer les nuisibles et non renforcer la plante. Mais la donne pourrait changer dans l'avenir, car Elicit Plant travaille à une nouvelle formulation qui pourrait permettre de limiter, pour certains végétaux, l'usage des fongicides. LIRE AUSSI : French tech : les start-up à l'assaut de l'adaptation au changement climatique Si la conception et la formulation de ses produits prennent place dans la ferme-laboratoire de Moulins-sur-Tardoire (16), la production industrielle est assurée par l'usine française Phyteurope, propriété du groupe Bioline by InVivo. Aujourd'hui, la start-up de 80 salariés fournit quelque 150 clients dans le monde entier, dont les coopératives françaises Axereal, Océalia, Dijon Céréales ou encore Maïsadour. Et la jeune pousse croît toujours plus vite. Elle prépare une nouvelle levée de fonds de 40 millions d'euros, afin de développer son réseau de distribution dans le monde entier - coopératives ou négoces -, et planche au développement de nouveaux produits à destination du soja brésilien ou de la vigne française. Une manière de résoudre la quadrature du cercle et concilier durablement rendements agricoles, sécheresse et ressource en eau ?
A la SNCF, le réchauffement climatique est devenu un sujet d’état-major
Voies inondées, obstruées par des éboulements ou des chutes d'arbres, surchauffe de rails, incendies, déstabilisation des sols ou des ouvrages d'art après de fortes pluies, défaillance de l'alimentation électrique en cas de canicule ou de tempêtes… Pour la SNCF, l'impact potentiel du réchauffement climatique est loin d'être neutre. Si l'entreprise ferroviaire nationale est habituée de longue date à gérer les aléas climatiques, la multiplication prévisible des événements extrêmes a conduit les hautes sphères du groupe à se saisir sérieusement du sujet. Coût élevé des sinistres climatiques « Jusque-là traitée comme une question technique, l'adaptation au réchauffement climatique est devenue un sujet de direction générale il y a environ deux ans. Mais c'est un immense chantier », indique Vivian Dépoues, spécialiste du sujet au sein de I'Institut de l'économie pour le climat. Chez SNCF Réseau, principale entité du groupe concernée, le programme a été confié à Alain Quinet, directeur général exécutif en charge de la stratégie. La Cour des comptes a rappelé en mars dernier, dans un rapport sur l'adaptation au réchauffement du réseau ferroviaire , que les sinistres liés à la météo pouvaient coûter cher : près de 18 millions d'euros par an entre 2019 et 2022 - sans parler des pertes d'exploitation liées à la fermeture temporaire de lignes. Les dégâts causés par la seule tempête Alex d'octobre 2020 dans la vallée de la Roya ont coûté 25 millions d'euros à SNCF Réseau, indiquent les Sages. LIRE AUSSI : Le gouvernement peaufine son plan d'adaptation de la France à un réchauffement de 4 °C DECRYPTAGE - Adaptation au changement climatique : le manque d'objectifs clairs montré du doigt Ces chiffres ne reflètent toutefois que le passé, sans augurer l'impact d'un réchauffement de 4° C à horizon 2100, désormais considéré comme le scénario de référence en France - en tout cas, dans le plan que le gouvernement devait présenter ces jours-ci, une présentation reportée sine die en raison de la situation politique. L'entreprise ne part pas de zéro. De nombreuses actions sont déjà mises en oeuvre, avec une accélération ces dernières années. « Nous avons mis en place par exemple des systèmes d'alerte avec des objets connectés, pour mesurer les crues, la surchauffe des rails ou les seuils limite de pluviométrie, qui nous permettent d'adapter la vitesse ou la circulation des trains », indique Benoît Chevalier, directeur des projets d'adaptation chez SNCF Réseau. Eviter un rétrofit systématique Le budget consacré au débroussaillage à proximité des voies, pour éviter les incendies en cas de vague de chaleur, a grimpé de 50 millions d'euros dans les années 2010, à plus de 200 millions aujourd'hui. « Et il va continuer à augmenter », indique le responsable. De même que le budget lié au curage des fossés, pour limiter les conséquences des épisodes cévenols de pluies intenses. Autre exemple, la SNCF travaille désormais avec Météo France et interrompt maintenant la circulation des trains si la vitesse prévisible des vents dépasse un certain seuil. La mise en place d'un projet spécifique sur l'adaptation va permettre d'inscrire ces actions dans un véritable plan stratégique. « Nous en avons déjà acté les grands principes, indique Alain Quinet. Nous voulons notamment éviter de nous lancer dans un rétrofit systématique, qui serait trop coûteux : nous devons intégrer l'adaptation dans l'enveloppe de renouvellement du réseau, qui a déjà été augmentée. » LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - SNCF : Réseau, le sempiternel maillon faible du groupe L'Etat et la SNCF proches d'un accord sur la modernisation du réseau ferroviaire Le gouvernement a annoncé l'an dernier un vaste investissement de 100 milliards d'euro s dans le ferroviaire, destiné notamment à moderniser le réseau. Et Bruno Le Maire, qui avait demandé à toutes les grandes entreprises publiques (SNCF, EDF, RTE, etc.) de lui présenter leur plan d'adaptation d'ici la fin de 2024, avait bien précisé qu'il était pour cela « inutile de toquer à la porte du ministère des Finances ». SNCF Réseau a commencé par lancer de grosses études de vulnérabilité à un réchauffement de 4° C. Celui-ci est aussi désormais pris en compte lors des investissements : nouvelles lignes, renouvellement des rails ou des caténaires. « Et ce, en fonction de leur durée de vie : 30 ans pour les rails, 60 à 70 ans pour les caténaires… », précise Alain Quinet. Vétusté des équipements L'entreprise travaille aussi à la mise en place d'outils centralisés de suivi des coûts liés aux aléas climatiques : prévention, réparation des équipements, mais aussi pertes d'exploitation liées à l'annulation ou aux retards des trains. « L'objectif est d'être prêts fin 2024 », indique Benoît Chevalier. Déplorant, par exemple, la vétusté de certains équipements (elle cite notamment le réseau des télécommunications ferroviaires, qui compte encore 33.000 kilomètres de fils de cuivre souvent mal isolés et sensibles aux inondations), la Cour des comptes a insisté dans son rapport sur la nécessité de mettre en place un « pilotage stratégique plus structuré », comprenant un véritable plan d'action et d'investissements, qui restent donc à chiffrer. Ce plan nécessitera une « forte implication des pouvoirs publics », car ce sont eux qui devront définir quelle résilience l'Etat attend du réseau ferroviaire, rappellent aussi les Sages. « Nous souscrivons totalement aux recommandations de la Cour des comptes », répond Alain Quinet. L'annonce d'un tel plan risque de prendre encore un peu de temps.
Nespresso repousse les frontières du luxe pour assurer sa rentabilité
Le petit noir n'a plus le monopole du marché du café. Dans de nombreux pays, sous l'influence américaine, le café latte, le cappuccino, les versions glacées voire aromatisées font florès. Le soluble et le café filtre n'ont pas dit leur dernier mot. Et le café en grain connaît une nouvelle jeunesse. Dans cet environnement hypersegmenté et ultra-concurrentiel , les dosettes jouent une partie très complexe. En France, où « les compatibles Nespresso » ont connu un très beau développement jusqu'à s'arroger aujourd'hui la moitié du marché en grande surface, très loin devant toutes les autres catégories, les ventes ont reculé de 1,6 % en 2023 et encore de 2,2 % en 2024, au 19 mai en volume, selon Circana. En valeur, les progressions respectives sont de +6,6 % et -0,6 % cette année. L'inflation n'est pas étrangère à la situation. La baisse de pouvoir d'achat et les préoccupations environnementales non plus . Pas de boutiques supplémentaires Dans ce décor mouvementé, Nespresso, qui n'est pas commercialisé par les enseignes, a notablement enrichi sa stratégie de développement. Celle-ci ne passera pas par l'ouverture de boutiques supplémentaires en France, alors qu'elles ont longtemps été le fer de lance. En revanche, la filiale de Nestlé, dont l'obsession est le niveau de rentabilité, repousse sans arrêt les frontières du haut de gamme quitte à jouer la carte du luxe. Les éditions limitées font partie du registre. LIRE AUSSI : Du Japon à l'Indonésie, l'Asie fait sa révolution du café Comment Starbucks profite de la fièvre du café en Chine Issues de provenances rares ou de petits terroirs, comme Jamaïcan Blue Mountain et Galapagos, ces dosettes sont proposées à des prix cinq fois supérieurs aux gammes classiques à 2,50 euros l'unité. Nespresso n'a pas hésité à consacrer vingt ans de recherche à la mise au point de l'une de ces éditions limitées : la « Numéro 20 » issue de mélanges colombiens, mise au point par Alexis Rodriguez, un microbiologiste spécialisé en biostatique devenu le grand ordonnateur du goût et des assemblages de café chez Nespresso à Romont, en Suisse. R&D et dégustations Alexis Rodriguez et ses 17 collaborateurs sont chargés de la R&D chez Nespresso. Ils sélectionnent et évaluent les cafés verts, puis développent les produits. L'équipe goûte 300 tasses de café par jour en deux séances. Ils recommencent l'exercice, à raison de 60 tasses dans une journée, lorsque les dosettes sortent des trois usines suisses où elles sont fabriquées pour le monde entier. « En moyenne par semaine, nous dégustons 1.750 tasses », affirme Alexis Rodriguez. Des exercices qui ne vont pas sans quelques contraintes. Comme l'interdiction de manger trop épicé ou d'être en contact avec des saveurs et des arômes trop puissants, qui affecteraient leur odorat et leurs papilles. LIRE AUSSI : Nespresso veut rendre plus vert son café en dosette Relancer une croissance qui s'étiole : la nouvelle quête de Nespresso Les éditions limitées sont toutes associées à de gros efforts marketing, soutenues par des chefs étoilés et lancées à des moments particuliers comme la fin de l'année ou de grands événements comme le Festival de Cannes. Elles visent une clientèle très aisée, versatile et sensible à la rareté. Chaque année voit surgir une dizaine de ces éditions limitées. Dans l'esprit haut de gamme aussi, Nespresso a créé une nouvelle machine tout en Inox, Creatista, vendue 500 euros, qui « décline toutes les densités de mousse de lait, chaudes ou froides », comme dans les coffee-shops. Retour du grain… de luxe Dans un environnement caractérisé par des hausses de coûts et une baisse de production, Nespresso n'est pas seul à jouer la carte du luxe. D'autres, parmi lesquels le géant italien Lavazza, jouent plutôt le retour du grain . Une nouvelle tendance émerge, notamment en France avec les cafés en grains de luxe qui déclinent « la complexité aromatique » à la manière du vin et du cacao. Là encore les prix pratiqués visent à en faire des produits d'exception. A Paris, le café Substance propose « une expérience unique de dégustation de cafés rares » torréfiés sur place et préparés en cafetière de verre surmontée d'un filtre. Il se boit sans sucre, ni pâtisserie, ni musique entre 8 euros et 21 euros la tasse. Les paquets de 100 grammes à emporter se vendent entre 19 et 57 euros. Dans le même ordre d'idées, Terres de café propose une gamme de « blends » à 60 euros le kilo et de « grand crus » de 15 à 37 euros les 150 grammes dans ses 8 cafés parisiens.
Sur les îles grecques, le tourisme jusqu’à l’overdose
Nikos Zorzos n'en a pas l'air, mais il fulmine. Amène et souriant, le maire de Santorin écarte soudain les bras en signe d'impuissance, ce dimanche de juin. « J'ai le sentiment d'être un prisonnier. Je veux changer les choses mais je ne le peux pas », explique le sexagénaire, enfoncé dans un siège de son bureau. Voilà plus de dix ans qu'il alerte en vain contre les dangers du surtourisme en Grèce. Né et élevé à Santorin, Nikos Zorzos, 64 ans, ne reconnaît plus son île. Autrefois pauvre et coupé du monde, ce petit bout de terre de l'Egée est devenu l'une des plus célèbres destinations touristiques mondiales. Depuis soixante ans, ses falaises abruptes, son décor volcanique et ses couchers de soleil ont attiré des flots ininterrompus de visiteurs. Avec eux est venue la prospérité. Mais, depuis quelques années, la situation est hors de contrôle. Inaccessible L'île est « saturée », répète depuis 2012 l'élu à qui veut bien l'entendre. L'an dernier, plus d'un touriste sur dix qui s'est rendu en Grèce a mis le pied sur Santorin, soit 3,4 millions de personnes. La construction effrénée d'hôtels, de résidences à louer et de grands complexes immobiliers de luxe a défiguré le paysage. En été, la densité de population - plus de 1.000 personnes au kilomètre carré - rend difficile l'approvisionnement en eau et en électricité. LIRE AUSSI : Niveau de vie : les Grecs tout en bas de l'échelle européenne De Venise à Barcelone : comment les villes luttent contre le surtourisme Les déchets s'amoncellent. Les embouteillages en heure de pointe sont dignes de ceux d'Athènes. La flambée des prix empêche les travailleurs essentiels (médecins, pompiers, policiers, enseignants) de trouver de quoi se loger. L'île est devenue inaccessible à la très grande majorité des Grecs. Pour les quelque 22.000 résidents à l'année, la manne du tourisme ne suffit plus à apaiser. « L'île a perdu tout ce qu'elle avait de traditionnel, et chaque année ça empire », se désole Kostas, qui tient depuis dix-huit ans un restaurant traditionnel - l'un des derniers - sur la principale artère de Thira, la capitale de Santorin. Une « pression suffocante » Même les croisiéristes évitent désormais l'île qui aurait inspiré le mythe de l'Atlantide à Platon. En avril, l'opérateur du « Sun Princess » a notifié à ses clients que le paquebot ne s'y arrêterait finalement pas cet été, en raison de la congestion du port. Santorin « est un problème », a reconnu début juin le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dans une interview à Bloomberg. Elle n'est pas le seul. La Grèce ne doit pas épuiser son potentiel, le gaspiller et rendre nos destinations touristiques peu attractives au fil du temps. Le médiateur de la République hellénique Les îles grecques et leur carte postale de soleil et de mer, de tavernes et de maisons blanchies à la chaux, font l'objet d'une « pression suffocante », écrit le médiateur de la République hellénique. Dans un rapport de 170 pages publié en juin, l'autorité indépendante tire la sonnette d'alarme et prévient que la Grèce « ne doit pas épuiser son potentiel, le gaspiller et rendre nos destinations touristiques peu attractives au fil du temps ». Mykonos et Santorin, mais aussi Amorgos, Rhodes, Corfou, Zakynthos, Tinos… le surtourisme et ses problématiques - surconstruction, saturation des aires urbaines, perte d'identité et du patrimoine, dégradation de la qualité de vie des habitants - touchent désormais, de près ou de loin, les plus populaires des îles grecques. Trois mois par an Ce constat n'a, à première vue, rien d'évident à Piso Livadi. La saison débute à peine et les touristes parviennent encore à se ménager une place à l'ombre sur la plage de ce petit port de Paros, en plein coeur des Cyclades. L'île compose, avec 33 autres, cet archipel de la mer Egée connu dans le monde entier pour ses maisons blanches aux volets bleus si caractéristiques. LIRE AUSSI : « Surtourisme » : les pistes des géants du secteur pour limiter les nuisances Surtourisme : Barcelone dit stop aux locations saisonnières La tranquillité de Piso Livadi est trompeuse. Paros est l'une des îles grecques les plus fréquentées, après Santorin et Mykonos, et pourrait prendre une trajectoire similaire une fois terminé le projet d'extension de l'aéroport. Flambée des prix, bouchons, problèmes d'approvisionnement en eau : l'été, ici aussi, le surtourisme a des conséquences très concrètes. L'an dernier, Paros a même fait irruption dans l'actualité internationale. Excédés par l'occupation illégale des plages par des restaurateurs et des beach bars, les locaux ont manifesté avec colère pour réclamer leur accès libre et gratuit, comme le garantit la Constitution grecque. Le « mouvement des serviettes », comme l'ont surnommé les médias, s'est ensuite répandu dans toute la Grèce.
Les premiers pas du « biochar », ce charbon de bois miraculeux qui stocke le CO2
Dans quelques mois, sur les bords du fleuve Saint-Laurent au Québec, les premiers kilos d'une drôle de poudre noire sortiront des lignes de production de Carbonity, une coentreprise détenue par Suez, le groupe forestier canadien Rémabec, et la start-up Airex Energie : du biochar. Un charbon de bois très spécial, dont les multiples vertus commencent à intéresser sérieusement les entreprises. « C'est un marché émergent, qui suscite de plus en plus d'intérêt et auquel nous croyons beaucoup », confirme Yves Rannou, directeur exécutif recyclage et valorisation de Suez. Rétention permanente du CO2 Produit par pyrolyse de biomasse végétale, c'est-à-dire par chauffage à haute température dans un milieu privé d'oxygène, le biochar possède, d'abord, des propriétés pour la restauration de sols très altérés : ce matériau léger et poreux n'est pas un fertilisant mais il améliore l'aération de la terre et permet d'y retenir les nutriments. « Il peut également être utilisé comme matériau de construction, comme catalyseur pour certaines réactions chimiques, ou pour le traitement d'effluents liquides ou gazeux », explique David Houben, directeur du collège Agrosciences de l'institut polytechnique UniLaSalle de Beauvais. Sa production permet aussi de générer de l'énergie valorisable. LIRE AUSSI : ZOOM - Comment Suez va vendre 36.000 crédits carbone à Microsoft ENQUÊTE - NetZero, la pépite française qui a tapé dans l'oeil d'Elon Musk Mais ce sont surtout ses propriétés de rétention permanente du CO2 qui suscitent aujourd'hui de l'intérêt. Car elles permettent aux entreprises d'envisager un modèle économique viable . Le processus de pyrolyse permet de piéger durablement dans la matière organique un carbone qui aurait été relâché dans l'atmosphère, si les résidus végétaux avaient été brûlés ou s'étaient simplement décomposés. « Une tonne de biochar séquestre ainsi entre 2 et 2,5 tonnes de CO2, de manière stable sur des centaines d'années. Ce sera même 2,9 tonnes sur notre première unité canadienne », indique Yves Rannou. Or cette faculté a conduit le GIEC à reconnaître le biochar parmi les technologies dites « à émissions négatives », permettant de retirer du CO2 de l'atmosphère (carbon removal, ou EDC), dans son rapport de 2018. Ce qui permet de générer lors de sa production des crédits carbone, que les entreprises peuvent valoriser pour compléter les revenus de la vente du biochar lui-même, ou de l'énergie générée par sa production. Suez vient ainsi d'annoncer avoir vendu par anticipation 36.000 crédits carbone (correspondant à 36.000 tonnes de CO2 séquestrées) à Microsoft. Disponibilité de la biomasse Depuis le rapport du GIEC de 2018, de nombreuses start-up, en Europe ou aux Etats-Unis, se sont créées sur ce créneau. L'association European biochar industry a recensé 171 usines de biochar rien qu'en Europe, et mise sur 220 fin 2024, qui produiraient 115.000 tonnes annuelles (75.000 en 2023). « De grands groupes s'y intéressent aussi, y compris en France », assure David Houben. Stellantis, L'Oréal et CMA-CGM sont entrés au tour de table de NetZero, une start-up créée en 2021 qui commence à faire parler d'elle - notamment parce qu'elle a été distinguée par la Fondation d'Elon Musk. Ils ne seraient pas les seuls. LIRE AUSSI : ZOOM - Terra Fertilis, du charbon pour régénérer les sols Soler investit aux Etats-Unis pour doper sa production de biocarbone L'un des enjeux du développement du marché sera la disponibilité de la biomasse sans conflit d'usage. « Nous estimons que le modèle n'est viable que s'il utilise des résidus agricoles qui ne pourraient pas être valorisés autrement, avec une production et une utilisation locale : cela n'aurait aucun sens de le transporter », indique Alex Reinaud, cofondateur de NetZero. Biomasse orpheline La jeune société, qui utilise des résidus de cacao au Cameroun et de café au Brésil (où elle vient d'inaugurer sa troisième usine) revend son biochar aux fermiers locaux. « Nous espérons répliquer le modèle des centaines, voire des milliers de fois, quitte à vendre notre procédé sous licence », poursuit l'entrepreneur, qui espère séquestrer ainsi plus de 1 million de tonnes de CO2 en 2030. 80 millions de dollars canadiens L'investissement représenté par l'usine canadienne de biochar de Suez, Rémabec, et Airex Energie Suez, qui va de son côté brûler au Canada des résidus non utilisés des scieries de Rémabec, affirme aussi ne considérer que de la biomasse « orpheline ». « Nous avons identifié pour cela une dizaine de sources possibles dans le monde : paille de riz, de cacao, palmes de noix de coco, écorces et copeaux de bois, etc. », indique Yves Rannou. L'usine canadienne, qui représente un investissement de 80 millions de dollars canadiens (55 millions d'euros), table sur une production annuelle de 30.000 tonnes. Mais Suez travaille déjà sur d'autres projets, visant à terme une production de 350.000 tonnes. Le marché du biochar est encore très loin de la maturité, mais dans les rêves les plus fous de certains visionnaires, il pourrait représenter une solution à grande échelle de retrait du CO2 de l'atmosphère. Le GIEC estime que pour limiter le réchauffement sous les 2 °C, il faudra retirer de l'atmosphère 10 à 15 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici à 2050, dont 2 milliards par an de manière permanente.
Culture : quand l’IA pousse à la « surproduction »
Dans les deux semaines qui ont suivi le lancement du service d'intelligence artificielle générative musicale Udio, dix nouvelles chansons ont été générées à chaque seconde par les utilisateurs, selon Bloomberg. Soit un tempo de 864.000 titres par jour, ou 315 millions par an, à comparer aux 100 à 200 millions de morceaux actuellement hébergés sur les grandes plateformes de streaming musical… A ce rythme-là, c'est bien d'une « submersion » de nouveaux contenus dont il s'agit, comme le décrit le président d'Arte France, Bruno Patino, dans son livre éponyme paru chez Grasset à l'automne dernier. Les outils numériques ont fait tomber les barrières à l'entrée de la création - avec des logiciels facilitant le travail technique - et de la diffusion - grâce aux plateformes de streaming audio et vidéo. L'IA générative automatise désormais carrément la production artistique , si bien qu'un tsunami créatif menace de s'abattre sur un champ culturel déjà engorgé, en commençant par la musique et la vidéo, avant de toucher peut-être demain les films, l'animation, les séries, le jeu vidéo ou le livre. La première lame s'est déjà abattue sur l'industrie musicale, avec des outils comme Udio, Suno ou MusicLM. Une vague du même acabit risque de fondre sur les plateformes vidéo comme YouTube , Instagram ou TikTok , où les contenus foisonnent déjà. Profusion de contenus Le grand public aura bientôt la possibilité de s'emparer de Sora, l'outil d'IA générative de vidéos d'OpenAI , dévoilé en février et qui doit être rendu accessible dans l'année, et de celui de Google , Veo, dévoilé en mai et pour l'instant en test auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs, notamment aux Etats-Unis. Sans attendre ces outils, l'IA démultiplie déjà la portée des productions des créateurs de contenus, par la traduction et le doublage automatisé de leurs vidéos, une pratique de plus en plus fréquente et qui enrichit l'offre dans chaque langue. Dans la production de séries et de films pour le cinéma ou l'audiovisuel, l'IA est pour l'instant plutôt utilisée en appoint (pour le doublage, la synchronisation, les effets spéciaux, le rajeunissement, la retouche de plan ou la figuration) ou de manière expérimentale. Mais l'abondance de l'offre y est déjà une réalité. « Aujourd'hui, tout le monde est à l'affût des nouvelles histoires, au vu du volume considérable de production de séries et de films, même s'il s'est stabilisé voire a un peu baissé », confiait récemment aux « Echos » le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - A South by Southwest, des musiciens aux prises avec l'intelligence artificielle Pour l'instant, l'IA n'a pas encore fait tomber les barrières et joué son rôle d'accélérateur dans la production cinématographique et audiovisuelle, le nombre de films agréés par le CNC restant à peu près stable en France (298 en 2023, contre 300 en moyenne entre 2017 et 2019), tout comme le volume de programmes audiovisuels aidés (un peu plus de 4.000 heures de programmes audiovisuels français, quasiment comme en 2022).

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.