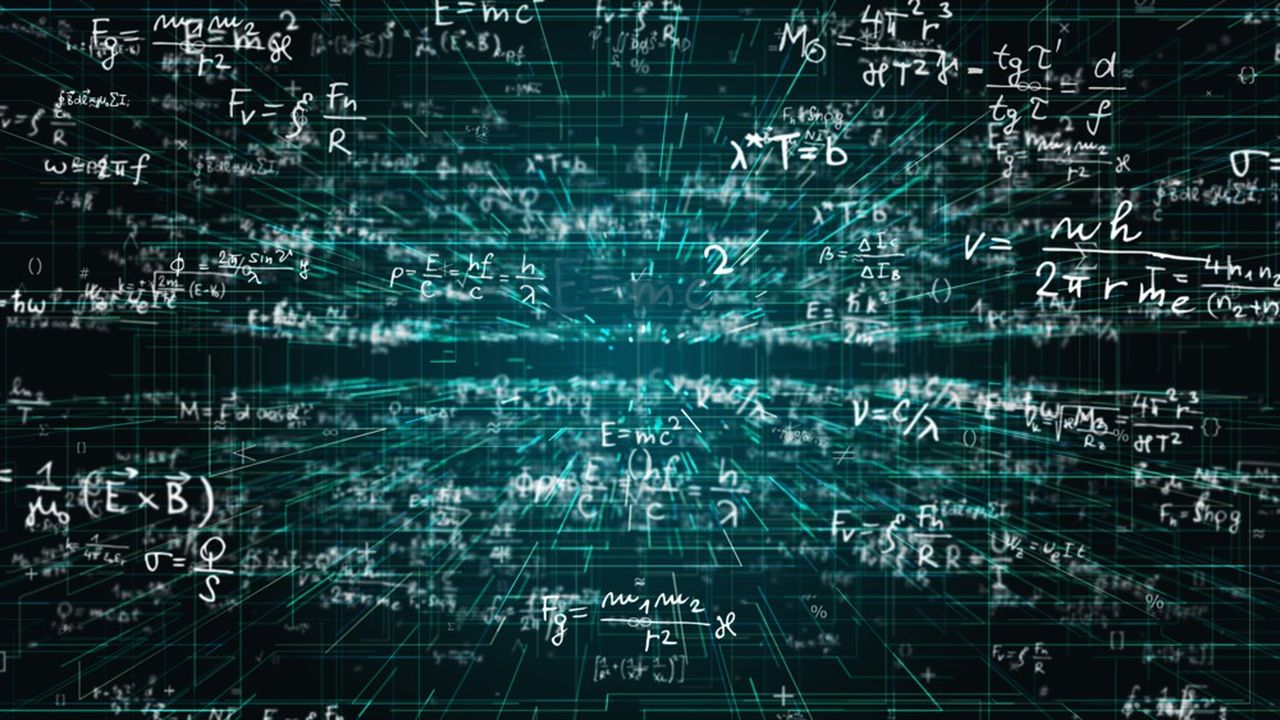Comment l’IA rebat les cartes pour les mineurs de cryptos
Le 20 avril dernier, comme tous les quatre ans, le monde des cryptos a encaissé le choc. Celui du « halving », cette réduction soudaine des récompenses attribuées aux mineurs de cryptomonnaies, en contrepartie de leur travail de vérification des transactions. Et même si le prix des monnaies virtuelles est largement remonté ces huit derniers mois, les conséquences sont toujours violentes pour l'industrie du minage. Avec le halving , il devient beaucoup moins rentable de créer de nouvelles unités de bitcoin, la reine des cryptos, alors que l'activité demeure très gourmande en énergie. Une gigantesque quantité d'électricité est nécessaire pour alimenter les ordinateurs qui calculent nuit et jour pour valider des transactions cryptées. Les serveurs et les machines sont entreposés dans d'immenses hangars dans diverses régions du globe où l'électricité est relativement bon marché. A la recherche de nouvelles sources de profits, les mineurs américains de cryptomonnaies lorgnent de plus en plus sur le boom de l'intelligence artificielle (IA). Data centers à tout prix Celui-ci entraîne une très forte hausse de la demande de puissance de calcul et, en conséquence, d'espace dans les data centers. Si bien que les entreprises qui développent les grands modèles d'IA approchent désormais les spécialistes du minage de cryptos pour exploiter leurs infrastructures informatiques. La nouvelle pépite américaine de l'IA, CoreWeave, valorisée à près de 20 milliards de dollars , a ainsi proposé de racheter pour un milliard de dollars l'américain Core Scientific, spécialisé dans le minage de bitcoin. Une offre que ce dernier a poliment déclinée jeudi dernier. « Le conseil d'administration a estimé que la proposition de CoreWeave sous-évaluait considérablement la valeur de l'entreprise et qu'elle n'était pas dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires », a-t-elle répondu. LIRE AUSSI : Bitcoin : la rentabilité des mineurs au plus bas IA : la pépite CoreWeave choisit Londres pour s'installer et investir en Europe En réalité, quelques jours auparavant, CoreWeave avait annoncé un partenariat avec cette même entreprise de minage de cryptomonnaies, qui pourrait engendrer des revenus à hauteur de… 3,5 milliards de dollars sur une dizaine d'années. Donnant ainsi un premier aperçu de la montagne de profits dont pourraient bénéficier les mineurs américains s'ils se convertissent à l'IA. Consolider l'activité des mineurs Le patron de Core Scientific, Adam Sullivan, a confié vouloir faire de ses centres de données basés au Texas « la plus grande installation de GPU consacrée à l'IA, probablement dans le monde entier ». Les GPU sont ces puces graphiques qui permettent notamment d'entraîner les grands modèles d'IA. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La construction de data centers est gourmande en argent et en temps ; il est particulièrement difficile de les raccorder à des sources d'énergie suffisantes et abordables. Un temps que n'ont pas les sociétés qui se lancent dans la course à l'IA si elles veulent maintenir le cap. Ces tractations ont fait bondir le cours des sociétés minières en fin de semaine dernière. Avec le refus de l'offre de CoreWeave, Core Scientific a gagné 16 % jeudi dernier, alors que l'entreprise est tout juste sortie, en janvier, d'un placement sous le régime américain des banqueroutes. LIRE AUSSI : Les énergéticiens américains lorgnent le charbon pour alimenter les data centers DECRYPTAGE - Les data centers, une soif d'eau difficile à étancher « Pour les mineurs américains de cryptos qui sont structurellement en pertes, comme Core Scientific, ce tournant a du sens. Il leur faut d'autres sources que le minage, car l'électricité leur coûte beaucoup trop cher », commente Sébastien Gouspillou, le patron de BBGS Mining, une société européenne de minage. Depuis plusieurs années, les mineurs américains sont restreints dans leur consommation d'énergie par les autorités locales, qui les paient en échange de l'arrêt de leurs activités. Ces « clauses d'effacement » sont devenues une véritable source de revenus pour eux, à défaut de gains liés aux cryptos. En Europe, l'allemand Northern Data a déjà entamé son virage vers l'IA. Cette entreprise de minage est parvenue à se procurer des milliers de puces H100 de Nvidia, qu'elle se prépare à fournir aux entreprises européennes d'IA d'ici à l'été.
Opinion | L’omniprésence des mathématiques dans la blockchain
Qu'on la lie aux cryptomonnaies ou à de multiples autres applications sécurisantes, la blockchain se révèle un terrain de jeu fascinant pour les maths. L'omniprésence des mathématiques dans la blockchain reste un pilier méconnu de notre avenir numérique. La technologie blockchain, souvent décrite comme un registre décentralisé et inviolable, repose sur un réseau de noeuds qui partagent, vérifient et valident les informations. Mais sa magie réside dans des mathématiques avancées qui assurent son fonctionnement. Du chiffrement (« encryption ») à la théorie des nombres, en passant par les algorithmes de consensus, les mathématiques sont le ciment invisible de cette technologie révolutionnaire. Algorithme spécifique L'un des fondements mathématiques les plus discutés derrière la blockchain est le mécanisme de preuve de travail, ou « proof of work » (PoW). Dans ce système, les mineurs - participants du réseau - tentent de satisfaire une inégalité par un processus calculatoire et itératif d'essais et erreurs (ce qui coûte de l'électricité), afin d'ajouter de nouveaux blocs à la chaîne. Ces calculs nécessitent des compétences avancées en théorie computationnelle. Pour faire simple, les mineurs doivent trouver une valeur qui, lorsqu'elle est insérée dans un algorithme spécifique (appelé « hashing »), produit une sortie qui répond à des critères de difficulté définis. En outre, si cette valeur (ou « hash ») est plus petite qu'une grandeur imposée par le mode opératoire (la « target »), le mineur est récompensé. La « target » témoigne du degré de difficulté à satisfaire l'inégalité en question. De plus, lorsque le réseau grandit, l'ensemble des calculs demandent plus puissance puisque tous les mineurs sont en compétition. LIRE AUSSI : TRIBUNE - Blockchain, une opportunité à ne pas manquer pour la France RECIT - Les memecoins de célébrités, nouvelle dérive à la mode dans les cryptos Cet effort n'est pas qu'une simple gymnastique académique. Il s'agit de sécuriser le réseau contre les attaques et de garantir l'intégrité des transactions. Ainsi, la cryptologie, une sous-discipline des mathématiques, joue un rôle crucial. Des concepts tels que les fonctions de hachage cryptographiques et les signatures numériques garantissent que chaque transaction est authentique et infalsifiable. Courbes elliptiques Mais parmi les divers outillages mathématiques utilisés dans la blockchain, les courbes elliptiques occupent une place de choix. Utilisées dans les algorithmes de cryptographie asymétrique tels que l'ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), les courbes elliptiques permettent de générer des clés cryptographiques ultra-sécurisées tout en étant plus efficientes en termes de calcul que les méthodes traditionnelles. Le principe repose sur des propriétés algébriques spécifiques des courbes elliptiques pour sécuriser les communications et les transactions. Par exemple, dans de nombreuses cryptomonnaies , chaque utilisateur possède une clé privée, générée à partir d'une courbe elliptique, qui permet de signer les transactions. La génération de clés repose sur le fait que l'on peut munir une courbe elliptique donnée d'une loi d'addition, le tout formant un groupe abstrait. Ce processus mathématique garantit que les seules personnes autorisées puissent effectuer des transactions, tout en rendant extrêmement difficile pour un attaquant de découvrir la clé privée correspondante. De plus, avec l'avènement des méthodes quantiques, les paramètres de sécurité des blockchains pourront être encore renforcés, rendant les systèmes cryptographiques actuels encore plus robustes face aux menaces futures. Résister à la fraude Les enjeux sont bien tangibles : sans ces fondements mathématiques, la blockchain perdrait tout son sens et sa sécurité. Elle ne pourrait assurer la consistance nécessaire à son fonctionnement. Les mathématiques impliquent non seulement l'intégrité et la vérifiabilité des transactions, mais elles rendent également le système résilient et capable de résister aux éventuelles tentatives de fraude (notamment les attaques 51 %). LIRE AUSSI : EN CHIFFRES - Portrait-robot des détenteurs français de cryptos Bitcoin : le Salvador lève enfin le voile sur ses réserves En conclusion, les mathématiques forment l'essence même de la blockchain, la rendant à la fois possible, fiable, et de plus en plus stable au cours de sa construction. Il est donc indispensable, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde des cryptomonnaies, de maîtriser au minimum les bases mathématiques sous-jacentes. Après tout, n'oublions pas qu'investir dans ces technologies sans une bonne compréhension reviendrait à naviguer une mer déchaînée sans carte ni boussole. Alors, avant de vous aventurer dans ces eaux digitales, pensez à réviser vos formules !
ETF bitcoin : les gérants européens distancés par les américains
Jean de La Fontaine est formel : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Mais lorsqu'il s'agit de la course que se livrent les acteurs de l'asset management pour intégrer les cryptoactifs à leur offre, difficile d'être aussi affirmatif. Dans le rôle du lièvre : les gérants américains. Depuis que le 10 janvier dernier, leur régulateur, la Securities and Exchange Commission (SEC), a donné à onze d'entre eux le feu vert pour proposer des ETF (exchange-traded funds ou fonds cotés en Bourse) directement investis en bitcoins (« au comptant »), les superlatifs pleuvent. Dès les premières semaines, la collecte des véhicules lancés par les géants américains BlackRock et Fidelity s'envole à plus de 2 milliards de dollars chacun. Il a ainsi fallu moins de deux mois à BlackRock pour atteindre la barre symbolique des 10 milliards de dollars d'encours. « Le record était jusque-là détenu par l'ETF d'Invesco répliquant le Nasdaq et cela lui avait pris plus d'un an », souligne Bryan Armour, directeur de la recherche sur la gestion passive pour l'Amérique du Nord chez Morningstar. Parti de rien, BlackRock est devenu, fin mai, le gestionnaire du plus gros fonds de bitcoins au monde, damant le pion au spécialiste américain des cryptos en place depuis plus de dix ans, Grayscale, mis au tapis pour ne pas avoir abaissé ses frais afin de s'adapter à cette nouvelle concurrence. Dès 2019 en Europe Mais ce démarrage en trombe semble aussi faire de l'ombre aux acteurs européens. Plusieurs d'entre eux s'étaient pourtant positionnés tôt sur les cryptoactifs en offrant des véhicules régulés, eux aussi « au comptant ». « Les premiers produits cotés en Bourse investis directement en bitcoins, et non via des dérivés, sont apparus dès 2019 en Europe », rappelle Pierre Debru, directeur de la recherche chez WisdomTree, un des acteurs de ce marché. Leur structure reste toutefois plus complexe. Si, aux Etats-Unis, on parle ainsi d'ETF, c'est-à-dire de « fonds », il n'en va pas de même en Europe. Pour être qualifié d'ETF, un produit coté en Bourse doit répondre aux exigences de la directive Ucits (OPCVM en français). Or un fonds Ucits n'a pas le droit d'investir dans des cryptoactifs. De ce côté-ci de l'Atlantique, on parle donc d'ETC, le « C » signifiant « commodities » (matières premières). Une structure déjà retenue pour les produits adossés à l'or par exemple, mais qui freine le développement du marché. Les chiffres sont sans appel : en cinq mois - en tenant compte de l'effet de marché très positif sur la période -, l'encours des ETF bitcoins américains est passé de zéro à plus de 60 milliards de dollars, alors que l'ensemble de ces produits cryptos plafonne à 14 milliards en Europe, après plus de cinq ans d'existence.
P&G’s Marc Pritchard: ‘AI doesn’t get the creative tingles – humanity matters’
Procter & Gamble’s chief brand officer Marc Pritchard has warned marketers not to rely on AI and other emerging technologies for their ideas, but instead to use the power of humanity to unleash the creative potential of everyday brands. “Even with all the technology available to us, the answer won’t be found in the data or the algorithms,” Pritchard told his audience today at the Cannes Lions Festival of Creativity (18 June). “The answer is in the idea, which comes from the heart and soul.” In a keynote titled ‘Finding Creativity in the Everyday’, he talked of the “exponential potential” for creative opportunities generated by daily-use household and personal care products, but argued that only the human brain can generate ideas that provoke “that physiological reaction when something really touches you”. The “magic of a creative brand idea” only comes when “both sides of the brain work together to combine logic and feeling,” Pritchard argued. “Your spine tingles. Some call it the chills or goosebumps.” Such a response cannot be felt by AI, he said. “AI doesn’t get the tingles – humanity matters.” In reference to the ensuing debate on the future role of AI in marketing, Pritchard acknowledged that “we’re at yet another inflection point in the creative industry with the next leap of technology power available at our fingertips”. But sustained growth was “only possible”, he said, “when we bring the humanity we all have inside of us, every single day, to unlock the power of ideas”. P&G directs marketing spend towards ‘expandable categories’ in pursuit of volume growth The P&G brand chief took the opportunity to set out the creative power of household brands, which he admitted are “not the first products that come to mind when it comes to creativity”. Citing recent campaigns for Lenor and Gillette, he calculated that such products offer billions of “everyday moments” which are “rich with creative potential”. Quality products have endless opportunities to “dramatise problems” caused daily by under-performing products, from leaky diapers to failing detergents, he pointed out. “Think about it – billions of people with billions of moments multiplied by seemingly endless opportunities for solving problems with the best performing daily use products,” he said. “That equals exponential possibilities for finding creativity in the everyday and enormous potential for delighting people through innovation and creativity that drives growth and value for brands and markets.” To realise those opportunities, marketers must follow a three-point plan, he said. First, they should venture out into communities and witness the power of everyday product moments first-hand. “It’s visiting people in their homes and where they shop, to observe actual behaviour in how they experience our products,” he said. “It requires human interaction to get the true essence of a moment.” Even with all the technology available to us, the answer won’t be found in the data or the algorithms. The answer is in the idea, which comes from the heart and soul. Marc Pritchard, P&G Second, marketers must take such experiences and use them to identify their brand’s unique ability for problem-solving. “It’s important to define how the brand provides a tangible and noticeably superior performance benefit.” Finally, they must use their brains to form a magical creative brand idea, such as Lenor’s ‘Let the sunshine in’ or Gillette’s ‘The best a man can get’. Pritchard detailed a series of P&G brand campaigns that have used everyday activities to have cultural impact in international markets. Soap brand Safeguard used the annual family-based holiday of Chinese New Year to engage consumers in the ritual of “wash hands and have dinner”. Ariel helped to shift the work balance in Indian households by encouraging more men to do laundry duties with a socially-minded campaign called ‘Share the Load’. Speaking in France ahead of the start of the Paris Olympics and Paralympics next month (July), in which P&G is a worldwide partner, Pritchard referenced the Olympics-inspired brand marketing that P&G is doing with more than 30 brands, focused on the “daily little wins” for users of its products, including a Pampers campaign on empowering “little champions”. P&G’s Marc Pritchard: Marketers must ‘reset’ the creative bar for market growth P&G Studios, the company’s brand film arm, is making a documentary, Rising Phoenix: A New Revolution, which aims to amplify the debate on disability equality. P&G is also partnering with Kevin Hart’s production company Hartbeat to make The Other Games, a show that will stream for 17 days during the games on NBC/Peacock. The content will feature “stupendous and somewhat ridiculous feats of athletic prowess with our brands that you too can try at home”, said Pritchard. The discus event becomes the “Dirty Dishcus”, a washing-up competition linked to P&G cleaning brands Cascade and Dawn, while curling is transformed into the mop-based “Swirling with Swiffer PowerMop”. All this brand work, Pritchard said, is being produced by human creativity “to make everyday moments matter more”.
Aérien : pourquoi la Gen Z se détourne des programmes de fidélité
Selon une étude menée par OAG*, 64% des voyageurs interrogés effectuent au moins trois voyages par an. Malgré un intérêt prononcé pour le transport aérien, l’étude constate que la majorité des voyageurs de la génération Z se détourne des programmes de fidélité proposés par les compagnies aériennes. De quoi pousser les transporteurs à revoir les copies en matière de fidélisation afin de susciter davantage d’engagement de la part de cette tranche de la population. Les programmes de fidélisation en déclin au fil des générations Si la majorité des grands voyageurs adhère à un programme de fidélité d’une compagnie aérienne (82%), ceux issus de la génération Z (65%) et les Millennials (70%) sont moins enclins à opter pour ces programmes de fidélité. Un écart d’autant plus important avec leurs aînés baby-boomers : ils sont 89% à être inscrit à une offre de fidélisation des compagnies aériennes, selon OAG. Les taux d’adoption des programmes de fidélité par les grands voyageurs en fonction des générations. Source : OAG L’avenir du programme de fidélisation des compagnies aériennes est-il menacé ? C’est en tout cas ce que suggèrent les résultats de l’enquête conduite par OAG. Si les transporteurs ne font rien pour faire évoluer leur offre de fidélisation, le cabinet d’analyse craint de voir le nombre d’adhérents diminuer au fil des années. Mais pourquoi la Gen Z se détourne-t-elle des programmes qui ont séduit d’autres générations de voyageurs par le passé ? OAG identifie 4 freins principaux à l’adoption de ces services. Gen Z : 61% des voyageurs ne sont pas fidèles à une compagnie aérienne Le principal obstacle à l’adhésion à ces programmes réside dans l’absence de voyages réguliers avec un seul transporteur ou une seule marque pour 61% des voyageurs de la génération Z et 49% des Millennials interrogés. Exit le sentiment d’appartenance à une marque pour ces voyageurs. De plus, 19% des voyageurs de la génération Z considèrent la durée d’accès aux récompenses proposées par ces programmes trop long. Les quatre principaux freins à l’adoption des programmes de fidélité des compagnies aériennes par les voyageurs de la génération Z. Source : OAG L’autre problème semble résider dans l’objet même des récompenses proposées par les transporteurs : 8% des voyageurs de la génération Z déplore le manque de personnalisation des avantages propres aux programmes de fidélité. Enfin, 8% des sondés se disent réticents à l’idée de devoir partager leurs données personnelles avec les compagnies aériennes. Un voyageur sur deux veut pouvoir utiliser ses points pour la location saisonnière Une attente forte réside dans la capacité à utiliser les points de fidélité au cours du voyage et auprès de différents prestataires. Par exemple, les voyageurs souhaitent majoritairement utiliser les points de leur programme de fidélisation pour se loger à l’hôtel (73 %), puis pour louer une voiture (53 %). En outre, 50 % des membres de la génération Z et 49 % des Millennials souhaitent pouvoir utiliser leurs points auprès de prestataires de location de vacances. Pour opter pour un programme de fidélité, 63 % exigent la gratuité de l’enregistrement de bagages tandis que 43% souhaitent accéder aux salons dans les aéroports. Quant au comportement d’achat en matière de billets d’avions, le site web (48%) et l’application mobile (37%) des compagnies aériennes constituent les principaux canaux d’achat, toute génération confondue.
Reduce AI Hallucinations With This Neat Software Trick
IF YOU’VE EVER used a generative artificial intelligence tool, it has lied to you. Probably multiple times. These recurring fabrications are often called AI hallucinations, and developers are feverishly working to make generative AI tools more reliable by reining in these unfortunate fibs. One of the most popular approaches to reducing AI hallucinations—and one that is quickly growing more popular in Silicon Valley—is called retrieval augmented generation. The RAG process is quite complicated, but on a basic level it augments your prompts by gathering info from a custom database, and then the large language model generates an answer based on that data. For example, a company could upload all of its HR policies and benefits to a RAG database and have the AI chatbot just focus on answers that can be found in those documents. So, how is this process different from a standard ChatGPT output? I asked Pablo Arredondo, a vice president of CoCounsel at Thomson Reuters, who has been using the RAG method to develop aspects an AI tool for legal professionals. “Rather than just answering based on the memories encoded during the initial training of the model,” he says, “you utilize the search engine to pull in real documents—whether it's case law, articles, or whatever you want—and then anchor the response of the model to those documents.” For instance, we could upload the entirety of WIRED’s history, all of the print magazines and web articles since 1993, to a private database and build a RAG implementation that references these documents when answering reader questions. By giving the AI tool a narrow focus as well as quality information, the RAG-supplemented chatbot would be more adept than a general purpose chatbot at answering questions about WIRED and relevant topics. Would it still make mistakes and sometimes misinterpret the data? Absolutely. But the odds of it fabricating entire articles that never existed would definitely go down. “You're rewarding it, in the way that you train the model, to try to write something where every factual claim can be attributed back to a source,” says Patrick Lewis, an AI modeling lead at Cohere who helped develop the concept of RAG a few years ago. If you teach the model to effectively sort through the provided data and use citations in every output, then the AI tool is less likely to make egregious mistakes. Though, exactly how much RAG reduces AI hallucinations is a point of contention for researchers and developers. Lewis carefully chose his words during our conversation, describing RAG outputs as “low hallucination” rather than hallucination-free. The process is definitely not some panacea that eliminates every mistake made by AI. During conversations with multiple experts, it became clear that just how much RAG lowers hallucinations depends on two core things: the quality of the overall RAG implementation, and how you decide to define AI hallucinations, a sometimes fuzzy term without a firm definition. FEATURED VIDEO Walton Goggins Answers The Web's Most Searched Questions MOST POPULAR BACKCHANNEL The West Coast’s Fanciest Stolen Bikes Are Getting Trafficked by One Mastermind in Jalisco, Mexico BY CHRISTOPHER SOLOMON GEAR Apple Intelligence Won’t Work on Hundreds of Millions of iPhones—but Maybe It Could BY ANDREW WILLIAMS GEAR Sorry, VR: The Meta Ray-Ban Wayfarers Are the Best Face Computer BY ADRIENNE SO GEAR The Barnes and Noble Nook 9-Inch Lenovo Tablet Is Startlingly Affordable BY MEDEA GIORDANO ADVERTISEMENT To start off, not all RAGs are of the same caliber. The accuracy of the content in the custom database is critical for solid outputs, but that isn’t the only variable. “It's not just the quality of the content itself,” says Joel Hron, a global head of AI at Thomson Reuters. “It's the quality of the search, and retrieval of the right content based on the question.” Mastering each step in the process is critical since one misstep can throw the model completely off. “Any lawyer who's ever tried to use a natural language search within one of the research engines will see that there are often instances where semantic similarity leads you to completely irrelevant materials,” says Daniel Ho, a Stanford professor and senior fellow at the Institute for Human-Centered AI. Ho’s research into AI legal tools that rely on RAG found a higher rate of mistakes in outputs than the companies building the models found. Which brings us to the thorniest question in the discussion: How do you define hallucinations within a RAG implementation? Is it only when the chatbot generates a citation-less output and makes up information? Is it also when the tool may overlook relevant data or misinterpret aspects of a citation? According to Lewis, hallucinations in a RAG system boil down to whether the output is consistent with what’s found by the model during data retrieval. Though, the Stanford research into AI tools for lawyers broadens this definition a bit by examining whether the output is grounded in the provided data as well as whether it’s factually correct—a high bar for legal professionals who are often parsing complicated cases and navigating complex hierarchies of precedent. While a RAG system attuned to legal issues is clearly better at answering questions on case law than OpenAI’s ChatGPT or Google’s Gemini, it can still overlook the finer details and make random mistakes. All of the AI experts I spoke with emphasized the continued need for thoughtful, human interaction throughout the process to double check citations and verify the overall accuracy of the results. Law is an area where there’s a lot of activity around RAG-based AI tools, but the process’s potential is not limited to a single white-collar job. “Take any profession or any business. You need to get answers that are anchored on real documents,” says Arredondo. “So, I think RAG is going to become the staple that is used across basically every professional application, at least in the near to mid-term.” Risk-averse executives seem excited about the prospect of using AI tools to better understand their proprietary data without having to upload sensitive info to a standard, public chatbot. It’s critical, though, for users to understand the limitations of these tools, and for AI-focused companies to refrain from overpromising the accuracy of their answers. Anyone using an AI tool should still avoid trusting the output entirely, and they should approach its answers with a healthy sense of skepticism even if the answer is improved through RAG. “Hallucinations are here to stay,” says Ho. “We do not yet have ready ways to really eliminate hallucinations.” Even when RAG reduces the prevalence of errors, human judgment reigns paramount. And that’s no lie.
Apple Proved That AI Is a Feature, Not a Product
Apple's otherworldly, flying-saucer headquarters in Cupertino, California, felt like a suitable venue this week for a bold and futuristic revamp of the company’s most prized products. With iPhone sales slowing and rivals gaining ground thanks to the rise of tools like ChatGPT, Apple offered its own generative artificial intelligence vision at its Worldwide Developer Conference (WWDC). Apple has lately been perceived as a generative AI laggard. Its WWDC offerings failed to persuade some critics, who have branded WWDC’s announcements as downright boring. But with the focus on infusing existing apps and OS features with what the company calls “Apple Intelligence,” the big takeaway is that generative AI is a feature rather than a product in and of itself. The dazzling abilities demonstrated by ChatGPT has inspired some startups to try inventing entirely dedicated AI hardware—like the Rabbit R1 and the Humane AI Pin—as a means of harnessing generative AI. Unfortunately, these gadgets have been underwhelming and frustrating to use in practice. By contrast, Apple’s vertical integration of generative AI across so many products and different software seems much likelier where AI is headed. Sign Up Today This is an edition of WIRED's Fast Forward newsletter, a weekly dispatch from the future by Will Knight, exploring AI advances and other technology set to change our lives. Rather than a stand-alone device or experience, Apple has focused on how generative AI can improve apps and OS features in small yet meaningful ways. Early adopters have certainly flocked to generative AI programs like ChatGPT for help redrafting emails, summarizing documents, and generating images, but this has typically meant opening another browser window or app, cutting and pasting, and trying to make sense of a chatbot’s sometimes fevered ramblings. To be truly useful, generative AI will need to seep into technology we already use in ways we can better understand and trust. After the WWDC keynote, Apple gave WIRED a demo of what it calls Apple Intelligence, a catchall name to account for AI running across several apps. The capabilities hardly push the boundaries of generative AI, but they are thoughtfully integrated and perhaps even limited in ways that will encourage users to trust them more. A feature called Writing Tools will let iOS and MacOS users rewrite or summarize text, and Image Playground will turn sketches and text prompts into stylized illustrations. The company’s new Genmoji tool, which uses generative AI to dream up new emojis from a text prompt, may turn out to be a surprisingly popular integration given how frequently people fling emojis at one another. Apple is also giving Siri a much-needed upgrade with generative AI that helps the assistant better understand speech including pauses and corrections, recall previous chats for better context awareness, and tap into data stored in apps on a device to be more useful. Apple said that Siri will use the App Intents, a framework for developers that can be used to perform actions that involve opening and operating apps. When asked “show me photos of my cat chasing a toy,” for example, a language model will parse the command and then use the framework to access Photos. Apple’s generative AI will mostly run locally on its devices, although the company has developed a technique called Private Cloud Compute to send queries to the cloud securely when necessary. Running AI on a device means it will be less capable than the latest cloud-based chatbot. But this may be a feature rather than a bug, as it also means that a program like Siri is less likely to over-extend itself and mess up. Apple is rather cleverly handing its most challenging queries over to OpenAI’s ChatGPT, with a user’s permission. FEATURED VIDEO Method Man Answers The Web's Most Searched Questions MOST POPULAR BACKCHANNEL The Titan Submersible Disaster Shocked the World. The Inside Story Is More Disturbing Than Anyone Imagined BY MARK HARRIS BACKCHANNEL The West Coast’s Fanciest Stolen Bikes Are Getting Trafficked by One Mastermind in Jalisco, Mexico BY CHRISTOPHER SOLOMON CULTURE The 18 Best Movies on Amazon Prime Right Now BY MATT KAMEN GEAR Apple Intelligence Won’t Work on Hundreds of Millions of iPhones—but Maybe It Could BY ANDREW WILLIAMS ADVERTISEMENT Investors apparently approve of Apple’s announcements, but we’ll have to wait a while to see how well it really works. The technology won’t roll out until later this year in beta, and even then it will be limited to the iPhone 15 Pro and computers using Apple’s M series of chips. That could make the experience a little choppy for those of us who’ve hung on to older devices. You can also expect people to push features like Genmoji to misbehave. After Meta launched AI-generated “stickers” last year, people began creating unwelcome images, including heavily armed Mario characters. The shift to AI as a feature and not a product is a welcome one after so much ChatGPT hype, and it can also be seen in other recent announcements. Google and Microsoft both went big on AI at their developer events this year, but they also tried to emphasize more practical use cases, including tools built into Gmail or Copilot in Windows. Even OpenAI, which kicked off the generative AI boom and offers the most compelling AI product around in ChatGPT, seems to currently be more focused on making the interface more natural and compelling, and even a bit flirty. Thankfully, Apple says that for the time-being it will focus on using generative AI to make Siri more useful rather than overly familiar.
Espèces, carte bancaire, paiement mobile… qui pollue le plus ?
Manger moins de viande, limiter ses trajets en avion mais aussi… payer par carte bancaire ? En matière de lutte conte le réchauffement climatique, toute réduction des émissions de CO2 est bonne à prendre. Et les acteurs du paiement l'ont bien compris, au point d'en faire un argument auprès des consommateurs. Entre les entreprises du paiement électronique, comme Worldline, et les acteurs de la filière fiduciaire, chargés des billets et des pièces, le sujet est même devenu un vrai terrain d'affrontement. Le cash pointé du doigt Selon la Banque de France, qui cite une étude de la Banque centrale européenne (BCE), l'empreinte environnementale du billet par an et par habitant de la zone euro représente 101 micropoints (µPt), ce qui correspond à un trajet de 8 kilomètres en voiture. Soit moins de 0,01 % de l'impact environnemental annuel total d'un habitant de la zone euro. Aussi faible soit-il, ce score reste supérieur à celui des moyens de paiements électroniques, répond une seconde étude, commandée par Worldline. En cause notamment, la « mobilité nécessaire pour aller chercher l'argent liquide au distributeur », explique Sébastien Mandron, directeur RSE pour le spécialiste français du paiement. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Pourquoi payer en ligne est plus stratégique qu'il n'y paraît La carte bancaire virtuelle, le nouveau pari des banques en ligne Transports compris, une transaction en espèces émettrait ainsi 36,8g de CO2, contre 2,45g pour un paiement par carte, soit quinze fois moins, assure le rapport, écrit par Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris Dauphine-PSL. « La diminution de l'utilisation des espèces et des chèques contribue directement à aider le continent à atteindre ses ambitions en matière de réduction des émissions de CO2 », conclut l'étude. Dématérialiser les paiements Et des moyens existent pour baisser encore les émissions, avance Worldline. Parmi eux : remplacer la carte plastique par une carte virtuelle sur smartphone ou remplacer le terminal de paiement du commerçant par un smartphone. Dans ce scénario de paiement optimisé, une transaction n'émettrait plus que 0,74g de CO2. « Tout cela peut être fait du jour au lendemain », plaide Sébastien Mandron, pour qui les acteurs du secteur « ont un intérêt commun à s'engager dans l'exercice ». LIRE AUSSI : Les commerçants veulent inciter les clients à mieux choisir leurs moyens de paiement Delupay, filiale de la banque Delubac & Cie spécialisée dans le paiement dématérialisé, assure pouvoir faire encore mieux. Selon une troisième étude réalisée par la start-up Greenly, la solution de paiement de Delupay - qui permet de se passer de terminal de paiement - émet uniquement 0,12 g de CO2 par transaction. Pour les défenseurs du cash, l'argument est biaisé. « La conclusion du rapport de la BCE, c'est surtout que les moyens de paiement ne sont pas un sujet d'émissions », avance Stéphanie Courtois, directrice marketing et ESG chez Brink's, société de transport de fonds. Comparer le cash aux paiements électroniques est trompeur, plaide-t-elle.
Les femmes prennent désormais plus l’avion que les hommes
Les clichés ont la vie dure, mais celui de l'avion réservé aux riches et aux « boomers » ne devrait pas résister à la lecture de la dernière enquête « passagers aériens » de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Réalisée en 2023 auprès de 46.000 passagers dans 10 aéroports français, cette étude met en évidence un usage toujours plus large de l'avion dans toutes les couches de la population, en dépit de son renchérissement et des mots d'ordre écologistes. Les évolutions sont d'autant plus remarquables que cette étude nationale, réalisée par des enquêteurs de l'institut de sondage Ifop sur la base d'un questionnaire auprès des passagers, n'avait pas été menée depuis 2016. D'où un certain nombre de « nouveautés » dans le profil type et les motivations des voyageurs. Une majorité de femmes et de jeunes à bord Premier constat : « toutes les catégories de voyageurs sont revenues à l'avion après le Covid », souligne-t-on à la DGAC. Cependant, pour la première fois dans une enquête, les femmes sont devenues légèrement majoritaires (51 %) chez les passagers aériens en France. Dans les cinq précédentes menées de 2010 à 2016, les hommes étaient majoritaires. En dépit du succès médiatique du « flygskam » , ce sont toujours les jeunes qui prennent le plus l'avion et leur part dans le trafic aérien n'a fait qu'augmenter. Près de la moitié (45 %) a entre 15 et 34 ans, soit une progression de 5 points comparée à 2016. La plus grande proportion (27 %) a entre 25 et 34 ans, contre 19 % pour les 35-44 ans et 18 % pour les 45-54 ans. Les retraités de 65 ans et plus ne représentent que 6 %, contre 10,5 % en 2010. La majorité des passagers (62 %) sont également des résidents en France, y compris pour les vols internationaux (56 %), dont la part augmente avec la baisse des lignes domestiques . Les « CSP + » devenus minoritaires Et contrairement à une idée répandue, les catégories sociales les plus favorisées, les « CSP + » selon la classification de l'INSEE (cadres, professions libérales, professions intermédiaires, commerçants, artisans), ne constituent plus la majorité des passagers aériens. Leur part est tombée à 43 %, contre 50 % dans l'étude de 2016 et 50,7 % en 2010. A titre de comparaison, la proportion de « CSP + » serait plus importante à bord des TGV (49 %), selon une étude de 2019, de l'Autorité des transports. En revanche, la part des catégories sociales les moins favorisées dites « CSP- », employés et ouvriers, est passée de 23,2 % en 2010 à 32 % en 2023. Sur la même période, celle des inactifs - retraités, sans emploi et étudiants - est passée de 26,2 % à 25 %, avec toutefois une progression des étudiants (14 % des voyageurs contre 11,6 % en 2010) et un net recul des retraités (8 % contre 10,5 % en 2010). Le développement de l'offre low cost n'est probablement pas pour rien dans cette démocratisation de l'avion.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.