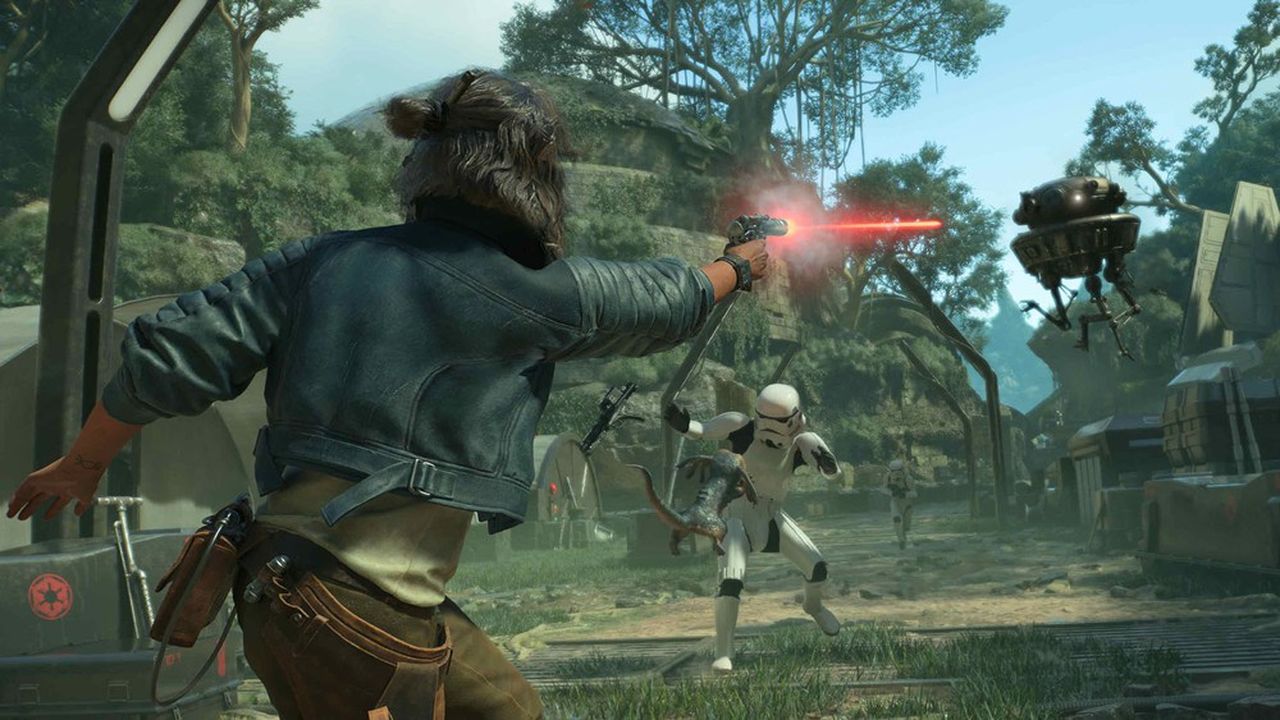Pourquoi l’électricien japonais Tepco se met à miner du bitcoin
C'est un tabou que brise Tepco. Le géant japonais de l'électricité, en annonçant se mettre à miner du bitcoin (avec sa filiale Agile Energy X), affirme que cette activité réputée énergivore a, en fait, une utilité dans la production… d'énergie renouvelable. L'industrie du minage le clame depuis longtemps mais peine à être entendue au-delà de sa sphère. Tepco pourrait lui apporter du crédit. « Ce que nous faisons a peu d'équivalents au Japon », a déclaré Kenji Tateiwa, le président de la filiale, au quotidien « Asahi Shimbun ». L'ancien cadre de la division nucléaire de Tepco assure que ce programme « peut encourager à développer les énergies vertes ». Annoncée en 2022, la filiale du géant de l'électricité a, selon le journal, installé des mineurs près des fermes solaires dans les préfectures de Gunma et de Tochigi, proches de Tokyo. Leur rôle est de n'utiliser que le surplus d'énergie produit par les panneaux photovoltaïques, et qui serait autrement gaspillé. Eviter les gaspillages Pourquoi cette énergie serait-elle perdue ? Pourquoi flécher ces watts produits vers la création de bitcoin ? Et n'y a-t-il vraiment pas un meilleur usage pour cette électricité verte ? Le projet a de quoi questionner, mais il est clairement exposé par Tepco, qui reprend des arguments connus. LIRE AUSSI : Bitcoin : la rentabilité des mineurs au plus bas Les mineurs de bitcoins face à une inévitable consolidation Il faut d'abord avoir en tête que la production d'énergie renouvelable est intermittente , dépendant de l'ensoleillement pour le solaire, ou du vent pour l'éolien. Or, que se passe-t-il si le vent souffle fort dans les pales d'une éolienne alors que dans le même temps, la demande en électricité (par exemple, la nuit) est faible ? Si l'énergie excédentaire produite ne peut pas être stockée (le prix des batteries est trop élevé pour ce cas) ou consommée, bien souvent, elle est simplement perdue. Monétiser les excédents En redirigeant cet excédent vers le minage de bitcoin, l'énergéticien japonais évite le gaspillage, mais surtout, monétise cette électricité en créant de la monnaie numérique. Les mineurs de bitcoin peuvent facilement s'allumer et s'éteindre, rendant cette activité compatible avec l'intermittence de la production d'énergie verte. Comparé à d'autres utilisations comme le stockage, le minage s'impose car il génère de l'argent plutôt que d'en coûter. C'est là que Tepco avance son argument massue : en monétisant les watts en trop, les énergéticiens seront incités à verdir leur production. Les simulations d'Agile Energy X ont montré que 240.000 gigawattheures d'électricité seraient gaspillés si l'énergie verte devait représenter 50 % de l'approvisionnement total en électricité du Japon (la fourchette basse de son objectif à 2050). A ce stade, l'excédent serait trop grand pour être stocké sans obérer la rentabilité de ce verdissement, en raison du prix des batteries. Mais selon l'entreprise, en minant du bitcoin avec 10 % de cette énergie, cela permettrait de générer 360 milliards de yens par an, soit 2,5 milliards de dollars. De quoi créer un cercle vertueux ?