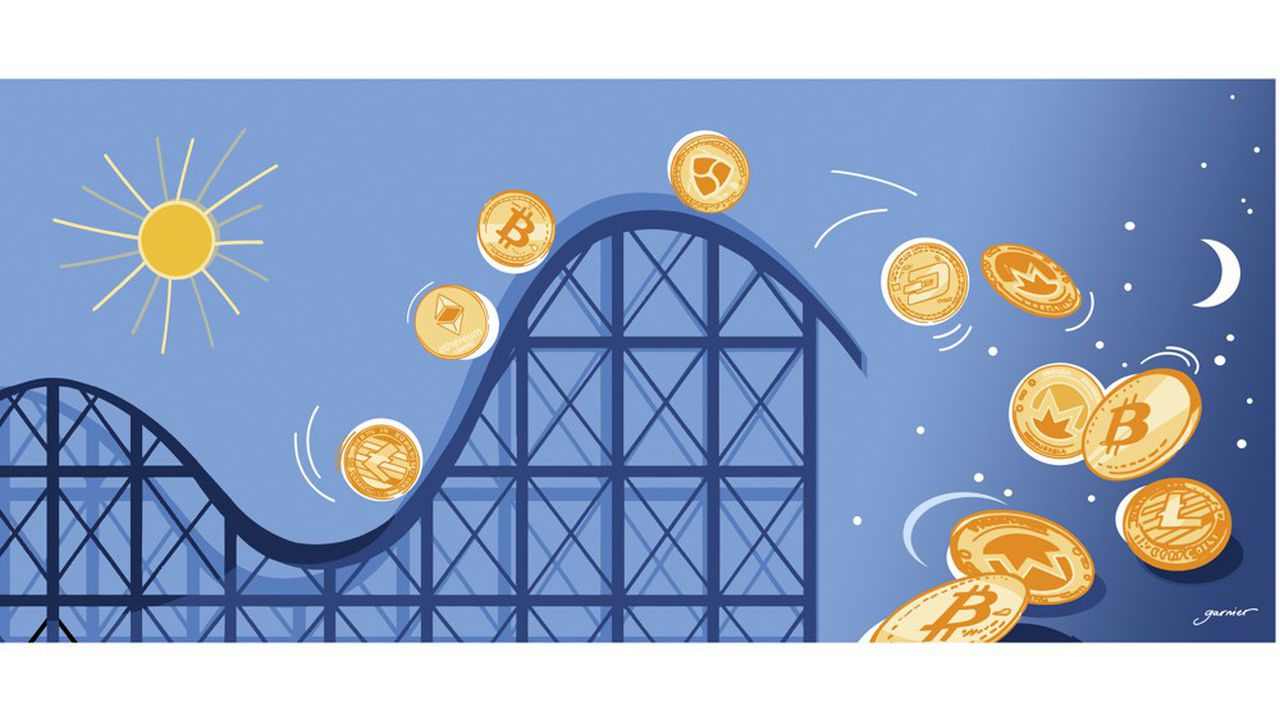Louvre Hotels Group : « Il ne faut jamais imposer la technologie au client »
Nous remarquons que les clients viennent pour la technologie proposée mais aussi pour l’approche qualitative en matière de RSE. Nous réfléchissons à dupliquer le concept à d’autres établissements en cours de construction, notamment chez une filiale en Inde. Nous ne nous interdisons pas de déployer certains services dans des hôtels existants, notamment dans les chambres. Nous pensons que cet aspect innovant peut devenir un marqueur fort de la marque Campanile. Ce pourrait devenir un nouveau positionnement. L’idée serait de mettre l’accent sur le côté RSE dans des établissements loin des villes et d’axer sur le côté digital et smart dans les milieux urbains. Que pensez-vous de la nouvelle étude d’Oracle qui révèle que les clients français aspirent à moins d’interaction et plus d’autonomisation dans les hôtels ? Je pense que la crise sanitaire a changé les standards des clients. Elle a favorisé la réduction des interactions. Mais il ne faut pas oublier que nous évoluons dans l’univers de l’hospitalité où l’humain est important. La technologie doit exister au bénéfice d’une praticité, d’un gain de temps pour le client. Je pense qu’il faut lui laisser le choix et ne jamais lui imposer.