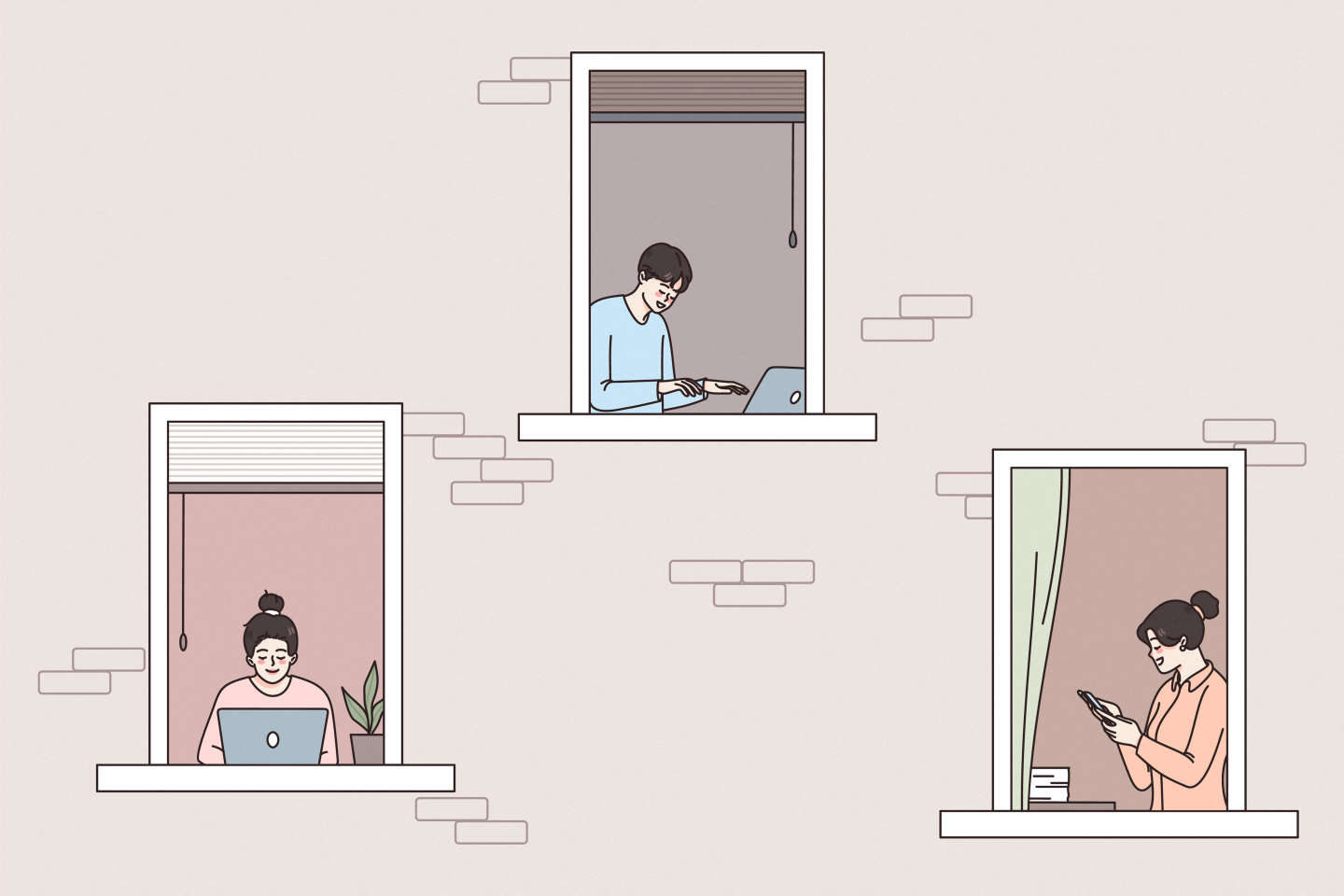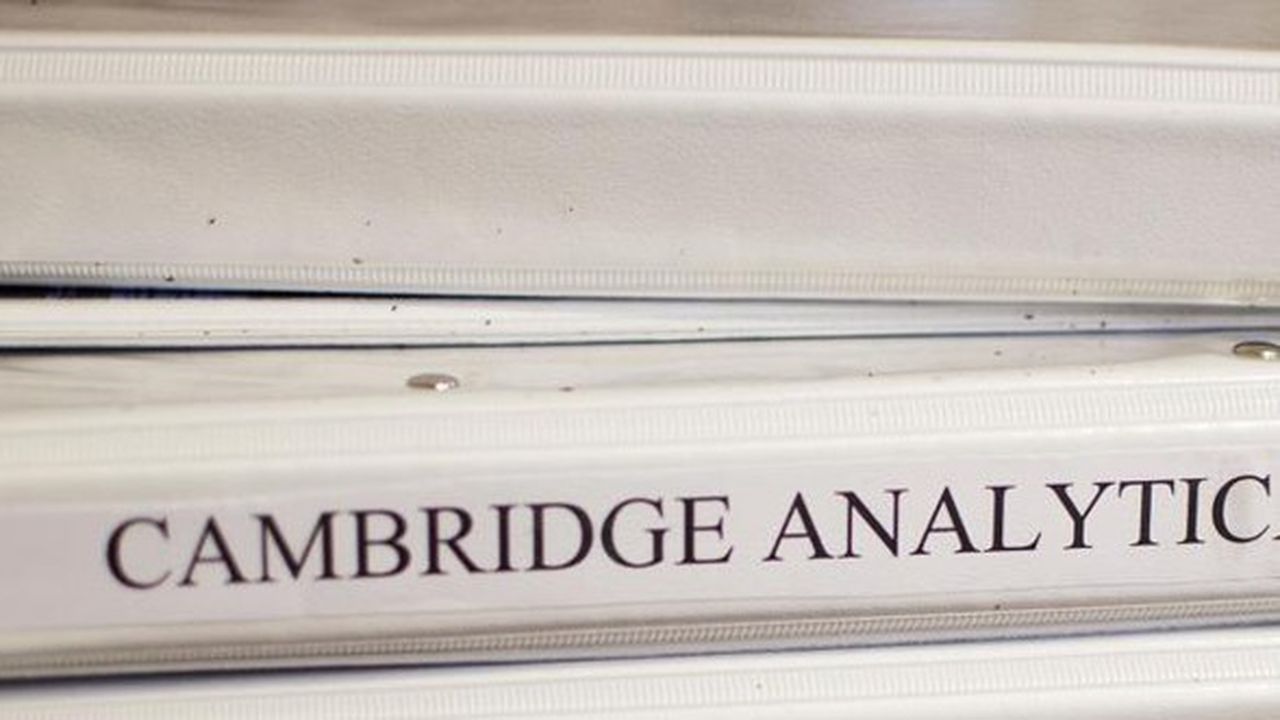Tencent, le discret numéro un chinois du numérique, obligé de se réinventer
L’annonce a marqué un tournant dans le paysage de la tech chinoise : le 16 novembre, Tencent, l’entreprise la plus valorisée de Chine, à 375 milliards d’euros (contre 285 milliards d’euros pour Meta, par exemple), a annoncé céder l’essentiel de ses parts dans Meituan, une plate-forme de services très populaire en Chine. Les quelque 23 milliards de dollars (21,5 milliards d’euros) d’actions détenues seront distribués à ses actionnaires. Surtout connu pour WeChat, l’application la plus utilisée en Chine et forte de 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde, Tencent est devenu au fil du temps un superinvestisseur, soutenant des centaines de start-up chinoises et étrangères, et investissant dans des centaines de studios de jeux vidéo. Mais, après vingt ans de développement tous azimuts, l’heure est à la prudence. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Naspers, le groupe de médias sud-africain qui a fait fortune avec Tencent, le champion chinois du numérique La cession de Meituan intervient dans un contexte difficile pour le groupe qui a publié un chiffre d’affaires en recul de 2 % au troisième trimestre, à 140 milliards de yuans (19 milliards d’euros). C’est le deuxième trimestre de baisse de suite, une première pour le géant chinois, qui a vu sa valeur boursière fondre de 60 % depuis son pic, début 2021. En 2022, son chiffre d’affaires ne devrait progresser que de 0,5 % à environ 563 milliards de yuans. Soit sa plus faible croissance depuis son introduction en Bourse en 2004, estime la firme de recherche Refinitiv. Tencent souffre à la fois de la conjoncture en Chine, marquée jusqu’à peu par une stricte politique zéro Covid, et d’une campagne de régulation des plates-formes de la tech. Moins touché que son rival Alibaba, condamné à plusieurs amendes, dont une, début 2021, de 18 milliards de yuans pour abus de position dominante, Tencent n’échappe pas aux attaques des régulateurs contre les pratiques monopolistiques des plates-formes. Face au courroux des autorités, le géant des médias et numéro un mondial des jeux vidéo est obligé de se séparer d’une partie de ses participations. Ma Huateng, un patron discret Il y a un an déjà, Tencent avait distribué à ses actionnaires des actions de JD. com, le numéro deux chinois de la vente en ligne, pour un montant de 16,4 milliards de dollars, réduisant ainsi ses parts dans le groupe de 17 % à 2 %. L’entreprise a dû aussi abandonner un projet de fusion entre les deux principaux sites de streaming de jeux vidéo, et mettre fin à ses accords octroyant l’exclusivité des droits de diffusion de musique en Chine à sa plate-forme QQ Music, qui domine ce secteur. Si, dans ce contexte politique tendu, Tencent s’en est sorti mieux que ses concurrents, c’est à mettre au compte du patron de l’entreprise, Ma Huateng (ou Pony Ma en anglais), dont la discrétion contraste avec la fougue de Jack Ma, le charismatique fondateur d’Alibaba. En octobre 2020, ce dernier avait osé dénoncer la « mentalité de prêteur sur gages » du régulateur bancaire chinois, une insolence punie par l’annulation de l’introduction en Bourse de la filiale financière d’Alibaba. Il vous reste 54.98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés. Contenus sponsorisés parOutbrain LEICA CAMERA - SL2-S Elias Maria, photographe de voile : C'est notre curiosité qui ouvre la voie. SFR BUSINESS Le métavers : un futur accéléré par la 5G CAPITAL La surprenante reconversion de Didier Lallement, l'ancien préfet de Paris
Ces jeunes diplômés pour qui le télétravail n’est plus une option : « Je ne supportais plus l’idée de payer un bras pour une cage à poules et un clic-clac »
« Avant le Covid, le télétravail n’était pas un critère. Maintenant, ça l’est ! » C’est ainsi que Kani Diakité, fraîchement diplômée de l’EM Normandie, résume son choix. Début 2022, elle décroche un poste de cheffe de produit innovation dans un groupe francilien, avec trois à quatre jours de télétravail par semaine. Une condition sine qua non pour Kani, qui habite Vernon, dans l’Eure. Pour aller au bureau, il lui faut au moins trois heures de transport en commun, aller-retour. Si les trains sont à l’heure. Lors de sa recherche d’emploi, elle confie avoir même refusé un poste, qui exigeait une présence quotidienne. « Pour moi, c’est impossible, maintenant, de revenir en arrière ! Je tiens trop à cette organisation. » Si elle se dit prête à venir un peu plus au bureau « si besoin », notamment pour créer davantage de liens avec ses collègues, Kani préfère rester dans cette commune normande, avec sa famille, plutôt que de poser ses valises dans la capitale. « Quand j’entends les Parisiens parler de leur petit appartement à 1 000 euros par mois, je me dis que oui, j’ai des frais de transport et d’essence, mais que cela reste rentable en comparaison », tranche-t-elle. « Je ne supportais plus l’idée de payer un bras pour une cage à poules et un clic-clac ! » Adélie Montagnier a fait également le choix de la distance. Originaire d’Orléans, elle s’installe à Paris en 2018. Au départ, cette diplômée de l’ICN Business School savoure le dynamisme de la capitale. Jusqu’à l’annonce du confinement. « Ma mère m’a accueillie durant toute cette période. C’est là que je me suis rendu compte de la qualité de vie de sa maison, proche de la campagne. Cela correspondait mieux à mes attentes personnelles », se souvient Adélie. Après presque deux ans de télétravail dans ces conditions, le retour dans son studio lui devient impensable : « Je ne supportais plus l’idée de payer un bras pour une cage à poules et un clic-clac ! »
Changement climatique : l’agriculture néerlandaise plongée dans une crise sans précédent
L'agriculture néerlandaise traverse sa plus grande crise depuis longtemps. Elle a débuté en 2019, après que le Conseil d'Etat a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réduire drastiquement les émissions d'azote. Les plus gros émetteurs fermés Depuis, des règles plus strictes ont été adoptées en matière de traitement du fumier et des restrictions ont été imposées à l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Mais c'est loin d'être suffisant. Malgré les protestations, le gouvernement insiste pour réduire de moitié les émissions d'azote d'ici à 2030. Les 500 à 600 plus gros émetteurs, tant agricoles qu'industriels, seront rachetés et fermés par l'Etat d'ici un an. Ceux qui restent devront se tourner vers des méthodes d'agriculture plus durables. LIRE AUSSI : Les Pays-Bas cherchent des réponses face à une surpopulation croissante En Espagne, les prix de l'énergie menacent de mettre l'agriculture à sec L'agriculture néerlandaise a également été confrontée cette année à la crise de l'énergie. Cela a été particulièrement visible à Westland, « la ville en verre », située entre Rotterdam et La Haye. Pendant des décennies, des denrées alimentaires relativement bon marché et de haute qualité ont été produites ici, dans des serres en verre, grâce à l'abondance de gaz bon marché dans le sous-sol néerlandais. Le gaz dix fois plus cher Depuis que les Pays-Bas ont réduit leur propre production de gaz, et surtout depuis la guerre en Ukraine , les prix ont flambé. Les serristes paient le gaz jusqu'à dix fois plus cher qu'il y a un an. Déjà, quelque 2,5 % des cultivateurs sous serre ont mis la clé sous la porte. La Fédération nationale de l'horticulture en serre s'attend à ce que ce nombre triple. LIRE AUSSI : ENQUÊTE - Gaz néerlandais : le grand dilemme du gisement de Groningue D'autres secteurs de l'agriculture sont également confrontés à la hausse des prix. Le coût des engrais et des aliments composés pour animaux était nettement plus élevé en 2022 qu'un an auparavant. Malgré tout, l'année a été fructueuse pour les agriculteurs néerlandais. Pour la première fois, les 52.000 agriculteurs du pays ont gagné plus de 100.000 euros en moyenne, même s'il existe de grandes disparités entre les différents secteurs. Montée du niveau de la mer La crise de l'azote n'est pas la seule conséquence du changement climatique. Les agriculteurs doivent s'adapter à des conditions météorologiques extrêmes, telles que la sécheresse et les précipitations excessives. Ils doivent investir massivement dans des techniques d'économie d'eau ou planter des cultures plus résistantes. La montée du niveau de la mer pose une autre difficulté quasiment insurmontable : les sols sont sujets à une salinisation rapide. Malgré ces défis, les agriculteurs néerlandais ont exporté pour 104,7 milliards d'euros de produits agroalimentaires en 2021 (contre 69,8 milliards pour la France), un record. Le pays occupe la deuxième place mondiale, juste derrière les Etats-Unis. Mais dans ce plat pays, qui est non seulement le plus densément peuplé mais aussi l'un des plus pollués d'Europe, de plus en plus de citoyens se demandent si le pays doit encore produire des aliments pour le monde entier. Dans les années à venir, le modèle des Pays-Bas sera soumis à de nouvelles pressions.
Tribune JL Baroux – Y a-t-il un avenir pour l’A380 ?
On le pensait mort et voilà qu’il ressuscite. Tous les prévisionnistes s’accordaient à pronostiquer qu’à la suite de leur mise au sol pendant la désastreuse période du Covid, les Airbus 380 ne revoleraient plus jamais. Ils prédisaient d’ailleurs que le transport aérien allait subir un période de décroissance et que l’arrivée sur le marché de nouveaux appareils plus modernes et surtout moins consommateurs de carburant, bref, plus écologiques, rendraient les gros quadriréacteurs étaient bons pour le rebut. Et puis voilà qu’ils reviennent sur le tarmac des aéroports. A ce jour et si j’en crois certains médias, 134 appareils sont de nouveau en exploitation ou seront remis en service au printemps prochain. A tout seigneur tout honneur, la palme revient encore à Emirates qui en fait voler 85 pour le moment sur les 119 livrés. La compagnie de Dubaï est suivie, mais de très loin par British Airways : 12 avions en service et Singapore Airlines 10 sur les 24 livrés. Les transporteurs asiatiques ont été les premiers à suivre le mouvement. All Nippon Airways, Asiana Airlines, Korean Air et Qantas ont ainsi sorti leur avion drapeau des hangars. Ethiad Airways s’apprête à en faire autant ce qui fera un total de 134 A380 en vol dès le printemps prochain. L'exemple Emirates Pourquoi ce retour en grâce d’un appareil condamné par nombre d’experts qui estiment impossible de gagner de l’argent avec une telle machine ? La première réponse a été apportée par Tim Clark, l’emblématique dirigeant d’Emirates. En substance, il remarque que la plupart des opérateurs ne savent pas gagner de l’argent avec l’A380 alors qu’il est devenu une vraie machine à cash pour sa compagnie. Il est vrai que si cet appareil n’est pas aimé par de nombreux et importants responsables de compagnies, il est largement plébiscité par les clients. Ils apprécient l’espace, le silence car il fait 2 fois moins de bruit que le Boeing 747/400 et la qualité de sa pressurisation à 1.520 m d’altitude ce qui rend le voyage beaucoup plus confortable. Je note par ailleurs que les compagnies du Golfe ont toutes aménagé leurs appareils de manière ludique en créant des espaces différents au moins pour les classes « première » et « business » allant de salles de bain, aux salons et jusqu’au bar, ce que n’ont pas voulu faire les compagnies européennes. Et les clients en particulier ceux de la haute contribution sont très sensibles à un confort qu’ils sont prêts à payer à un bon prix. Les trois opérateurs du Golfe ont gardé une configuration de leurs appareils long-courrier en 3 classes alors que la « première » a progressivement disparue des équipements proposés par les compagnies occidentales. Cette dérive vers le bas de gamme se ressent non seulement sur les sièges, même si ceux des classes affaires ont été largement améliorés au fil du temps, mais également sur la qualité du service. On paie d’une manière ou d’une autre la recherche de la masse au détriment du confort et d’un certain art de vivre que peut proposer le transport aérien. 853 sièges Je note également que l’A380 n’a jamais été utilisé à plein de ses possibilités, à la différence du Boeing 747 dont pas moins de 8 versions ont été proposées. On n’a par exemple jamais tenté une configuration en 853 sièges pourtant validée par le constructeur et les autorités aéronautiques. Cela permettrait d’abaisser très sérieusement le prix de revient du siège/kilomètre. Seul Gérard Ethève, en son temps président d’Air Austral, avait proposé d’équiper sa compagnie de ce type d’avion équipé en haute densité. Il n’a pas été suivi, a dû laisser sa place et on a vu ce qu’est devenue la rentabilité du transporteur réunionnais. Certes, on peut dire qu’une telle densité rendrait le voyage inconfortable pour un long vol, mais je note que l’une des versions du A 350/1000, le dernier biréacteur d’Airbus est bien en 480 sièges, ce qui en fait une densité équivalente à celle d’un A380 en 850 sièges. Si, comme on peut l’espérer et comme, d’ailleurs, on le constate, le trafic repart, surtout pour des voyages à motif personnel, il faudra bien choisir entre une multiplication des vols avec des appareils bimoteurs de 280 à 400 places et l’utilisation des capacités des Airbus 380 en haute densité. La France et la Grande Bretagne sont très bien placées pour opérer ce type de capacités dans le cadre de la desserte de leurs territoires lointains. Il reste encore une petite centaine d’A380 non utilisés, voilà un réservoir tout trouvé ne serait-ce que pour économiser les émissions de CO2, car un seul appareil, fût-il quadriréacteur, émettra toujours moins de CO2 que deux gros biréacteurs.
Le groupe Bolloré vend sa branche historique en Afrique pour se concentrer sur la communication
Le groupe Bolloré a finalisé, des mois en avance, la cession de ses ports en Afrique, son activité originelle avec laquelle il a bâti sa fortune, au géant italo-suisse MSC, engrangeant plus de 5,5 milliards d’euros Le groupe diversifié Bolloré a annoncé mercredi la finalisation de la vente de ses activités logistiques en Afrique à l’armateur italo-suisse MSC, une opération réalisée avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial et qui lui rapporte plus de 5 milliards d’euros. Recevez la newsletter Économie Inscrivez vous à la newsletter Économie pour ne plus manquer une seule information importante. S'INSCRIRE « Le prix de cession des actions s’établit à 5,1 milliards d’euros auquel s’ajoutent 600 millions d’euros de remboursement de comptes courants », a indiqué le groupe dans un communiqué. SUR LE MÊME SUJET Bolloré fête le bicentenaire de son groupe, sans vraiment évoquer de retrait Alors qu’il avait annoncé sa mise en retrait à l’occasion de la célébration du bicentenaire du groupe, Vincent Bolloré, 70 ans en avril, n’a rien annoncé de ses intentions Bolloré Africa Logistics possède des infrastructures dans de nombreux pays africains, parmi lesquelles un réseau de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. En 2021, cette branche emblématique du groupe Bolloré et plus rentable que la logistique internationale a vu ses revenus bondir de 8 % à 2,2 milliards d’euros. Mais, confronté à des investissements de plus en plus coûteux et à la concurrence grandissante des opérateurs chinois, le groupe de Vincent Bolloré souhaitait la vendre. Fortune et scandales Bien avant les médias, la logistique et l’Afrique ont fait la fortune de l’homme d’affaires breton qui a pris en 1986 le contrôle de la SCAC (Société commerciale d’affrètement et de combustible) au moment de sa privatisation. Bolloré Africa Logistics était de plus au cœur de scandales de corruptions au Togo et en Guinée pour lesquels le groupe avait accepté en 2021 de payer une amende de 12 millions d’euros à la justice française et d’être suivi par l’Agence française anticorruption. Le groupe actionnaire de Vivendi « conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l’édition », selon son communiqué. Basé à Genève, l’acheteur MSC appartient à la famille italienne Aponte et revendique une flotte de 560 navires et plus de 100 000 employés, avec la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach (Californie) ou Rotterdam
Corse : une puce électronique sur les bovins corses pour éviter les fraudes aux aides européennes
Fraudes aux aides agricoles européennes, cheptels fictifs, vaches errantes ou porteuses de la tuberculose bovine : les bovins corses vont être équipés d’une puce électronique inviolable pour les identifier La Corse « est la seule région » de France « où le « Bolus » sera obligatoire pour obtenir, dès octobre 2023, l’aide animale » dans le cadre de la Politique agricole commune (Europe), précise Pierre Bessin, directeur de la Draaf de Corse. Recevez la newsletter Autour des Enfants Inscrivez vous à la newsletter Autour des Enfants pour ne plus manquer une seule information importante. S'INSCRIRE Cette puce « rendra beaucoup plus difficile la fraude et les élevages fictifs », assure la Draaf, en précisant que « cette opération de réidentification de l’ensemble du cheptel bovin en Corse » permettra aussi « une traçabilité sanitaire des troupeaux, dans une île où la tuberculose bovine circule ». SUR LE MÊME SUJET Corse : deux cabanons incendiés, des tags indépendantistes découverts Deux cabanons appartenant à une personne résidant dans l’Hexagone ont été incendiés dans la nuit de lundi à mardi dans la commune corse d’Alata, près d’Ajaccio SUR LE MÊME SUJET Grippe aviaire : les dates clés depuis le premier foyer en France, en 2006 CHRONOLOGIE – Une période de vide sanitaire est décrétée cet hiver pour les éleveurs de canards et d’oies du Sud-Ouest pour éviter une nouvelle propagation de l’épidémie virus aviaire (H5N1). Retour sur un fléau qui a largement touché la région, dont une période terrible il y a un an, où plus de 40 000 volailles ont du être abattues Obligatoire pour l’abattoir Cette identification individuelle de chaque animal par puce électronique («Bolus »), dont le coût (1,7 euro hors taxe par bête) et la mise en place sont pour le moment intégralement pris en charge par l’Etat, « conditionnera également d’ici 2024 ou 2025 l’attribution de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) », une autre aide agricole européenne. Et elle sera obligatoire pour amener ses bêtes à l’abattoir, a précisé Lia Bastianelli, cheffe du projet Bolus à la Draaf de Corse. Parmi les premières volontaires, pour cette vaste opération entamée le 1er décembre à travers l’île méditerranéenne, les bêtes d’André Olivesi, à Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud). « Ça montre la sincérité de notre exploitation. On verra qu’il y a un suivi » et que notre troupeau « existe » bien, explique Antoine Olivesi, son frère, en référence aux affaires judiciaires de fraudes aux aides de la Politique agricole commune (PAC) qu’a connu l’île. Conduites une à une dans un couloir fait de rondins de bois pour les immobiliser à l’entrée du pré, les bêtes d’André et Antoine Olivesi se retrouvent face à Jo Galezi, technicien à la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf). Le « Bolus » est placé « dans le rumen, le premier estomac de la vache », et il va « rester là à vie, dans l’animal », poursuit celui qui va superviser l’opération sur les « quelque 20 000 bovins répartis sur 430 élevages que compte la Corse-du-Sud ». 8 % de refus Pour l’heure, seuls 8 % des éleveurs concernés ont refusé. Fin octobre, la chambre d’agriculture de Haute-Corse et le syndicat agricole FDSEA 2B ont critiqué l’imposition du bolus, lors d’une conférence de presse, préférant un système alternatif, selon eux, plus fiable et « garant du bien-être animal ». Au total, la production corse de cheptel et de viande (bovins, ovins, caprins, porcins, poulets) représente 10 % des 256 millions d’euros de la production agricole totale en Corse, tirée par la production végétale (80 %) et notamment le vin et les fruits. A LIRE AUSSI Infection aux streptocoques A : plusieurs enfants décédés en France, une flambée des cas sous surveillance « Celui qui vient ne repart plus » : dans les Pyrénées, ce petit village qui vise l’autonomie LES SUJETS ASSOCIÉS Agriculture Animaux Economie Société Home À elle seule, « la filière bovine capte 40 % des aides publiques, et le nombre d’éleveurs a explosé, passant de 900 en 2015 à 1 200 aujourd’hui, avec une production qui pourtant ne cesse de décroître », avait souligné en mai 2021 Sabine Hofferer, la précédente Draaf de Corse, qui a travaillé à la mise en place de ces Bolus.
Au Tampon, des escargots de la serre à l’assiette
Connaissez-vous l'héliciculture ? A La Réunion, Nadine Grondin est la seule à la pratiquer, depuis dix ans. Dans sa ferme à escargots, près de 30 000 gastéropodes sont élevés, chouchoutés au milieu de la verdure. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Si chez vous les escargots s’invitent sur les tables de fêtes, sachez qu’il existe un élevage péi au Tampon ! Reportage dans la ferme de Nadine Grondin Tout a commencé lorsque dans la table d'hôtes qu'elle tenait avec son mari, ils ont commencé à proposer des escargots du jardin au menu. "Les clients nous en ont demandé", et l'idée de lancer la ferme hélicicole a suivi. Des "gros-gris" originaires d'Afrique du Sud Après sa formation en héliciculture en métropole, Nadine Grondin a choisi de s'intéresser aux "gros-gris", la variété d'escargots originaire d'Afrique du Nord, et qui est la plus élevée en France, nous dit-elle. "Le gros-gris est intéressant car il se rapproche du petit-gris, réputé être le meilleur, et a la taille du Bourgogne. On peut le travailler et il a une consistance intéressante pour être valorisé au mieux" Nadine Grondin, hélicicultrice Mais "la majorité des escargots se mangent, même l'achatine, l'escargot pointu qu'on trouve dans les bas", sourit-elle. 600 escargots reproducteurs Grâce à ses 600 escargots reproducteurs (mâles et femelles à la fois, puisque l'escargot est hermaphrodite), elle peut chaque jour récolter leurs oeufs qu'elle met à incuber "en moyenne 15 à 20 jours". Puis, direction les parcs à engraissement où les gastéropodes seront soignés sur un sol tout spécialement végétalisé. Tétragone, chou, salade, brède chinois... constituent leur nourriture très tôt. "Je suis obligée d'apporter un complément alimentaire, le carbonate de calcium bio, car l'escargot en a besoin pour sa coquille et on n'en trouve pas dans les sols de La Réunion", explique Nadine Grondin. Un complément bio, car les substances absorbées par l'escargot le seront aussi par les clients qui le mangeront. Alors, l'hélicicultrice fait "attention à ce qu'il n'y ait aucun produit phytosanitaire qui arrive sous les serres". 18 000 escargots par parc Pour leur confort le plus complet, les 18 000 escargots par parc peuvent compter sur des planches de bois, "surfaces sur lesquelles ils peuvent se protéger la journée, car ils craignent le soleil et le vent", et sur un système d'irrigation nocturne par brumisation. "C'est l'atmosphère qu'ils aiment !"
Scandale de Cambridge Analytica : Facebook accepte de payer 725 millions de dollars
Le géant américain Meta, propriétaire de Facebook, a accepté de payer 725 millions de dollars pour mettre fin à un procès en action collective lancé en 2018. Le réseau social se voyait réclamer des dommages et intérêts pour avoir laissé des tiers, dont la société Cambridge Analytica, avoir accès aux données privées des utilisateurs. « Les 725 millions proposés par l'accord constituent le montant le plus élevé jamais atteint dans un procès en nom collectif sur les données privées et jamais payé par Facebook pour mettre fin » à ce type de poursuite, ont affirmé les avocats de la défense dans un document judiciaire déposé auprès d'un tribunal de San Francsico, publié jeudi soir. Amende record Facebook n'a reconnu aucune infraction, selon les termes de cet accord qui doit encore être approuvé par un juge de ce tribunal. La conclusion d'un accord préliminaire avait été annoncée en août dernier, sans que le montant ou les termes de cet accord ne soient alors révélés. LIRE AUSSI : Presse : Meta menace de fermer Facebook News aux Etats-Unis Il était intervenu alors que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg et sa directrice générale Sheryl Sandberg, qui a annoncé sa démission en juin après 14 ans dans l'entreprise,
Publicité en ligne : l’effritement du duopole Google/Facebook s’accélère
Un vent nouveau souffle sur le secteur américain de la publicité en ligne et y redessine les équilibres concurrentiels. Pour la première fois depuis 2014, la part de marché cumulée de Google et Meta (Facebook) - les deux leaders sur ce pan de l'industrie publicitaire pesant plus de 200 milliards de dollars outre-Atlantique - est repassée sous le seuil symbolique des 50 % cette année, selon le groupe de recherche Insider Intelligence. Dans le détail, celle-ci s'est s'élevée à 48,4 % (28,8 % pour Google et 19,6 % pour Meta), contre 50,9 % en 2021. Un niveau très éloigné du record de 2017 à 54,7 % de part de marché cumulée sur le marché américain de la publicité numérique (34,7 % pour Google et 20 % pour Meta). Et le recul devrait considérablement s'accentuer encore, d'après Insider Intelligence, puisque l'institut prédit que l'actuel duopole verra son poids cumulé se réduire à 43,9 % dès 2024. Pour se justifier auprès des marchés financiers, les deux géants de la tech en délicatesse mettent leurs difficultés sur le dos de la baisse des dépenses publicitaires des annonceurs, due au contexte économique géopolitique et énergétique. Sauf que cet état de fait vaut pour tous les acteurs de la publicité numérique et n'explique en rien la lourde perte de part de marché de Meta et Google au bénéfice de concurrents directs. Le double rôle d'Apple La principale cause de cette double chute tient en trois lettres : « ATT » (App Tracking Transparency). Mis en place par Apple, ce mécanisme force les éditeurs d'applications à recueillir le consentement des utilisateurs afin de pouvoir collecter et partager leurs données avec des tiers. Ce qui a considérablement réduit la capacité de Meta à cibler finement les annonces sur ses applications (Instagram, Facebook), mais aussi à mesurer l'efficacité des campagnes. LIRE AUSSI : Apple, Google, Facebook, Amazon : quels sont les gagnants et les grands perdants dans la publicité ? Plus épargné par le mécanisme, Google en pâtit cependant aussi. Lors du dernier trimestre, sa pépite YouTube a vu ses revenus décliner, sur un an, pour la première fois. En parallèle de ce phénomène, Meta et Google voient aussi des rivaux monter grandement en puissance. Dont un certain… Apple. Ces dernières années, la firme à la pomme n'a cessé d'étoffer son arsenal publicitaire. Avec succès. Alors que l'analyste Toni Sacconaghi, chez Bernstein, estimait les revenus publicitaires mondiaux d'Apple à 300 millions de dollars en 2017, ils auraient grimpé à près de 7 milliards cette année, selon Insider Intelligence. Si son niveau d'activité demeure encore très loin du chiffre d'affaires publicitaire mondial d'un Google (210 milliards en 2021) ou d'un Facebook (115 milliards), Apple grignote déjà des parts de marché à ces derniers. L'essor d'Amazon Dans le peloton des firmes tentant de rattraper le duo de tête, c'est Amazon qui se détache nettement des autres. Entre octobre et la fin de l'année, le groupe va pour la première fois franchir le cap des 10 milliards de dollars de revenus publicitaires trimestriels, dont la majorité est générée sur le sol américain. Résultat, la firme devrait atteindre 12,7 % de part du marché publicitaire aux Etats-Unis en 2024, contre 17,9 % pour Meta et 26 % pour Google. LIRE AUSSI : Amazon : la « troisième force » de la publicité en ligne avec Google et Facebook Le géant de Seattle surfe sur la vague montante du « retail media » - soit les produits publicitaires sur les sites marchands des grands commerçants ainsi que la monétisation des données clients -, un genre dont il est le précurseur et qui est devenu un pan majeur du marché publicitaire numérique. Un autre rival a aussi émergé très rapidement ces dernières années, au point d'être devenu le péril jeune de Meta dans le domaine du « social » : TikTok. Cette plateforme de vidéos courtes musicales devrait générer 8,6 milliards de dollars de revenus publicitaires sur le marché américain en 2024, selon Insider Intelligence. Ce qui la ferait alors intégrer le Top 5 du secteur publicitaire numérique américain derrière Microsoft, Amazon et les deux leaders Meta et Google. Plus vacillants que jamais sur leurs trônes.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.