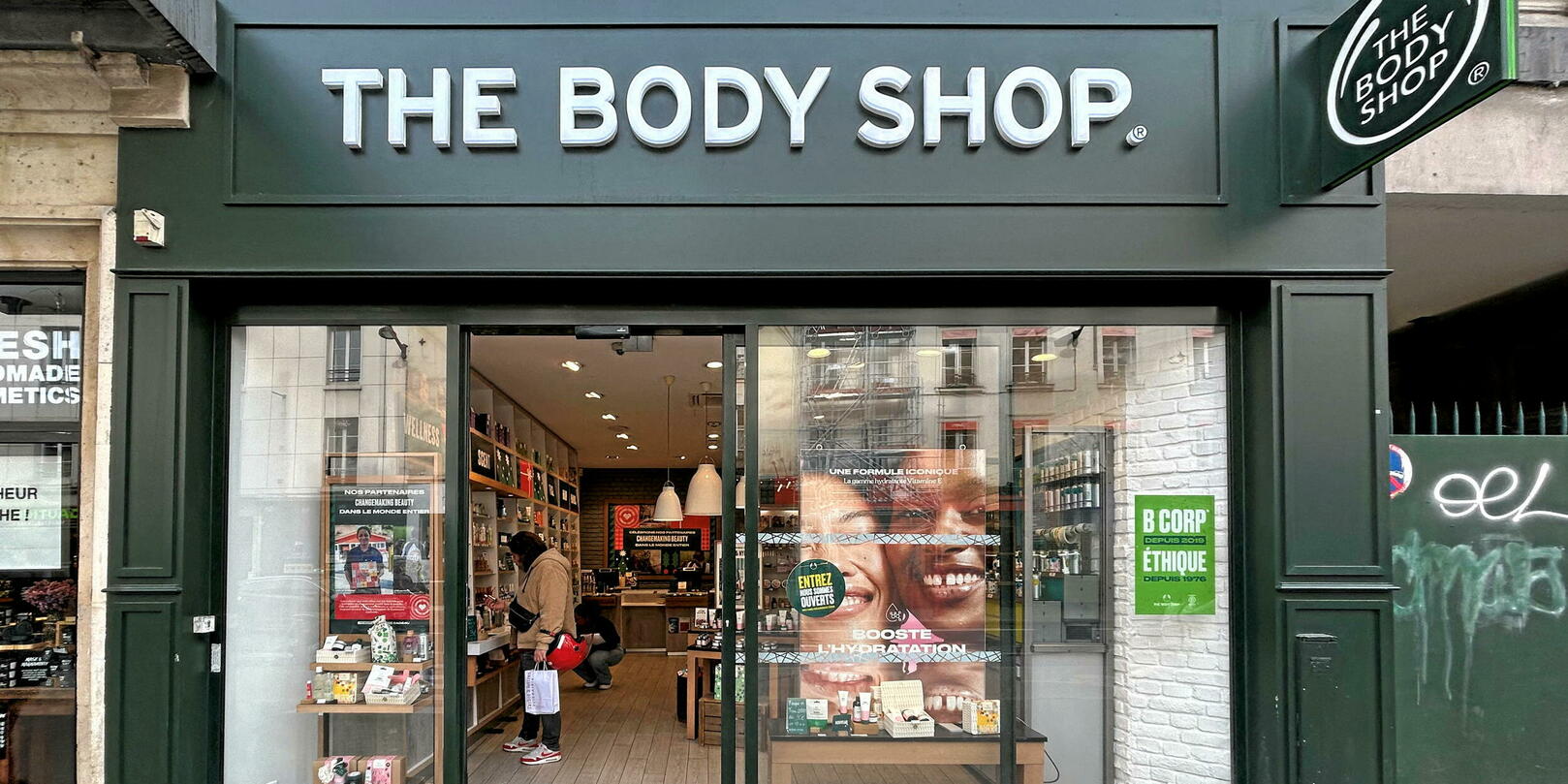Porté par le succès des ETF à Wall Street, le bitcoin bat son record historique
Conçu sur les ruines de la crise de 2008, comme une alternative au système financier, le bitcoin est, quinze ans après, plus que jamais porté par la finance traditionnelle qu'il rêvait de remplacer. Mardi vers 16 heures, il a atteint 69.324 dollars sur Coinbase, en hausse de 4,4 % ces dernières 24 heures et de 19 % en une semaine, portant sa valorisation à 1,34 milliard de dollars. Son précédent record remontait au 9 novembre 2021. Il avait alors tutoyé les 69.000 dollars. Lundi, le bitcoin a aussi, pour la première fois, dépassé le cap des 60.000 euros. En un an, la reine des cryptos a triplé de valeur. A l'époque, les cours des cryptos étaient portés par « l'argent gratuit » lié à l'environnement de taux bas, « l'épargne Covid » constituée pendant la crise et la croyance que la pandémie allait faire des monnaies 2.0, l'argent de l'économie numérique de demain. Mais les commerces ont rouvert et la guerre en Ukraine a attisé l'inflation , que la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont combattue avec succès en relevant les taux d'intérêt. Deux ans de purge effacés Avec un bitcoin au plus haut, c'est comme si les deux dernières années de purge dans le secteur crypto n'avaient pas existé. Au-delà de l'environnement macroéconomique, cette période a pourtant été marquée par des crises retentissantes touchant des acteurs censés être fiables, en tête desquels figurent FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried. Le prodige des maths avait ses entrées à Washington , il croupit aujourd'hui en prison . Son principal concurrent, le patron de Binance Changpeng Zhao a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amende . Sans oublier le prometteur stablecoin Terra , liquidé en 24 heures, le fonds crypto 3AC , ou Celsius … tous tombés. LIRE AUSSI : ANALYSE - Bitcoin : le dernier tour de magie de Wall Street Les traders et gérants parient sur une poursuite de l'envolée du bitcoin en 2024 Malgré ces sérieuses atteintes à la réputation des cryptos - auxquelles on peut ajouter l'effondrement des NFT (jetons non fongibles) , une bulle massive vidée à 95 %, ou les meme coins, ces cryptos parodiques masquant souvent des « arnaques à la bouilloire », et enfin le financement du terrorisme , que la guerre à Gaza a remis sous le feu des projecteurs -, le secteur se relève donc, bitcoin en tête. « Ces conditions rappellent certains moments de fin 2020 et 2021, de marché haussier et d'optimisme extrême », a déclaré à Bloomberg Jaime Baeza, fondateur du fonds spéculatif crypto AnB Investments. « Il existe un fort effet de levier sur le marché et les niveaux d'avidité deviennent extrêmes. » Le « greed index » vient ainsi de toucher les 82 %. Le catalyseur de la hausse a été l'approbation , le 11 janvier par la Securities and Exchange Commission (SEC), de onze fonds indiciels cotés et directement investis en bitcoin (ETF bitcoin spot). Depuis, les gestionnaires d'actifs ont amassé près de 17 milliards de dollars de bitcoin, selon Bloomberg, dont 10 milliards rien que pour BlackRock. Jamais, en trente ans de lancements d'ETF, les émetteurs n'avaient enregistré une telle collecte. Les autres « coins » à la fête Ce puissant moteur est amplifié par un ralentissement de l'inflation en ce début 2024, qui devrait conduire à une détente sur les taux d'intérêt . En ce mois de mars comme par le passé, quand la reine des cryptos s'apprécie, les autres suivent. Sa dauphine, l'ether, a gagné près de 60 % depuis le début de l'année - elle est aussi portée par l'espoir d'entrer à Wall Street via une dizaine d'ETF en mai. A 3.800 dollars, elle reste assez loin de son record historique de plus de 4.600 dollars. Le solana (+32 % depuis janvier), le ripple (+25 %) ou encore le cardano (+50 %) ont également enregistré de belles performances. Les jetons liés à l'IA ont eux aussi fortement progressé en surfant en plus sur les espoirs attachés aux prouesses de l'intelligence artificielle générative (+217 % pour FetchAI en un mois ou +220 % pour SingularityNET). Mais ce sont les « meme coins » qui ont repris le plus de force, notamment le dogecoin (+120 % en un mois), le shiba (+260 %) ou le pepe coin (+690 %). Pour les professionnels, c'est l'un des indicateurs montrant que les particuliers sont revenus dans la crypto. Après être restés en marge du marché pendant deux ans, ils ont lu dans la presse que le bitcoin remonte et ont peur de manquer le prochain cycle haussier. En 2022, leur mauvaise gestion du risque leur avait fait perdre des fortunes .
Tesla : Elon Musk promet un roadster « époustouflant » pour la fin de l’année
Un pied de nez à Apple, qui a abandonné son projet de voiture ? Une tentative de redonner une touche de glamour à Tesla, dont le cours a perdu 20 % depuis le début de l'année, sur fond de ralentissement de la croissance des ventes de voitures électriques ? Elon Musk a ravivé mardi soir les attentes autour du projet de roadster de la marque, pour la première fois évoqué en 2017. « Ce soir, nous avons radicalement amélioré les objectifs de conception de la nouvelle Tesla Roadster, a-t-il écrit sur sa plateforme X. Il n'y aura jamais d'autre voiture comme celle-ci. » LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - « Apple Car » : Tim Cook brise le rêve après dix années d'efforts secrets Le roadster est le modèle historique de Tesla , celui avec lequel la marque s'est lancée en 2008. Se concentrant avec succès sur les berlines, puis les SUV , et enfin le pick-up, Tesla serait sur le point de relancer une petite sportive deux places hypervitaminée. « La conception de la production est terminée » et le modèle « sera dévoilé à la fin de l'année, avec pour objectif une commercialisation l'année prochaine », a précisé le patron. Une accélération record Des déclarations à prendre avec des pincettes. Comment, si l'on prend au mot Elon Musk, Tesla a-t-il pu améliorer ces dernières heures les performances de l'engin, alors que celui-ci a franchi son ultime étape de développement industriel ? Il faut aussi garder en tête que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour le patron de Tesla que pour le commun des mortels. Son dernier modèle commercialisé, le CyberTruck , a été largement retardé. Le roadster lui-même a connu quelques retards à l'allumage. Le projet, dévoilé en 2017, devait initialement être commercialisé en 2020. LIRE AUSSI : PODCAST - Elon Musk accumule les ennuis Cybertruck : le mastodonte de Tesla est-il trop dangereux pour les piétons ? En attendant, Elon Musk vante des caractéristiques étonnantes pour son futur coupé sportif. Celui-ci devrait accélérer de 0 à 60 mph (miles per hour, soit 96 km/h) en moins d'une seconde. « Et c'est la partie la moins intéressante », a-t-il ajouté. Toutefois, le site officiel de Tesla annonce pour l'instant 2,1 secondes pour réaliser le 0 à 100 km/h (ainsi qu'une vitesse de pointe de 400 km/h et 1.000 km d'autonomie). Une collaboration entre SpaceX et Tesla « Il lui faudra de sacrés appuis pour l'empêcher de décoller », a réagi un membre de X. Les fans de Tesla rêvent d'ailleurs d'un roadster volant. Elon Musk ne fait rien pour les décourager. Au contraire. Il met en avant une collaboration entre sa société spatiale, SpaceX , et Tesla sur ce modèle. En 2018, il avait même twitté, sur le ton de la plaisanterie, que « l'option SpaceX inclura environ 10 petits propulseurs de fusée » intégrés de part et d'autre de la voiture. Le tout « améliore considérablement l'accélération, la vitesse de pointe, le freinage et les virages ». Et de lâcher, sibyllin, « peut-être qu'elles permettront à une Tesla de voler… ».
Cosmétiques : The Body Shop va-t-il fermer boutique ?
Cosmétiques : The Body Shop va-t-il fermer boutique ? Depuis le dépôt de bilan de la maison mère britannique de l’entreprise, il y a deux semaines, le sort des 66 magasins français est incertain. Par Antoine Bouchet Publié le 28/02/2024 à 16h34 Les magasins français de l'enseigne pourraient bientôt connaître des ruptures de stock. © JMP / JMP/ABACA Temps de lecture : 1 min Ajouter à mes favoris Google News Commenter Partager Jusqu'à quand tiendront-ils ? L'annonce du placement en redressement judiciaire de la marque au Royaume-Uni et la suppression des 270 postes au siège social de la compagnie de produits de beauté a semé le doute dans l'esprit des salariés français. Outre-Manche, c'est la moitié des 198 boutiques qui vont fermer. LA NEWSLETTER ÉCONOMIE Tous les jeudis à 17h Recevez le meilleur de l’actualité économique. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité. En Hexagone, les 260 employés sont inquiets. Leurs magasins ne sont plus approvisionnés, et le site de la marque est actuellement indisponible. Selon les informations du Parisien, une procédure de conciliation a été ordonnée par le tribunal de commerce dans l'espoir de trouver un accord à l'amiable entre le groupe et sa filière française. À lire aussi André, Kookaï, Gap… : les raisons d'une hécatombe Rachats en série sans succès Le géant L'Oréal en 2006, le brésilien Natura en 2017 et finalement le fonds d'investissement allemand Aurélius en 2023 : en moins de vingt ans, la marque a connu plusieurs repreneurs, sans parvenir à garantir la pérennité de son activité. En janvier, Aurélius annonçait céder ses filiales européennes et asiatiques déficitaires à un autre fonds d'investissement. La filiale allemande a ainsi trouvé un repreneur et été placée en redressement fiscal. La française, elle, n'a pas eu cette chance. Créée en 1976, The Body Shop se démarque de ses concurrents par son approche éthique des produits de beauté à travers la préservation de l'environnement et son engagement pour le commerce équitable et surtout contre les tests sur les animaux. Ces dernières années, la défense de ces thématiq
EXCLUSIF – Nucléaire : la facture prévisionnelle des futurs EPR grimpe de 30 %
Les projets de construction de nouvelles centrales nucléaires se révèlent souvent plus coûteux que prévu. Visiblement, le programme français de relance de l'atome - la construction de six nouveaux EPR2 à Penly (Seine-Maritime), à Gravelines (Nord) et au Bugey (Ain) - ne fera pas exception. Selon nos informations, EDF évalue désormais à 67,4 milliards d'euros le coût de construction prévisionnel des six réacteurs EPR2 commandés par les pouvoirs publics pour engager la relance du nucléaire en France - un nouveau prix estimé « en euros de 2020 ». C'est 30 % de plus que les 51,7 milliards d'euros annoncés par EDF en avril 2021, dans une première estimation rendue publique. Deuxième chiffrage Ce chiffrage intègre les coûts d'investissement pour la réalisation des études d'ingénierie, les contrats de fabrication des équipements et de construction sur le site, les provisions pour risques, les frais de mise en service, de pièces de rechange ou encore les charges de long terme pour démantèlement. Mais il n'intègre pas les coûts de financements, déterminants dans le coût final du projet. EDF avance deux raisons principales à cette révision de son budget prévisionnel. La progression des coûts d'ingénierie d'une part, l'énergéticien ayant décidé de prendre neuf mois de plus que prévu pour finaliser les plans génériques de son réacteur EPR remodelé.
Usbek & Rica – Les communs, obsession des bons ancêtres
TRIBUNE // En novembre 2023, l’OMS alertait sur les dangers d’une pandémie globale touchant un quart de la population mondiale : celle de la solitude, véritable « mal du siècle » selon l’économiste Daniel Cohen. Conséquence du délitement du lien social et du triomphe de l’individualisme, elle dessine le portrait d’une humanité qui peine à « vivre ensemble », à fabriquer du collectif ou à se penser en commun. Or, l’Homme est bien un « animal politique », incapable de trouver le bonheur ailleurs qu’en société et perpétuellement en quête de « communs », ressources partagées et gérées par la communauté. Dans cette nouvelle tribune du Club des bons ancêtres, Yves Pellicier, président de MAIF réfléchi à la résilience de ces « communs ». Le Club des Bons Ancêtres - 29 février 2024 Cette quête s’inscrit dans une histoire. Celle du cum-munus, ou la co-obligation qui nous engage depuis toujours en tant que membres de la « cité ». Elle s’inscrit aussi en réaction au capitalisme et de l’avènement d’une propriété absolue. Elle est enfin une promesse : celle d’un renouveau, portée depuis les années 1980 par le logiciel libre et depuis 2009 par les travaux de la Prix Nobel d’économie Elinor Ostrom. L’idée de « communs » est inséparable du modèle mutualiste de la MAIF, née de l’association d’un petit groupe d’instituteurs qui ont décidé, en 1934 de « mettre en commun ». 90 ans plus tard, MAIF porte toujours une attention sincère à ce qui est partagé, comme en témoigne l’engagement de l’entreprise face à l’enjeu climatique. La question qui se pose à présent est celle de savoir comment la notion de commun va évoluer à l’avenir, face aux aléas géopolitiques et environnementaux. Les communs seront-ils résilients ? Tentative de projection sur 5 générations. Demain : La tête dans les communs Demain, les expérimentations autour des communs ouvriront la voie à une démocratisation du concept, qui fera une entrée fracassante dans l’imaginaire collectif. De Wikipédia aux AMAPs, en passant par l’open source, les communs irriguent déjà nos pratiques sans être nécessairement explicites. Il est temps de mettre un mot sur ces modèles. Pour Valérie Peugeot, prospectiviste au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines d’Orange Labs, il est essentiel de faire un travail de pédagogie auprès des « Monsieur Jourdain des communs », qui n’ont pas toujours conscience de participer au mouvement. C’est la condition sine qua non à la naissance d’un phénomène politique et social d’ampleur, qui place l’auto-organisation, la coopération et la gestion collective au cœur de ses principes. C’est également un moyen de faire converger des initiatives et des pratiques qui restent aujourd’hui disparates et dispersées. À nos enfants : La tentation du repli Malgré tout, un certain nombre de forces s’opposeront toujours à l’affirmation des communs. La première force d’opposition émane de ceux qui bénéficient le plus du régime de propriété absolue, dont les intérêts s’opposent au développement de nouveaux modèles de coopération et de solidarité. Dans ce contexte, le futur proche des communs est nécessairement une histoire de conflits, dont on perçoit d’ores et déjà des signaux faibles, dans la privatisation des espaces naturels. A la fois anecdotique et éclairante, la fermeture de certains chemins de randonnée en Chartreuse au bénéfice de chasses privées laisse imaginer la nature des conflits à venir, entre fervents défenseurs des communs et propriétaires. Dans la mesure où leur fonction sociale consiste à préserver les ressources et ce qui compte pour une société, les communs s’inscrivent dans une écologie politique. Édouard Jourdain - Politologue Partager sur Twitter Partager sur Facebook De manière plus générale, le durcissement d’une société de plus en plus anxiogène est de nature à favoriser les logiques de repli, peu propices aux grandes actions collectives. Vincent Cocquebert, auteur de La Civilisation du cocon explique ainsi que « beaucoup ressentent le besoin de se lover dans leur propre « safe space », qui n’est plus un espace politique pour mettre en place des leviers vers l’action, mais plutôt un lieu où se couper du monde ». À nos petits-enfants : Les communs par la base (et par KO) À plus long terme, les logiques de repli comme les mécaniques de confiscation des biens sont amenées à se heurter à la réalité du monde. Face au dépassement des limites planétaires, la prise en compte des communs s’impose comme une nécessité. « Dans la mesure où leur fonction sociale consiste à préserver les ressources et ce qui compte pour une société, les communs s’inscrivent dans une écologie politique », explique ainsi le politologue Édouard Jourdain. Dans ce contexte, nous assistons à l’invention d’un nouveau type d’organisation, en mesure de protéger les communs. Cette transformation émane de la base, guidée par ceux dont les idéaux, la vision du monde et parfois même la survie est menacée. A l’image des 301 instituteurs qui se sont réunis pour inventer leur propre modèle mutualiste et se soustraire aux sociétés capitalistes d’assurance, l’entreprise militante de demain résulte de regroupements d’un genre nouveau. Parfois violente, cette transformation donne également lieu à de nouvelles formes de collaborations, dans une lente hybridation du capitalisme. L’idée – proposée par le Réseau Université de la Pluralité – d’une entreprise pensée comme un Syndic de Communs « prenant en charge la gestion de ressources partagées sous la forme de Communs, pour en décharger les membres de la communauté et en garantir l’accès comme la préservation », pourrait alors s’imposer. À quatre générations : L’entreprise militante face à la corruption des communs Même installée dans le paysage économique, l’entreprise militante qui émerge alors doit maintenir des équilibres fragiles, qui caractérisent la gouvernance des communs. Le premier risque est celui du « commons washing », qui consiste à afficher un engagement de façade sans transformer les pratiques. L’émergence de « faux communs » représente également une menace pour l’entreprise militante, qui doit veiller à ne pas assimiler toute pratique collective ou mutualisée à du « commun » au sens noble mais bien à embarquer toutes ses parties prenantes dans un projet politique et social. Les plateformes numériques, qui joueront à l’avenir un rôle central dans l’économie, auront à terme cette capacité à créer les conditions sociales et technologiques du partage, tout en ayant développé des modèles de gouvernance et de rétribution moins extractifs. À 150 ans : Le mutualisme au coeur d’un kaléidoscope de modèles Face au risque de corruption, la question des communs conduit comme souvent à celle de leur gouvernance. Dépassant les clivages traditionnels du public et du privé, de la nationalisation ou de la privatisation, cette dernière appelle de nouveaux modèles d’organisation. Or, un monde économique basé sur les communs n’est pas dogmatique, ni rigide, il donne lieu à la naissance d’une myriade de modèles et de modes de gouvernance : à « un million de révolutions tranquilles », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Bénédicte Manier. Dans ce bouillonnement d’initiatives démocratiques et d’expérimentations, le mutualisme s’impose comme une forme stable et efficace de modèle de gouvernance. Dans 150 ans, il ne se distingue plus de l’entreprise traditionnelle, qui en a adopté les grands principes afin de répondre aux enjeux collectifs des années à venir. Après plusieurs siècles de jachère, les communs ont retrouvé un rôle incontournable dans le fonctionnement des sociétés humaines.
Apple : l’UE inflige 1,8 milliard d’euros d’amende au géant américain –
Écouter cet article Powered by ETX Studio 00:00/02:50 La Commission européenne a infligé, ce lundi 4 mars, à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros pour non-respect des règles de concurrence de l'UE sur le marché de la musique en ligne, une sanction inédite contre laquelle le géant américain a décidé de faire appel. Spotify, très populaire plateforme de streaming musical, avait saisi Bruxelles contre les pratiques du géant californien, jugées contraires aux règles européennes de "concurrence loyale" et qui ne permettent pas selon lui de "garantir la liberté de choix aux consommateurs et un environnement équitable aux développeurs" Au terme d'une enquête formelle ouverte en juin 2020, l'exécutif européen a donné raison au requérant. PUBLICITÉ "Pendant une décennie, Apple a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d'applications d'écoute de musique en streaming" via sa boutique d'applications AppStore, a expliqué la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager. Le groupe à la pomme a ainsi mis en place des restrictions pour empêcher les développeurs d'applications de promouvoir auprès des usagers sur iPhone et iPad "des services alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l'écosystème Apple", le Music, a-t-elle ajouté. "Ceci est illégal : en vertu des règles antitrust de l'UE, nous avons donc aujourd'hui infligé à Apple une amende de plus de 1,8 milliard d'euros", a-t-elle indiqué. Le groupe devra par ailleurs mettre fin aux pratiques épinglées et s'abstenir à l'avenir d'adopter des dispositifs équivalents. LIRE AUSSI : YouTube, Netflix, Amazon Prime : comment ils sont devenus les rois de l'info... et du sport "Dissuader Apple de répéter l'infraction" C'est la première fois que l'UE sanctionne Apple pour infraction aux règles de la concurrence. Ce montant est jugé "proportionné aux revenus mondiaux" du groupe de Cupertino (Californie) et "nécessaire pour être dissuasif", a précisé l'exécutif européen dans un communiqué. "Une telle amende forfaitaire était nécessaire, car une partie importante du préjudice est non monétaire et ne peut être correctement prise en compte en se fondant sur les recettes (...) Et l'amende doit être suffisante pour dissuader Apple de répéter la présente infraction ou une infraction similaire", insiste la Commission. L'objectif est également de "dissuader d'autres entreprises de taille similaire et disposant de ressources similaires de commettre la même infraction". Apple a aussitôt annoncé qu'il ferait appel de l'amende infligée. Le groupe a déploré une sanction "prise en dépit de l'incapacité de la Commission à découvrir la moindre preuve crédible d'un préjudice causé aux consommateurs". L'amende "ignore les réalités d'un marché florissant, compétitif et en croissance rapide", a réagi le géant américain. Apple accuse de son côté Spotify de chercher à profiter "sans payer" des avantages de l'App Store et de ses "outils et technologies" qui "ont contribué à faire" de la plateforme suédoise "l'une des marques les plus reconnaissables au monde"
SNCF : Réseau, le sempiternel maillon faible du groupe
Le gendarme des transports tire le signal d'alarme au sujet de SNCF Réseau. Malgré l'effacement par les contribuables de 35 milliards de dettes accumulées dans le passé, puis le versement de 4,3 milliards de cash par l'Etat au plus fort de la crise du Covid, cette société anonyme logée au sein du groupe SNCF reste un réel élément de fragilité - et un motif d'interrogation à moyen terme dans la galaxie ferroviaire nationale. L'entreprise, qui entretient les 27.700 kilomètres de lignes avec plus de 50.000 agents et qui se rémunère en grande partie avec les recettes des péages ferroviaires , vit de plus en plus aux crochets de SNCF Voyageurs et de l'Etat-actionnaire. Ce qui n'était pas le sens de la démarche du « contrat de performance » signé avec l'Etat en 2022 pour la période 2021-2030, comme le pointe un avis sans concession de l'Autorité de régulation des transports (ART), publié début février. Dérive de la marge opérationnelle Après examen du projet de budget 2024 de l'ex-Réseau ferré de France (RFF), l'ART ne mâche pas ses mots, dans un avis adopté fin novembre mais publié quelques mois plus tard : « Pour la troisième année consécutive, SNCF Réseau ne respectera pas la trajectoire de marge opérationnelle prévue par le contrat de performance pour la période 2021-2020, en contravention avec ses statuts. » LIRE AUSSI : L'Etat et la SNCF proches d'un accord sur la modernisation du réseau ferroviaire SNCF : pourquoi les grèves se suivent et ne se ressemblent pas Car depuis 2022, retrace le gendarme des transports, la filiale de la SNCF « s'écarte progressivement de l'ensemble des indicateurs de performance financière prévus au contrat ». Malgré la reprise des trafics ferroviaires, particulièrement nette après la fin des confinements. LIRE AUSSI : La SNCF boucle une année « pas simple » avec des bénéfices divisés par deux Pour 2023, sa marge opérationnelle « s'établit largement au-dessous de son objectif fixé par le contrat, ce qui conduit à une rentabilité nettement inférieure à la trajectoire prévue », poursuit l'Autorité. La sacro-sainte « règle d'or » (le ratio entre dette financière et marge opérationnelle), prévue dans le pacte ferroviaire de 2018, « décroche fortement de sa trajectoire initiale », ajoute l'organisme indépendant. Le poids de l'inflation Sur le plan des recettes, les grèves à la SNCF du premier trimestre 2023 ont engendré des trafics annuels, donc des péages, en net retrait par rapport à la trajectoire du contrat (-6,3 %). Côté coûts, l'inflation générale, dont celle des chantiers de BTP et les hausses de salaires versées à tous les cheminots SNCF (+12 % en deux ans), pèse sur les comptes. LIRE AUSSI : TGV : les records de la SNCF bridés par le manque de trains « Le contrat de performance élaboré en 2021 comportait une vraie ambition de trafic supplémentaire, mais la réalité a été inférieure, commente une source informée. Les recettes des redevances ont été inférieures aux prévisions, l'arrivée de nouveaux entrants (Trenitalia, Renfe) a été plus progressive que prévu, et les coûts ont augmenté avec la crise inflationniste. Pour 2024, Réseau n'a pas voulu répéter le même scénario. » Soutien financier intragroupe Dans ce contexte plutôt adverse, les investissements dans la rénovation des voies ont perduré, et seront même amplifiés en 2024, grâce à un outil magique : le « fonds de concours ». Cette sorte de budget annexe, géré directement par Bercy, acte le fait que l'Etat-actionnaire renonce à ses dividendes sur la SNCF et les reverse en totalité dans la modernisation du réseau ferré. SNCF Voyageurs surtout , mais aussi les filiales Keolis ou Geodis, apportent ainsi leur écot, qui va croissant. Des vases communicants traduisant la dépendance croissante de Réseau au groupe SNCF en matière de soutien financier. Déjà, l'an dernier, l'ex-RFF avait reçu un « abondement exceptionnel du fonds de concours très supérieur à la prévision du contrat », soit 858 millions de plus, note l'ART. En 2024, Réseau « bénéficiera de 1,71 milliard de concours financiers provenant du groupe SNCF , un niveau inédit » selon l'autorité publique indépendante. Le fonds de concours a ainsi été abondé de 313 millions, plus les 300 millions supplémentaires alignés dans le cadre du « plan à 100 milliards » de relance du ferroviaire annoncé par l'ex-Première ministre Elisabeth Borne . De quoi contribuer aux grands travaux nationaux (nouveau système de signalisation ERTMS, future ligne TGV Bordeaux-Toulouse, Roissy-Picardie…) LIRE AUSSI : TGV : le marché français résiste plus que prévu à Trenitalia Face à une telle dérive, l'ART préconise deux pistes pour le gestionnaire d'infrastructures : « favoriser à moyen terme une croissance de l'offre de transport », notamment sur la grande vitesse. En clair, multiplier les rabais sur les péages à de nouveaux entrants. « Mais à la fin, ce sont toujours les exploitants qui ont besoin de matériel roulant et qui décident, de même pour les autorités organisatrices qui calent leurs plans de transport », tempère une source ferroviaire. Second levier préconisé, « accentuer les efforts pour maîtriser les coûts d'exploitation » : ce qui aurait été réalisé en bonne partie, SNCF Réseau ayant démontré à l'ART être sur la trajectoire prévue en matière d'économies pour la partie qui lui incombe en propre. L'objectif est de comprimer ses dépenses (achats, etc.) de 1,5 milliard sur une longue période 2017-2026.
Le gouvernement lance un appel à projets « Culture immersive et métavers »
En 2021, Emmanuel Macron dévoilait le plan d’investissement France 2030. Doté de 54 milliards d’euros, il doit permettre de rattraper le retard industriel français, d’investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. Dans ce cadre, le gouvernement veut développer la filière immersive au sein du secteur de la Culture. Lors de Viva Tech 2023, Emmanuel Macron annonçait déjà consacrer 200 millions d’euros pour les technologies immersives et le métavers, dont 150 millions consacrés aux œuvres culturelles. C’est pourquoi il lance un appel à projets « Culture immersive et métavers ». L’objectif est de développer la production et la diffusion d’expériences immersives, au service de la démocratisation culturelle et de l’élargissement des publics. Le dispositif accompagnera des projets innovants qui permettent de faire un saut technologique à la production et/ou à la diffusion d’expériences culturelles dans les environnements immersifs et les métavers (mondes virtuels persistants, réalité virtuelle, augmentée ou mixte, videomapping, son 3D).
Réchauffement climatique : Combloux, Saint-Gervais, quel avenir pour les stations de ski du Mont-Blanc ?
Dans les stations-villages de moyenne altitude du pays du Mont-blanc, comme Saint-Gervais-les-Bains ou Combloux, l'enneigement commence à devenir un vrai sujet. A en croire les professionnels, les dégâts sont limités pour l'instant cette année. « Notre domaine skiable monte jusqu'à 2.400 mètres d'altitude, or la neige est de bonne qualité sur sa partie haute ! Nous allons même battre notre record de fréquentation cet hiver », assure Didier Josèphe, le directeur de l'Office de tourisme de Saint-Gervais. Même discours à Combloux où 80 % du domaine skiable était ouvert la même semaine. Mais l'inquiétude pointe pour la suite de la saison, malgré les canons à neige. « Les enneigeurs fonctionnent entre -5 °C et -2 °C. Or c'est un peu juste en ce moment, même la nuit… », s'alarme Françoise Jacquier, chargée de la transition au conseil municipal de Combloux. Il n'est pas sûr que les quelques centimètres tombés ces derniers jours l'aient rassurée. LIRE AUSSI : Le territoire du Mont-Blanc face au défi du tourisme toutes saisons Ski : les gros tourments des petites stations Ici, comme partout en moyenne montagne, le réchauffement climatique devient réalité, un peu plus vite qu'ailleurs. Selon Météo France, la température moyenne dans les Alpes a déjà augmenté de +2 °C au cours du vingtième siècle, contre +1,4 °C en moyenne en France. Au pied du Mont-Blanc, la dernière étude « ClimSnow » est devenue la bible des élus locaux. Réalisée par les scientifiques de Météo France, l'Inrae et Dia4s, elle fournit pour chaque territoire des projections sur plusieurs décennies en matière de température et d'enneigement. Pistes fermées jusqu'au 15 janvier « A Saint-Gervais, il y aura davantage d'années sans neige… », reconnaît, en s'y référant, Jean-Marc Peillex, le bouillonnant maire du village (par ailleurs réputé pour sa croisade contre le surtourisme dans la région). Et ce, même s'il se dit convaincu qu'« il n'y a pas de réchauffement climatique… Seulement un changement climatique, qui existe depuis des décennies ! » Il n'y a pourtant guère de doute. L'évolution du climat s'accélère à vitesse grand V. Il y a certes toujours eu des hivers sans neige dans la région, mais depuis une dizaine d'années, ils se sont multipliés. En 2016, les enfants inscrits à l'école de ski de Combloux ont dû être transportés par bus aux Contamines-Montjoie, à une demi-heure de route. LIRE AUSSI : ENQUÊTE - Surtourisme : l'édifiante bataille du Mont-Blanc Ski : les stations des Pyrénées investissent pour anticiper la fonte des neiges L'an dernier, les pistes sont de même restées fermées jusqu'au 15 janvier . « Le directeur de l'école de ski a dû proposer d'autres activités pour les enfants inscrits : 70 % d'entre eux ont maintenu leur inscription », raconte Aurélien Astre, le directeur de l'office de tourisme. A Saint-Gervais, il a été décidé de fermer partiellement le domaine skiable dès le 1er avril cette année, au lieu du 15 avril habituellement, notamment en raison de la faible rentabilité sur la quinzaine. « C'est compliqué depuis trois ans » Les professionnels du ski ne sont pas les seuls à être touchés. Face à au panorama extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc depuis Combloux, l'accompagnateur en montagne Rémy De Vos a vu le nombre d'itinéraires possible pour ses sorties en raquettes fondre - lui aussi - comme neige au soleil. Cette année, il a même renoncé aux sept igloos qu'il bâtissait traditionnellement pour héberger des touristes, de fin janvier à mi-mars, à 1.600 mètres d'altitude. « C'est compliqué depuis trois ans. L'an dernier les parois des igloos ont fondu à certains endroits, j'ai dû mettre des bâches, qui s'envolaient avec le vent… une vraie galère ! J'ai préféré ne pas prendre le risque cette année », dit-il. Pour les guides de haute montagne aussi, le métier a changé. Point de départ du tramway à crémaillère qui mène au nid d'Aigle, première étape de la voie normale de l'ascension du Mont-Blanc, Saint-Gervais est réputée pour l'alpinisme. Mais le réchauffement fait fondre le permafrost, jusque-là gelé en permanence, provoquant des risques de chutes de blocs sur les parcours. « Depuis une dizaine d'années, certaines courses deviennent dangereuses l'été. Alors, on se creuse la tête pour en trouver d'autres, on se convertit aux itinéraires rocheux… », raconte Olivier Begain, président de la Compagnie des guides. Sources taries Le réchauffement climatique frappe aussi de plein fouet un autre secteur crucial dans la région : l'agriculture. Guillaume Mollard, qui exploite un élevage de 66 vaches dans la vallée, à quelques kilomètres de Saint-Gervais, en témoigne. « Depuis 2003, on doit monter de l'eau à l'alpage en moyenne tous les deux ans. Mon arrière-grand-père avait dû le faire une fois pendant sa carrière. Et mon grand-père, trois fois… », raconte-t-il. La fonte des neiges alimente la source qui permet aux animaux de s'abreuver. S'il neige moins, la source se tarit. « Il n'est pas rare, désormais, qu'il n'y ait plus d'eau dès le 10 juillet », se désole-t-il. Problème : une vache consomme 100 litres d'eau par jour. Ces dernières années, les communes ont dû financer des retenues d'eau pour alimenter les alpages, qui le plus souvent leur appartiennent. « Nous avons de notre côté investi 70.000 euros en 10 ans dans les réseaux d'eau. Nous récupérons aussi l'eau de pluie pour laver les machines, nous avons installé des toilettes sèches pour les randonneurs… », indique Guillaume Mollard. Une nouvelle cuve de stockage d'eau a été installée l'an dernier à proximité de l'alpage de Flavie Melendez, agricultrice à Saint-Gervais.DR Sans parler de l'impact du réchauffement sur l'alimentation des animaux. « On n'arrive plus à récolter assez de fourrage lors de la deuxième coupe de nos champs ! Depuis 3 ou 4 ans, nous sommes obligés d'en acheter ! », explique Flavie Melendez de la ferme des Roches Fleuries, qui exploite deux troupeaux (25 vaches et 40 chèvres laitières). Ces fermes de Haute-Savoie n'ont pas trop le choix. Elles vivent du reblochon AOP (d'appellation d'origine protégée), un label qui les contraint à nourrir les vaches de fourrages locaux et de les faire pâturer pendant au moins 150 jours. Les températures pèsent aussi sur la productivité des animaux. Lors de la canicule de 2022, elles ont grimpé à 40 °C au soleil à 1.750 mètres d'altitude, sur l'alpage de Guillaume Mollard. « Les vaches ont perdu 100 kilos, un sixième de leur poids ! Et leur production de lait a diminué de 4 ou 5 litres par jour, sur 25 litres… », dit-il. « Nous n'avons pas de leçons à recevoir ! » Pour l'économie locale, la menace est patente. Comment affronter un avenir moins enneigé ? Même si les élus de ces stations-villages ont commencé à se diversifier il y a vingt ans déjà, les sports d'hiver restent le socle de l'économie touristique locale, admet Didier Josèphe. A Combloux, sur les 38 millions d'euros de revenus générés par le tourisme, 32 millions le sont en hiver. « Il y a deux ou trois générations, c'était la misère ici. C'est grâce au ski que nous en sommes sortis… », rappelle de son côté Benoît Thomasson, directeur général des services à la mairie. LIRE AUSSI : Climat : la Cour des comptes s'inquiète pour l'avenir des stations de ski Climat : la station de Métabief reçoit le satisfecit de la Cour des comptes S'ils reconnaissent la nécessité de s'adapter, les acteurs locaux ne masquent pas leur agacement face à « une vision jacobine » qui leur imposerait « des décisions péremptoires depuis Paris ». « Nous n'avons pas de leçons à recevoir ! », tacle Benoît Thomasson. Neige de culture Pas très bien accueilli dans la région, le rapport de la Cour des comptes paru il y a quelques jours considère par exemple la neige de culture comme une « mal adaptation ». « Au contraire, c'est l'avenir ! », répond Jean-Marc Peillex. « Elle permet de stocker, sous forme de neige, de l'eau qui sinon partirait tout droit à la mer. » Les retenues d'eau ici sont alimentées, non pas par pompage des nappes phréatiques, mais avec de l'eau de pluie ou des torrents, et les enneigeurs fonctionnent sans adjonction de produits chimiques. En outre, les retenues collinaires servent aussi l'été de plan d'eau pour les touristes ou de réservoir pour les animaux, font valoir les élus. Pour le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, la neige de culture permet de stocker de l'eau qui, sinon, partirait tout droit à la mer.C. Stramba-badiali/Haytham-rea Quant à l'énergie nécessaire, « nous en avons trop dans la région ! » balaie le maire de Saint-Gervais. Le directeur du domaine skiable de la station, Alexandre Merlin, invoque, lui, plutôt l'emploi local. « C'est de l'énergie qui sert à faire vivre des dizaines de gens en montagne. Pour moi, ce n'est pas de la mal adaptation », avance-t-il. VTT, parapente, luge 4 saisons, nage en eau froide… Depuis plusieurs années, ces stations-villages proposent de nouvelles activités hors ski - même en hiver. Dans le ciel bleu de ce 15 février, les montgolfières ayant décollé de Praz-sur-Arly (qui appartient aussi à la communauté de communes du pays du Mont-Blanc) dérivent à l'horizon. Les thermes de Saint-Gervais ont été rénovés. Les offres fleurissent : VTT, trottinette, parapente, via-ferrata, canyoning, saut à l'élastique, luge 4 saisons, nage en eau froide. De même que les festivals ou les visites culturelles du patrimoine local (les jolies églises baroques pullulent dans la région). Combloux a même créé un « escape game » : « le mystère du chalet abandonné ». LIRE AUSSI : ENQUÊTE - Skier vert, piste rouge Certains investissements sont revisités en conséquence. A Saint-Gervais, l'espace de ski « débutants » a été déplacé de 1.400 à 1.800 mètres d'altitude, pour préserver le plus longtemps possible les écoles de ski. Le nouveau télésiège du Chattrix, inauguré en 2019 à Saint-Nicolas-de-Véroce, pourra être adapté au transport de VTT si besoin, assure Alexandre Merlin. A Combloux, l'investissement de 14 millions d'euros prévu dans le remplacement du télésiège de Beauregard, à compter de l'hiver 2025/2026, prévoit déjà, lui, un équipement mixte (sièges et cabines) qui permettra de monter les VTT en été . « Mais on ne veut pas faire une montagne Disneyland… », assure Aurélien Astre. Elus désarçonnés L'inflexion est encore timide. Les acteurs locaux semblent désarçonnés face au bouleversement qui s'annonce. Ils espèrent attirer de nouveaux habitants pour faire vivre leurs bourgs, misent sur le panorama, l'artisanat, les « valeurs » du « territoire », un nouveau tourisme de « contemplation »… Tout en reconnaissant que la transition n'aura rien d'évident. « On n'inventera pas le modèle qui nous permettra de générer 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 semaines (comme aujourd'hui les remontées mécaniques), il ne faut pas se mentir… », déplore Benoît Thomasson. Comme la plupart des professionnels rencontrés, le directeur du domaine skiable de Saint-Gervais, Alexandre Merlin, avoue avoir tout juste entamé sa réflexion sur l'adaptation au changement climatique. « C'est devenu une préoccupation de tous les jours », dit-il. « Mais on n'a pas encore trouvé les réponses… »

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.