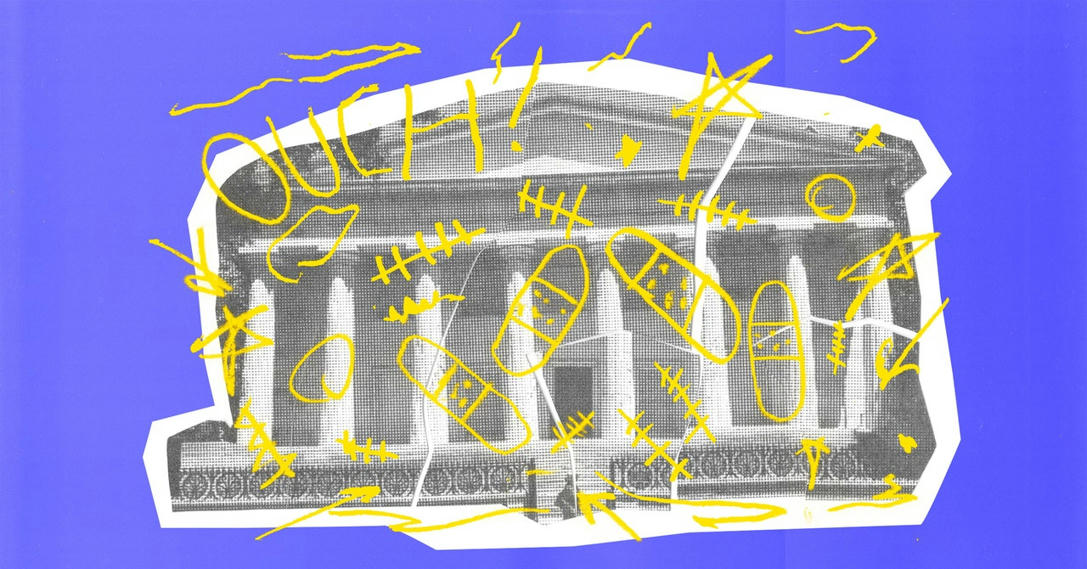Les entrepreneurs des NFT vont-ils au casse-pipe juridique ?
C'est l'histoire d'une start-up qui, comme tant d'autres, a l'idée d'émettre des NFT. Fairplayer doit vendre des jetons aux fans de petits clubs de sport pour les aider à se financer et à animer leur communauté. Intention louable. Comme dans le financement participatif, les soutiens ont une contrepartie : accès aux joueurs et goodies. Seulement, le flou sur le statut juridique des NFT l'en dissuade. Ses avocats craignent une requalification à venir qui lui serait mortelle. Alors que le grand raout Virtuality Web3 Summit 2023 se déroule ce vendredi à Paris, l'écosystème des NFT, de la crypto et de la blockchain clame être entré dans une phase de construction, devant tourner la page de la spéculation de 2021 et du début 2022. Mais la réglementation de ce jeune secteur est, elle aussi, en construction. Entre le tour de vis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à la suite du crash de FTX, et en attendant le règlement européen MiCA en 2024, les start-up du Web3 ne savent pas toujours à quel saint se vouer. Des projets Web3 sans NFT Le PSG a peut-être ses NFT, comme d'autres clubs de foot dans le monde, mais Fairplayer préfère jouer la prudence. « Nos avocats nous ont conseillé de les éviter car, lorsqu'on en émet et qu'on assure les échanges sur le marché secondaire, il faut s'enregistrer comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) », rapporte Rémi Gilliot, cofondateur du start-up studio Lab-0x, qui accompagne la start-up. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Après le crash de FTX, les investisseurs du « Web3 » méfiants La procédure est beaucoup trop lourde et apparaît, aux yeux des fondateurs, surdimensionnée pour une initiative avant tout marketing. « Cela demanderait de procéder à une identification des utilisateurs ( KYC ), ce qui serait trop dissuasif pour juste accéder aux loges des joueurs », pointe Rémi Gilliot, qui s'interroge sur le degré de conformité avec la loi de certains clubs. Du coup, la start-up accompagnée par une structure Web3 … n'utilise même pas de blockchain et recourt à des contrats classiques, tout en planchant sur un modèle hybride utilisant des NFT. Clubs de sport et immobilier tokenisé Le Rugby club toulonnais, lui, a lancé ses NFT en janvier. Créés en marque blanche par le site Tailor, ils sont la propriété du club. Mais ni l'un ni l'autre n'est enregistré PSAN. Les jetons sont gratuits et servent à emporter un souvenir du stade. D'autres sont à 5 euros et « donnent des avantages exceptionnels ». La somme, modique, ne sert pas à lever des fonds ni à spéculer. LIRE AUSSI : Sorare ne sera pas régulé comme un jeu d'argent « Nous avons été transparents sur le process et acculturé les équipes », souligne Karen Jouve, fondatrice du cabinet Doors3, qui a cadré ce projet. Pour elle, il faut distinguer « les activations marketing et les tokens à logique financière ». Se voulant rassurante, elle dit rester attentive. Les NFT immobiliers sont aussi concernés. Le français Wincity affiche, en gros sur son site, qu'« une candidature à l'enregistrement PSAN est en cours, une première dans l'immobilier NFT ». Un cadre juridique assez clair en France Derrière leurs trois lettres, les NFT cachent une multitude de fonctions qui demandent aux avocats-conseils une étude au cas par cas. Selon leur destination, ils peuvent être qualifiés d'actifs numériques, d'instruments financiers ou (c'est plus rare) de monnaie numérique. Ils entrent alors dans le champ de l'AMF. Lorsqu'ils sont par exemple employés par des marques comme outils marketing , ils sont des biens immatériels encadrés par le code de la consommation. L'article L222-16-2 stipule ainsi que « toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services sur actifs numériques ». « C'est pour cette raison que certaines opérations menées dans le cadre d'activités sportives ont dû rétropédaler », pointe Franck Guiader, chez Gide. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - La mutation des NFT en 5 questions Scandale FTX : les acteurs des cryptos soumis à plus de règles en France « Une série de facteurs aident à déterminer si un NFT est un actif numérique ou un instrument réglementé : s'il est édité en grande série ou pas, s'il est échangeable, ou s'il donne accès à des prérogatives au-delà de l'image à laquelle il est associé », explique Matthieu Lucchesi, chez Gide. Pour lui, « le marché s'organise autour de cela » et « les start-up ne vont pas au casse-pipe si elles sont bien préparées », même s'il voit que « certains projets doivent pivoter ». Réglementer des épées magiques Le numéro un français du secteur, Arianee, propose aux marques (notamment de luxe) d'associer un NFT à un produit, comme une montre, afin qu'il fasse office de preuve de propriété. Ces jetons-là ne sont pas commercialisés ni revendables sur le marché secondaire. Son émetteur reste donc bien loin d'une requalification - lourde et coûteuse - en PSAN. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Pourquoi certains préfèrent les NFT à d'autres moyens de financement DECRYPTAGE - Fiscalité des NFT : 10 questions pour essayer de s'y retrouver « Comme dans toute situation de rupture, il faut accepter que ce ne soit pas simple », pointe Frédéric Montagnon, cofondateur d'Arianee. Mais pour celui qui est aussi membre actif du lobby des cryptos Adan, « les entrepreneurs doivent aussi accepter de mener le débat, et représenter leurs cas d'usage, alors que des règles trop mouvantes risquent d'étouffer l'innovation ». Quoi qu'il en soit, les avocats ne voient pas la réglementation imposer aux NFT de tous devenir des actifs numériques. L'AMF, qui est déjà réputée débordée par les demandes d'enregistrement PSAN, « n'a pas vocation à réglementer des jetons d'épées magiques dans des jeux vidéo ».
La licorne Via rachète l’application Citymapper –
Dans la foulée du récent tour de financement de Via d’un montant de 110 millions de dollars, l’acquisition de Citymapper – dont le montant n’a pas été révélé – va permette de créer une infrastructure digitale end-to-end pour les systèmes de transport public. Via, société valorisée à 3,5 milliards de dollars, développe des solutions pour les villes et les agences de transport public afin qu’elles puissent planifier et exploiter efficacement leurs réseaux. De son côté, Citymapper est une application mobile utilisée par plus de 50 millions d’utilisateurs dans plus de 100 villes. Elle permet à ses utilisateurs de planifier un déplacement en fonction de différents critères : mode de transport en commun, heure d’arrivée, durée du voyage, coût, etc. La solution Citymapper sera intégrée à la plateforme logicielle TransitTech de Via et profitera ainsi aux clients professionnels de la société américaine. Citymapper continuera d’être disponible pour sa base d’utilisateurs dans le monde entier. Via prévoit d’étendre sa portée mondiale.
NFT : quelles sont les initiatives dans le tourisme ? –
En avril dernier, Air Europa, la troisième plus grande compagnie aérienne espagnole, annonçait son partenariat avec la société technologique TravelX afin de créer la première série de billets d’avion NFT au monde. La compagnie aérienne a vendu une série de 10 NFT. Chacun contenait un billet pour un vol spécial vers Miami pour le 29 novembre prochain, une œuvre d’art numérique ainsi que des entrées pour plusieurs évènements dans le cadre de la MIAM ART WEEK qui se déroule en décembre. L’intérêt de vendre ces billets en NFT est de pouvoir laisser la possibilité à son acquéreur de le revendre, ce qui n’est pas possible avec un billet classique aujourd’hui. Passé une date limite, le billet est émis et donne la possibilité au dernier acquéreur de voyager. Une nouvelle pratique qui pourrait faire émerger un marché de seconde main pour les billets d’avion. « Cela va changer les règles de la distribution dans le tourisme, qui n’a même pas évolué jusqu’à présent. Nous avons maintenant la possibilité de nous réinventer. Nous sommes persuadés que cette technologie peut représenter un grand pas en avant pour le tourisme afin d’améliorer l’expérience client des passagers. Nous voulons y participer », nous confie Bernardo Botella, Directeur des ventes mondiales d’Air Europa. La compagnie aérienne entend continuer cette collaboration avec TravelX sur le long terme afin de continuer de vendre des NFT. Des NFT pour donner accès à des avantages Travala, une agence de voyage en ligne basée sur la blockchain Ethereum, expérimente quant à elle les NFT pour fidéliser sa clientèle. La société a mis en vente 1 000 Travel Tigers, des NFT donnant accès au statut Smart Diamond. En plus de profiter de 10% de réduction sur les prix, les acquéreurs peuvent profiter de deals exclusifs sur des voyages et billets d’avion et profiter d’invitations à des évènements dans la vraie vie ainsi que dans le métavers. Avec cette vente de NFT, Travala veut créer une communauté autour de sa plateforme en la récompensant. C’est aussi ce qu’à choisi d’expérimenter Travel Prime, la première plateforme d’abonnement du tourisme. Présenté au salon IFTM Top Resa, cette nouvelle plateforme permettra aux utilisateurs d’épargner pour leurs futurs voyages. Au fur et à mesure de leur abonnement, des offres leur seront proposées à des prix plus avantageux grâce à l’usage de la blockchain et son principe de désintermédiation. Pour son lancement, elle va mettre en vente une série de 5 000 NFT avec des indices de rareté. Chaque acquéreur profitera de la gratuité des frais d’abonnement à vie. « Il faut mettre de l’utilité dans les NFT et c’est ce que nous essayons de faire dans le tourisme », a déclaré Michel Ruiz, CMO de Travel Prime lors d’une interview vidéo réalisée par TOM.travel. Cette communauté de premiers utilisateurs pourra être consultée lors de modification apportée au service. Les acteurs institutionnels aussi s’intéressent aux jetons non fongibles. L’office de tourisme de Dunkerque a signé un partenariat avec la jeune société WYTLAND afin de créer une collection de NFT destinée aux plus jeunes générations. Créées par des artistes locaux, ces NFT sont des pièces à collectionner qui donnent des avantages exclusifs sur le territoire.
Crypto Faces a Banking Crisis. For Some, It’s a Conspiracy
The crypto industry needs banking; it needs it badly and always has. Without a banking partner, crypto companies cannot accept dollar deposits in return for services or in exchange for tokens, nor can they pay their employees or vendors. That means the quest to build a parallel financial system free of intermediaries is dependent, inconveniently, on an accord with those same intermediaries—the banks. Wall Street has often been reluctant to work with crypto companies, so many in the industry came to rely on just two US banks—Silvergate and Signature—which made themselves invaluable to crypto clients by offering real-time payments outside of traditional banking hours. Over the past week, both banks have closed, Silvergate because of overexposure to the ailing crypto sector and Signature due to a liquidity crisis triggered by a sudden flood of withdrawals. That has left many crypto businesses—particularly smaller ones—back where they began: unbanked and with few alternatives at hand. “Overwhelmingly, banking is the challenge for crypto companies,” says William Quigley, cofounder of stablecoin issuer Tether. “A lot of people in crypto are denied access to banking services. It’s a real problem.” When the crypto space began to grow in the early 2010s, mainstream banks were often hesitant to work with a sector they saw as inherently risky. But as the industry began to move closer to the mainstream over the past few years, Wall Street’s level of comfort grew. Big banks such as JPMorgan and BNY Mellon started banking crypto exchanges and letting their clients store and trade coins. Regulators kept an eye on the sector, but besides a few “policy sprints,” they did little. Then in 2022, crypto collapsed in spectacular fashion. In May, the failure of the Terra-Luna stablecoin wiped out an estimated $60 billion, prompting a chain reaction that later took down crypto lender Celsius, hedge fund Three Arrows Capitals, and others. This was followed in November by the implosion of crypto exchange FTX, whose founder has since been charged with 12 criminal offenses, including bank fraud, wire fraud, and money laundering. The fallout from the destruction of major pieces of the crypto ecosystem didn’t really spread into the mainstream financial sector, but regulators felt compelled to make sure it stayed that way. In a joint statement on January 3, the Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), and Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the agencies responsible for the stability of the US banking system, claimed that crypto represents a “significant risk” for banks. “It is important that risks related to the crypto-asset sector that cannot be mitigated or controlled do not migrate to the banking system,” the agencies wrote, although they also made it clear that US banks are “neither prohibited nor discouraged” from servicing crypto businesses. Get WIRED + a tote SUBSCRIBE NOW MOST POPULAR GEAR Should You Wait for Wi-Fi 7 Before Upgrading Your Router? SIMON HILL GEAR The Best Wired Headphones for Serious Listening SIMON LUCAS SCIENCE Insect Farming Is Booming. But Is It Cruel? MATT REYNOLDS GEAR Give Your Back a Break With Our Favorite Office Chairs JULIAN CHOKKATTU Since the start of the year, statements by the regulators and White House have further warned banks to limit their exposure to crypto. In late January, the Fed also announced that it had denied Custodia, a state-chartered bank that offers cryptocurrency custody services, applications to join the Federal Reserve System and open a master account, which would have made it possible for the firm to compete on a level footing with large national banks. Almost all of the household names in crypto—and many smaller ones—gravitated to the two institutions that remained friendly to crypto: Silvergate and Signature. Silvergate fell first. The bank had been struggling since the collapse of FTX and its sister company Alameda Research—both of which were also clients—which led customers to withdraw billions of dollars. On March 8, the bank announced it was being wound down. The US Department of Justice is reportedly conducting an investigation into Silvergate over services provided to FTX and Alameda. The situation at Signature was different. The bank had been attempting since December to diversify its customer base to avoid the same concentration risk that afflicted Silvergate. But it appears that its reputation as a crypto bank, combined with panic in the wake of the failure of Silicon Valley Bank (SVB), was enough to drive another fatal run on deposits, leading the FDIC to take possession of the bank on March 12. In an interview with Bloomberg on Sunday, Signature board member Barney Frank, the former congressman responsible for US banking reforms in the wake of the 2008 financial crisis, said that the bank could have survived, but that regulators “wanted to send a message to get people away from crypto.” The US Treasury did not respond to a request for comment. The Federal Reserve and FDIC declined to comment on the record. Stephanie Collins, media relations manager at the OCC, noted that the agency does not have oversight over Silvergate or Signature but did not address questions around coordination between US banking regulators. But in a statement provided to Reuters, the New York State Department of Financial Services, which handed Signature over to the FDIC, said “the decisions made over the weekend had nothing to do with crypto.” However, the idea that regulators have it in for crypto carries weight in some parts of the industry. Even before Silvergate and Signature were shut down, members of the crypto community—including the CEO of US crypto exchange Kraken—were crying conspiracy and calling it “Operation Choke Point 2.0,” or a coordinated attempt to cut crypto off from the banking system. The term, coined by Nic Carter, general partner at VC firm Castle Island Ventures, refers to a program launched by the Obama administration, under which US officials were said to have pressured banks into severing ties with disfavored industries like pornography and payday lending. Proponents of the Choke Point 2.0 theory say these moves are a renewed attempt to regulate by stealth—to use influence over the banking sector to create de facto policy without requiring the approval of Congress. “For now, most banks are petrified of serving crypto, so the policy has been a success without requiring a ban,” Carter says. “The objective is to do as much as possible without requiring new laws to be passed.” MOST POPULAR GEAR Should You Wait for Wi-Fi 7 Before Upgrading Your Router? SIMON HILL GEAR The Best Wired Headphones for Serious Listening SIMON LUCAS SCIENCE Insect Farming Is Booming. But Is It Cruel? MATT REYNOLDS GEAR Give Your Back a Break With Our Favorite Office Chairs JULIAN CHOKKATTU A group of Republican senators, led by Bill Hagerty of Tennessee, penned a letter to the banking regulators on March 9, supporting this interpretation. The statements issued by regulators have “caused banks to reevaluate their decision to provide banking services to the crypto sector,” the letter claimed. “This coordinated behavior seems disturbingly reminiscent of Operation Choke Point.” “Operation Choke Point 2.0 is very real,” says Caitlin Long, CEO at Custodia, the spurned bank. “Many banks have stepped way back in their crypto activities … and a lot of [crypto] companies ranging from small to very large are looking for bank accounts.” Since January, Custodia has been inundated with enquiries from crypto companies looking for a banking partner, Long says, but without federal supervision it can only offer a limited selection of US dollar services. Custodia is suing the Fed over the denial of its application for membership. Others are less convinced by the Choke Point theory. Economist Frances Copolla, who worked in risk management for HSBC and the Royal Bank of Scotland, says she doesn’t think there has been a “coordinated attack on crypto,” but that the failure of Silvergate and Signature is a reflection of fragilities in their operating models. Caleb Franzen, a corporate banking analyst at research firm Cubic Analytics, says talk of underhanded tactics among regulators is “purely speculation.” But whether by accident or design, crypto is facing a banking crisis in the US.
20 entreprises du tourisme européennes signent un code de conduite sur le partage des données
La question de la souveraineté des données en Europe est un enjeu majeur pour les entreprises y compris dans le secteur du tourisme. Le tourisme représentant 10% du PIB de l’Union européenne aujourd’hui, le développement de l’économie des données dans le secteur est devenu un réel enjeu de compétitivité. C’est pourquoi 20 entreprises du tourisme européennes viennent de rédiger et de signer un code de conduite qui facilite la création d’outils harmonisés et interopérables pour l’échange de données liées au tourisme. En définissant des principes communs (tels que l’interopérabilité, la sécurité, la responsabilité…), des définitions et des lignes directrices pour le partage des données, ce document contribue à créer une architecture européenne pour l’échange de données non personnelles. Il établit des règles du jeu équitables dans lequel le secteur public, le secteur privé et les parties prenantes ont les mêmes chances et opportunités d’utiliser et de partager les données dans le secteur du tourisme. Les 20 signataires du code de conduite : Italian Association for Responsible Tourism (AITR), International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT), European Boating industry (EBI), European Cyclists’ Federation (ECF), European Travel agent’s and Tour Operators Associations (ECTAA), European Historic Thermal Towns Association (EHTTA), European LGBTQ+ Travel Alliance (ELTA), European Travel Commission (ETC), eu travel tech (EU association representing online indirect distributors of travel), Europa Nostra, European Federation of Tourist Guide Associations (FEG), Global Business Travel Association (GBTA), Hotels, Restaurants and Cafés in Europe (HOTREC), The Global Association for the Attraction Industry (IAAPA), International Social Tourism Organisation (ISTO), Mirabilia Network, NECSTouR, New Deal Europe, European Federation of Rural Tourism (RURALTOUR) et Startup Turismo Association. Cette liste n’est pas limitative et toute entreprise européenne active dans le secteur du tourisme peut signer le code de conduite. Cette initiative s’inscrit dans le plan « Transition pathway for tourism » de la Commission européenne élaboré conjointement avec les acteurs de l’écosystème touristique et qui détaille les actions, les objectifs et les conditions clés pour réaliser les transitions verte et numérique et la résilience à long terme du secteur. Ce code de conduite pose les premières pierres de l’espace de données touristiques européen qui est en cours de développement.
Lufthansa inaugure un système automatisé de réacheminement des bagages
Lufthansa vient d'adopter le système WorldTracer Auto Reflight de SITA (au développement duquel la compagnie a participé) avec un double objectif : réduire les coûts liés à ces bagages mal acheminés et à améliorer l'expérience des passagers en automatisant numériquement les opérations de réacheminement des bagages qui se font traditionnellement de façon manuelle. En effet la solution de SITA réachemine les bagages numériquement, sans intervention humaine, informe de manière proactive les passagers à l'arrivée de tout retard concernant leur bagage, tout en recueillant les détails de la livraison et en permettant finalement au passager de contourner le hall des bagages. En outre, la solution propose automatiquement un itinéraire de vol approprié pour les bagages urgents. Elle utilise l'étiquette d'origine pour le réacheminement et informe le système de bagages du nouvel itinéraire. SITA estime que l'automatisation généralisée du réacheminement des bagages pourrait permettre au secteur d'économiser 30 millions de dollars par an.
La faillite de SVB ne va pas aider la French Tech
Sans céder à la panique, les fleurons de French Tech qui ont besoin d’argent frais pour poursuivre leurs activités et assurer leur développement ont du souci à se faire. La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), qui s’était spécialisée dans le financement des start-up et qui était devenue la 16ème banque américaine par la taille des actifs, a provoqué un vent de panique aux Etats-Unis et sur les bourses étrangères. En une semaine, les valorisations de Société Générale et BNP Paribas ont reculé de plus de 12% alors que le Crédit Agricole limitait les dégâts avec un repli de 7%. Ces baisses peuvent paraître étonnantes car la Banque de France a assuré, cette semaine, que « les établissements financiers françaiss ne sont pas exposées » à la chute de SVB. Bruno Lemaire, a, lui aussi, jugé qu’il ne voyait « pas de risque de contagion » et qu’il n’avait, en conséquence, aucune intention de lancer une « alerte spécifique ». Le ministre de l’économie a notamment salué le « ratio de liquidités élevé » et les « secteurs d’activité diversifiés » des banques hexagonales. Il a également ajouté que le système de supervision de notre pays était « solide ». Comment expliquer alors la dégringolade boursière des valeurs financières françaises ? SVB ? La 15ème meilleure banque américaine… Une des réponses qui peut élucider ce phénomène est la surprise totale des analystes qui n’avaient pas vu venir la faillite de SVB. Et pour cause… Le dernier communiqué de presse publié par le groupe californien concernait sa 15ème place au classement des 100 meilleures banques américaines établi par le magazine Forbes. Ironique… Tout a commencé le 8 mars avec l’annonce de la mise en liquidation de Silvergate Bank. Ce modeste établissement régional, qui était très actif dans les cryptomonnaies, a été incapable de résister à l’implosion de la plateforme d’échanges FTX. Quelques heures plus tard, SVB annonçait, à son tour, qu’il devait faire face à une vague de retraits précipités de ses clients. En déclarant, dans un communiqué, lancer une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars et avoir vendu, en urgence, un portefeuille massif de 21 milliards de dollars de titres financiers pour assurer ses réserves en cash, avec une perte de 1,8 milliard de dollars à la clef, les dirigeants de SVB ont provoqué un vent de panique aux Etats-Unis. 42 Mds$ de retraits en 24 heures Durant la seule journée du 9 mars, la banque de la tech a reçu 42 milliards de dollars d’ordres de retrait. A titre de comparaison, le plus gros volume de retraits jamais enregistré chez l’Oncle Sam et qui concernait la Washington Mutual bank avait atteint 16,7 milliards de dollars en… 10 jours. Face à cette saignée, le titre en Bourse de SVB s’est effondré de 60% en une seule séance. Dès le 10 mars, la cotation du titre a été suspendue avant que l’Agence de garantie des dépôts (FIDC) n’annonce qu’elle prenait le contrôle de l’établissement. Les conséquences de cette faillite vont être énormes dans le secteur américain de la tech. La mise en liquidation de SVB va permettre à ses clients de récupérer jusqu’à 250.000 dollars de leurs fonds. De nombreuses sociétés ont placé énormément d’argent dans le groupe mais comme 96% du total des 173 milliards de dollars confiés à SVBn’étaient pas assurés, beaucoup de grands comptes vont perdre gros, très gros dans cette affaire. Circle avait notamment déposé 3,3 milliards de dollars dans les coffres de la banque de la Silicon Valley. Roku (487 millions), BlockFi (227 millions), Roblox (150millions) ou Ginkgo Bio (74 millions) ont également du souci à se faire. Mais ce sont surtout les centaines de start-ups de 10 à 100 employés, clientes de la banque, qui vont être les plus touchées. Beaucoup avaient en effet placé tous leurs avoirs dans cet établissement et leur disparition va les empêcher de verser les salaires de leurs collaborateurs. Des hedges funds, ces fonds vautours qui n’ont jamais aussi bien mérité leur nom, leurs proposeraient déjà de les racheter pour 60% de leurs valeurs en échange de liquidités immédiates. Londres se fait du souci Cette faillite devrait avoir aussi d’importantes conséquences au… Royaume-Uni. Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a avoué que la disparition de la banque californienne posait un « risque sérieux » pour le secteur de la tech britannique. En France, la situation est bien différente comme nous l’avons déjà vu mais il ne fait aucun doute que la faillite de SVB risque encore de ralentir les flux d’investissement dans la tech. Depuis plusieurs mois, la source d’argent frais qui coulait auprès des start-ups commençait déjà à se tarir. L’an dernier, dix jeunes pousses françaises étaient devenues des licornes suite à des levées de fonds records mais cette embellie n’a pas duré. L’heure est aujourd’hui aux économies. Les licornes au régime sec En décembre, Meero a lancé un plan de sauvegarde (PSE) en vue de supprimer 72 postes en France. Le mois suivant, le spécialiste du matériel digital reconditionné, Back Market a officialisé la suppression de 93 emplois, soit 13% de ses effectifs. Quelques semaines plus tard, PayFit, l’éditeur d’un logiciel de paie et de gestion RH, a licencié 200 personnes, soit environ 20% de ses salariés. La faillite de SVB ne devrait pas inverser cette triste tendance.
Neuromarketing and the Battle for Your Brain
We are constantly bending and being bent to the will of others—and neurotechnology may be enabling new methods for those seeking to bend others to their will. In 2021, Ahmed Shaheed, during his mandate as the UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, presented the first-ever report on freedom of thought, which argued that “freedom of thought” should be interpreted to include the right not to reveal one’s thoughts nor to be penalized for them. He also recommended that freedom of thought include the right not to have our thoughts manipulated. But manipulation is a slippery concept. If ill-defined, an absolute prohibition on it could do more harm to human interactions than good. About a decade ago, I went down a rabbit hole trying to untangle claims about philosophical and legal free will. The written debate goes back at least two thousand years, but neuroscientists have recently joined the fray by arguing that decisionmaking is hardwired in our brains. Punishment, they argue, cannot be justified by retributivism—an eye for an eye—because people are not morally culpable for their actions. I disagree and have sought in my own scholarship to explain why freedom of action is a freedom worth defending. In a well-known 1971 essay titled “Freedom of Will and the Concept of a Person,” the American philosopher Harry Frankfurt describes what he calls a peculiar characteristic of humans—that we can form “second-order desires.” Besides our subconscious preferences, biases, and desires, we can also “want to have (or not to have) certain desires and motives.” Frankfurt calls this capacity for reflective self-evaluation of those biases and desires “higher-order volition.” We don’t have to be fully aware of our unconscious desires to engage in reflective self-evaluation. We might be completely unaware of some desires, while being mistaken about others. Free will, he argues, is our capacity to form higher-order volitions, by recognizing certain desires as our own. Frankfurt uses an example of two animals addicted to drugs. One is conflicted about his addiction—he craves the drug but also wants to be free from it. He wants his desire to be free from his addiction to become the one that drives his behavior. The other animal also has conflicting desires but lacks the capacity for self-reflection, and so doesn’t form a preference between them. The first animal is human while the latter is not, because only the first makes one of his desires “more truly his own, and in so doing, he withdraws himself from the other.” Frankfurt implicitly connects this to manipulation, by explaining that when the human addict is unable to break his addiction, he feels like the force “moving him to take the drug is a force other than his own.” When we believe that something other than our free will is driving us to act contrary to a desire we identify with, we feel that we are being manipulated. Frankfurt’s example helps us distinguish between freedom of will and freedom of action. Freedom of will is our capacity to identify with our desires. Freedom of action enables us to make our will our own through our actions. Our freedom of will may be illusory—we commit to desires, biases, or preferences believing we have done so freely, but we may have chosen that preference because it was unconsciously primed by our environment. Our freedom may also be interfered with, making it harder to make our volition effective, if we are manipulated into acting compulsively with a “force other than [our] own.” We may want to stop checking Instagram every five minutes, but cleverly timed notifications compulsively draw us back in. In Autonomy and Behavior Control, Gerald Dworkin wrote that a person’s motivation can belong to them without it truly being “their” motivation. This happens if that motivation is created using deception, or by short-circuiting someone’s desires and beliefs, and thus interferes with a person’s ability to reflect rationally on their interests, making them a passive recipient of the change. Philosophers Daniel Susser, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum in a recent article extended manipulation by deception to the digital age, by arguing that acceptable influence appeals to our “capacity for conscious deliberation and choice,” while manipulation takes “hold of the controls,” depriving us of “authorship over [our] actions” and driving us “toward the manipulator’s ends.” Get WIRED + a tote SUBSCRIBE NOW MOST POPULAR CULTURE After The Last of Us, Everything Will Be Transmedia WILL BEDINGFIELD SCIENCE Solar Panels Floating in Reservoirs? We’ll Drink to That MATT SIMON BUSINESS The Silicon Valley Bank Contagion Is Just Beginning CHRIS STOKEL-WALKER SCIENCE The Electron Is Having a (Magnetic) Moment. It’s a Big Deal KATRINA MILLER Other scholars define manipulation as interfering with our “mental integrity,” which Andrea Lavazza describes as “the individual’s mastery of his mental states and his brain data.” He argues that we should draw a bright line that prohibits unconsented-to interferences that “can read, spread, or alter such states and data in order to condition the individual in any way.” Marcello Ienca and Roberto Adorno take a more tempered view to non-consensual interference with the brain, focusing on those that technologies have the potential to cause the individual harm. These accounts all coalesce around a definition of manipulation as hidden attempts to use our cognitive biases, emotions, or subconscious “as vulnerabilities to exploit” by bypassing our capacity for conscious thought. What they get wrong is that they build on an outdated Freudian view that our psyche has “two minds”—a conscious and an unconscious one. We have since learned that unconscious processes use the same brain regions in the same ways as conscious processes. Our unconscious mind is primed all the time through regular stimuli (rather than hidden and subliminal ones). Think of the popcorn and soda advertisements before a movie begins. They are hardly hidden, but they play to our baked-in desires. Advertisers and tech giants have just gotten much better at identifying and targeting them. Indeed, social psychologists have argued for decades that people are unaware of the powerful influences that are brought to bear on their choices and behavior. Which is why it’s critical that we understand what others can and can’t do to change our minds as neurotechnology enables newfound ways to track and hack the human brain. The starkest examples of manipulation include assaulting our brains with intentional (and nonconsensual) administration of “mind control” drugs, or using weapons to rob us of even having the capacity to choose. These clearly violate our right to self-determination and freedom of thought. The more difficult cases to resolve, however, are the subtler influences that shape our everyday decision-making and that are quickly becoming normalized. It’s much easier to prime us to act in ways that are consistent with our existing goals than to use these weapons. Priming us with cues that are related to our goals will focus our “selective attention” on “goal-relevant features of the environment,” which can shape our choices that follow. Professors of marketing and psychology Gráinne Fitzsimons, Tanya Chartrand, and Gavan Fitzsimons found compelling evidence of this effect when they subliminally primed study participants with Apple and IBM brand logos. The Apple logo prime led people to act more creatively on subsequent study tasks compared to subliminal IBM logo priming—but only when creativity was a part of the participants’ self-descriptions. Apple evoked in these participants an association of creativity, leading those with a prior stated goal of being creative to act more creatively on subsequent tasks. Because IBM didn’t evoke the same association, even those with creativity as a stated goal didn’t act more creatively when primed with IBM instead. Even asking us questions about our hidden vices can change our subsequent behavior. We often have conflicting attitudes about behaviors like smoking, drinking, and using drugs. We get a short-term reward (like a dopamine hit in our brain) when we indulge, but we also understand the negative long-term consequences that go with them. When we hold conflicting explicit negative and implicit positive attitudes about a behavior, priming may give us “license to sin.” Frankfurt’s human addict wants to break his addiction but asking him how often he plans to take the drug in the next week can nudge him toward doing so more often, despite his explicit preference otherwise. When researchers asked students about their attitudes toward skipping class, they reported strongly negative attitudes toward doing so, but then skipped class more frequently in the weeks following. When study participants were asked how often they would go out drinking or watch television instead of studying, they also did so more frequently in the week following. But when framed negatively—telling participants that drinking and wasting time watching television are vices to be avoided—the vice behavior remained the same. How an influencer frames a question can liberate us to sin or increase our ability to avoid doing so. MOST POPULAR CULTURE After The Last of Us, Everything Will Be Transmedia WILL BEDINGFIELD SCIENCE Solar Panels Floating in Reservoirs? We’ll Drink to That MATT SIMON BUSINESS The Silicon Valley Bank Contagion Is Just Beginning CHRIS STOKEL-WALKER SCIENCE The Electron Is Having a (Magnetic) Moment. It’s a Big Deal KATRINA MILLER All of this makes it exceptionally unrealistic at best, or outdated at worst, to define unlawful manipulation as intentionally using hidden influences to affect our decision-making. Most practices are not hidden at all, we just don’t realize how they influence our behavior. When neuromarketers use advances in neurotechnology to discover what makes us tick, and then use that information to make their products more enticing, they don’t render us unable to act consistently with our goals any more than putting tempting candy or gossip magazines near the check-out counter at a store does. As of yet, no one has discovered the so-called buy button in our brains. When the Disinformation Dozen, the twelve people to whom most of the misleading information about vaccines have been attributed, intentionally exploit evolutionary shortcuts in our brains such as clickbait and alarming headlines or claims couched in pseudoscience to make us more susceptible to fake news content, they don’t prevent us from getting vaccinated, even if their bad arguments do appeal to our heuristics. But if a product is designed to be addictive and becomes actually or nearly impossible to resist, our freedom of action will be hindered and our self-determination and freedom of thought will be put at risk. Two of the three rights that comprise our right cognitive liberty. Shaheed concedes that freedom of thought cannot and should not be used to prevent “ordinary social influences, such as persuasion.” We may encourage others, advise them, even cajole them, he argues. But at some point, an influence crosses the line from permissible persuasion to impermissible manipulation. He offers a nonexclusive set of factors to consider, including (1) whether the person has consented to the practice with fully and freely informed consent; (2) whether a reasonable person would be aware of the intended influence; (3) whether there is a power imbalance between the influencer and target; and (4) whether there has been actual harm to the person subject to manipulation. These are helpful but still don’t make clear the nature of the influence we are defending ourselves against. We can’t and shouldn’t attempt to regulate every marketer, politician, artist, or entity who tries to appeal to our unconscious biases, desires, and neural shortcuts, lest we interfere with everyday interactions that are part of what it means to be human, whether those attempts are hidden or visible, or targeted at our unconscious or conscious neural processes. But when a person or entity tries to override our will by making it exceedingly difficult to act consistently with our desires, and they act with the intention to cause actual harm, they violate our freedom of action, and our right to cognitive liberty should be invoked as a reason to regulate their conduct. However begrudgingly, we must admit that neuromarketing per se does not inherently violate cognitive liberty, so long as the research is conducted ethically and the findings are not used to intentionally cause us harm. Neuromarketing may help marketers better understand our higher-order goals and preferences we have committed ourselves to, and serve us up more of what we want. We can’t confidently say the same about intentional efforts to exploit our brains by bypassing our goals and preferences to addict us to technology, social media platforms, or other products all of which are designed to overcome our freedom of action, and have harmful consequences for individuals. MOST POPULAR CULTURE After The Last of Us, Everything Will Be Transmedia WILL BEDINGFIELD SCIENCE Solar Panels Floating in Reservoirs? We’ll Drink to That MATT SIMON BUSINESS The Silicon Valley Bank Contagion Is Just Beginning CHRIS STOKEL-WALKER SCIENCE The Electron Is Having a (Magnetic) Moment. It’s a Big Deal KATRINA MILLER While our brains may fall for bad arguments when cleverly framed, we can and should encourage societal interventions that nudge us to slow down and think critically, or to combat intentional efforts to exploit our brains. When Twitter asks “Would you like to read the article first?” before retweeting it, it’s asking us to slow down and think critically before we act. More companies ought to implement mechanisms that encourage users to do the same. And we should aspire to do so ourselves even when we aren’t nudged by others. We can and should become more aware of how others are using clickbait headlines or emotional appeals to tap into shortcuts in how we process information, and use our knowledge of those practices to secure ourselves against them. We should avidly check the accuracy and credibility of information before accepting it as true, and seek out a diversity of sources and perspectives to combat intentional efforts to limit our thinking. Even taking breaks from technology, news, and other sources of information can give our brain time to recharge and process information. The right to cognitive liberty protects our right to self determination over our brains and mental processes. It includes the right to be free from manipulation by others, but also the right to resist manipulation and reclaim our brains. Building resilience to tactics that shortcut our thinking will help us exercise this right. But freedom of thought should not be used as an excuse for filtering that information for us. As for Shaheed’s recommendation that we consider whether a person has freely and voluntarily consented to an intervention? While consent will rarely be enough to shield us from the coming encroachments to cognitive liberty, with at least the newest technique we turn to next, it should be a critical factor in considering the legitimacy of the technique. From The Battle for Your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology by Nita A. Farahany. Copyright © 2023 by the author and reprinted by permission of St. Martin’s Publishing Group.
SXSW : le fondateur de ChatGPT reconnaît qu’il n’a pas toutes les réponses aux questions posées par l’IA…
Avec plus de 100 millions d’utilisateurs en deux mois, ChatGPT est l’application qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire. En comparaison, pour atteindre ce cap, il avait fallu 9 mois à TikTok et 4 ans et demi à Facebook… Pour OpenAI, créée en 2015, il s’agissait de la première application grand public : jusqu’alors, l’entreprise se consacrait à la R&D et à la conception d’algorithmes et d’outils pour les développeurs. Greg Brockman justifie ce pivot par une volonté d’éduquer le grand public à l’IA et “d’informer les gens pour qu’ils sachent ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, ce à quoi le futur va ressembler”. Démultiplier l’intelligence (humaine) Le patron d’OpenAI considère en effet que l’intelligence artificielle va bousculer tous les secteurs et qu’il faut s’y préparer collectivement, au plus vite, “afin d’en tirer tous les avantages et trouver comment en atténuer les inconvénients.” Car si l’IA n’est pas un concept nouveau – les premières recherches sur le sujet remontent aux années 40 – tout s’accélère actuellement, et de façon exponentielle. “C’est un peu comme si vous engagiez six assistants. Ils ne sont pas parfaits, ils ont besoin d’être formés un peu. Ils ne savent pas toujours exactement ce que vous voulez, mais ils sont très enthousiastes. Ils ne dorment jamais. Ils sont là pour vous aider,” décrit-il, en mettant en avant le potentiel de ChatGPT pour “augmenter” l’humain au quotidien. Avec un défi : “en faire un démultiplicateur d’intelligence” et non un outil qui limite nos capacités de réflexion, une préoccupation “qui [l’]empêche de dormir la nuit”. “C’est important d’en parler” Quid des droits d’auteur et du respect des artistes dont les œuvres ont été utilisées pour entraîner les algorithmes ? Interrogé plusieurs fois sur le sujet, Greg Brockman botte toujours en touche : “nous travaillons en étroite collaboration avec les décideurs politiques, et je pense qu’il s’agit d’un sujet très important. Je ne pense pas que nous ayons toutes les réponses, mais c’est vraiment important d’en parler.” À plusieurs reprises, le président d’OpenAI se dit ainsi conscient des problèmes posés par l’IA, que ce soit en termes de biais, de menace pour les emplois ou de propriété intellectuelle. Mais il propose finalement assez peu de solutions, se bornant à rappeler que la “mission [d’OpenAI] est de construire une intelligence artificielle qui profite à l’ensemble de l’humanité”, tout en invitant les pouvoirs publics à mettre en place une régulation adaptée. “Nous ne pouvons pas être les seuls à prendre ces décisions. Il faut que ce soit collectif” estime-t-il, en précisant qu’un travail sur la mise en place d’une “gouvernance mondiale” est en cours. Dans une autre conférence à SXSW, la futurologue Amy Webb rappelait qu’en 2019, lors du lancement de GPT-2 (le prédécesseur de GPT-3, sur lequel est construit ChatGPT), OpenAI avait fait le choix de ne pas ouvrir son modèle, en raison des dangers qu’il pouvait représenter… Une préoccupation qui a manifestement fait long feu.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.