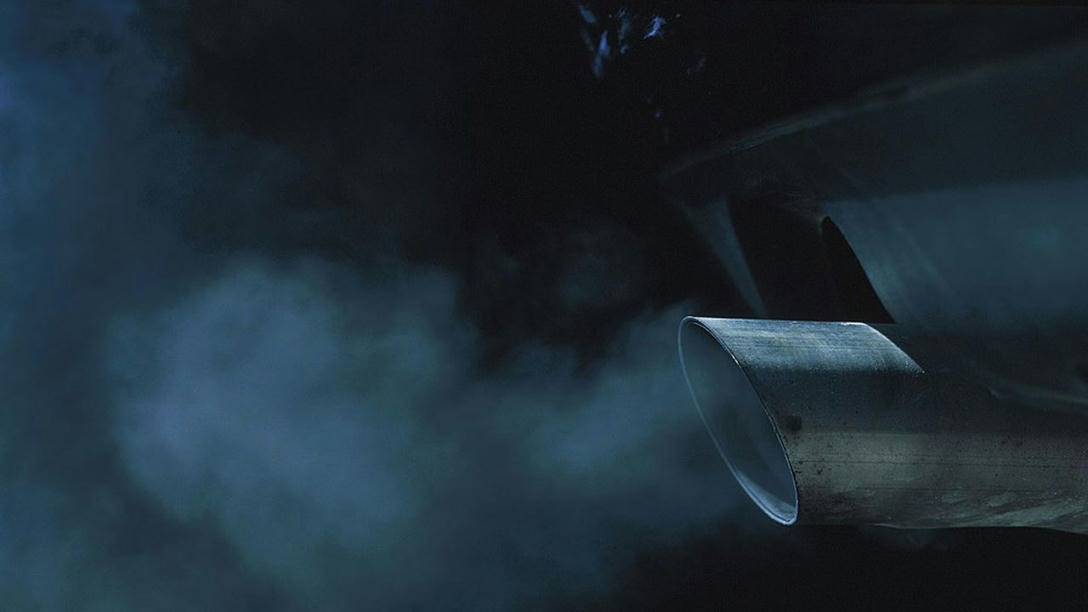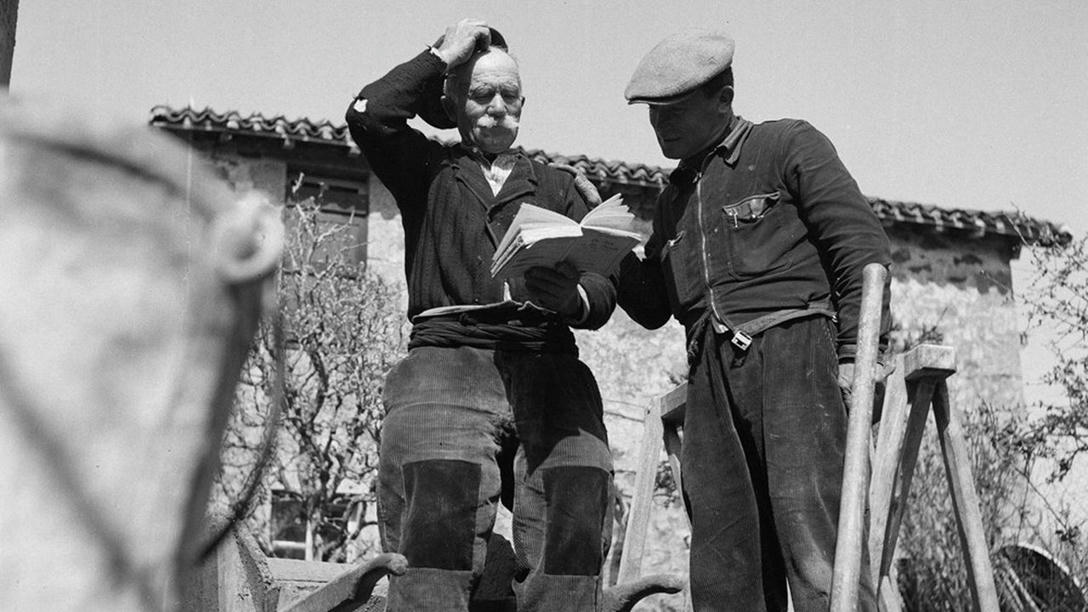Automobile : débat explosif sur la fin des moteurs thermiques en 2035
Pour révolutionner l'industrie automobile, la date était tout indiquée. C'est finalement le 14 juillet que la Commission européenne fera savoir à quelle échéance elle souhaite bannir les moteurs 100 % essence ou diesel dans les voitures neuves. Cette décision fera partie des 13 directives que Bruxelles proposera ce jour-là pour décliner son ambition, baptisée « Green Deal », de réduire de 55 % les émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990. « Ces propositions devaient être présentées le 30 juin. La date a été décalée et ne changera plus maintenant », assure Pascal Canfin. Et selon le président de la commission chargée de l'Environnement au Parlement européen, la messe est dite. « La Commission européenne va très probablement proposer de fixer ce nouveau standard conduisant à la fin du véhicule thermique en 2035 », assure-t-il. Problème : cette perspective, selon nos informations, ne fait pas absolument pas l'unanimité au sein du gouvernement français. Casse sociale D'après Pascal Canfin, qui prépare le terrain avec ardeur depuis plusieurs mois, « tous les signaux en provenance de la Commission indiquent que ce sera une bonne date d'atterrissage. 2030, c'est trop tôt pour les industriels et pour les pays qui disposent d'une industrie automobile. Et 2040, ce sera trop tard pour le climat ». Si l'Allemagne, poussée par le groupe Volkswagen qui a amorcé un virage à 30 milliards d'euros dans l'électrique, est désormais favorable à des objectifs plus ambitieux, dans l'Hexagone, le débat fait encore rage. « Le gouvernement a eu l'occasion de rappeler, notamment lors des débats sur le projet de loi climat et résilience, qu'il n'entendait pas décider unilatéralement de modification de l'objectif de fin de vente des véhicules thermiques, fixé par la LOM en 2040 », fait-on valoir au cabinet du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Bercy invoque les emplois en jeu, et le risque de casse sociale. Matignon serait sur la même ligne. La crise des « gilets jaunes » est encore dans les esprits. Voiture électrique : l'industrie automobile française longue à la détente Du côté des ministères de la Transition écologique et des Transports, en revanche, la cause semble acquise. Parmi leurs arguments : en accompagnant une décision qui semble inéluctable, la France sera en meilleure position pour négocier un soutien financier à cette transition. La décision reviendra à Emmanuel Macron, qui devrait se prononcer sur la position française avant le 14 juillet, selon une source. Une réunion avec le Président de la République était programmée le 9 juin, mais elle a été reportée. Elle pourrait se tenir la semaine prochaine. « La raison politique pencherait pour passer à 2035, mais tout reste possible », souffle un proche du dossier.
Non, ce n’était pas mieux avant !
Pour s'en convaincre, il suffit de lire le récit tout juste paru de Pierrick Bourgault, « Nos racines paysannes » (Editions Ouest-France), fruit d'entretiens avec Lucienne et Louis, respectivement âgés de 93 et 97 ans, bon pied, bon oeil dans leur « résidence autonomie ». Ce couple de paysans a vécu toutes les transformations du monde agricole. A l'époque de leur jeunesse sarthoise, on attelait les chevaux pour le labour, on allait chercher l'eau au puits, on rentrait les moissons dans les greniers, on parlait le patois du Maine, on se contentait d'un régime monotone à base de patates et de haricots, on s'habillait en chemise à manches longues et on rencontrait son âme soeur aux kermesses. La vie se passait au village, où l'on comptait pour 400 habitants une épicerie, deux cafés, un menuisier, un boulanger, un charron, un maçon, un maréchal-ferrant… Lucienne et Louis nous racontent une existence à peu près inchangée sur quinze mille ans de sédentarisation. Nos « racines paysannes » sont nos racines humaines. Puis vinrent les tracteurs du plan Marshall, l'eau courante, le remembrement rural, la migration vers l'Indre-et-Loire à la recherche de terres plus vastes, les engrais et les insecticides. Lucienne et Louis durent s'atteler à construire une ferme moderne. Une fois à la retraite, ils ont vu arriver les néoruraux fascinés par la permaculture. Ils sont ainsi passés par le cycle complet de l'évolution agricole, du traditionnel au bio en passant par le conventionnel. Ils ont connu les haies que l'on taille au hachot, puis que l'on abat au bulldozer, et enfin que l'on replante ; les mares dont on se méfie, puis que l'on assèche avant de les ressusciter en « zones humides ». Que nous apprend cette dialectique ? Le progrès infini Première leçon : ce n'était pas mieux avant. « Les gens qui disent 'c'était le bon temps' ne savent pas de quoi ils parlent », explique Lucienne, sans préciser si elle vise Eric Zemmour ou Alain Finkielkraut. « On passait la journée tête baissée pour arracher des navets. Ensuite, il fallait les laver à la mare dans un baquet, avec un vieux balai, dans le froid. » L'arrivée de la trayeuse fut une bénédiction, l'ensachage automatique un miracle. L'électricité, le téléphone et le chauffage central, qui semblent un acquis trivial à notre génération gâtée, continuent à émerveiller le couple. Conclusion de Louis, à méditer par nos hordes de réactionnaires urbains et connectés : « La nostalgie est un mensonge qui empêche de s'adapter au présent. » Deuxième leçon : l'écologie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux écolos. Lucienne et Louis regrettent d'avoir écouté sans broncher les ingénieurs agronomes des années 1960 qui leur promettaient le progrès infini. Ce n'est pas pour se jeter aujourd'hui dans les bras des gourous du retour à la terre. Louis reste sceptique sur la viabilité économique de la permaculture . « A la télé, dit-il, on voit un gars qui cherche sous les feuilles et déterre une grosse carotte, comme ça, par hasard… Moi qui connais la concurrence entre les plantes, je me dis : c'est pas possible, il l'a enterrée avant ! » Respecter les écosystèmes n'implique pas de renoncer à la technologie. A l'heure où la réforme de la PAC est âprement discutée , l'histoire de Lucienne et Louis plaiderait pour un redéploiement massif des subventions vers l'agriculture raisonnée. Dernière leçon, universelle : donnons la parole aux anciens !
Les éoliennes envahissent la campagne des régionales et des départementales
Bis repetita. Après la campagne des municipales de 2020, où elles ont secoué les débats dans les communes rurales et périurbaines, jusqu'à faire chavirer des équipes sortantes, les éoliennes ont débarqué en force dans celle des régionales et des départementales . Mais cette fois, l'opposition aux projets de développement de cette énergie verte n'est plus seulement, et de loin, l'affaire d'associations locales. Les partis politiques ont pris le relais. Dans l'éventail des prises de position, les plus tranchées reviennent au Rassemblement national (RN) et aux Républicains (LR), dont les ténors s'affichent sans ambiguïté dans le camp des opposants, aux antipodes d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) dont les candidats plaident sans relâche en faveur de la transition énergétique. La croisade de Marine Le Pen Cette hostilité, chez les premiers, prend des allures de croisade face à la perspective de voir s'ajouter près de 7.000 éoliennes d'ici à 2028 aux 8.000 mâts comptabilisés en 2019. Particulièrement au RN, prompt à surenchérir pour en occuper la tête. Samedi dernier, Marine Le Pen l'a exprimé sans fard dans une tribune au « Figaro » en appelant à « dépasser les clivages partisans », comme elle l'avait fait en 2017. La candidate à la présidentielle ne cesse de s'en prendre au développement de l'éolien en France et de promettre, depuis mars, un référendum avec une question sur ce sujet. Sa rhétorique, plus ou moins vérifiable, a évolué et se veut proche de celles des associations d'opposants dont elle n'oublie jamais de saluer le travail, au risque de susciter une certaine gêne dans leurs rangs . L'électricité éolienne coûterait bien trop cher à l'Etat qui la subventionne - « à des prix 2 fois supérieurs au prix normal sur terre et jusqu'à 6 fois pour les six premières centrales éoliennes en mer », selon elle - au regard des capacités réelles de cette énergie intermittente. Elle profite bien moins à l'économie de la France, qui n'a pas su se doter d'une véritable filière industrielle, qu'à ses voisins, notamment l'Allemagne. S'y ajoutent les considérations relatives aux impacts visuels sur le patrimoine historique et architectural, jugés préjudiciables à l'économie touristique par les opposants. Des bâtons dans les pales A droite, Julien Auber, député LR du Vaucluse, est sur la même ligne s'agissant de la critique économique portée aux éoliennes. « Cela coûte cher. Ca a été prélevé par des taxes, ça a une tendance antisociale », considère le parlementaire. En Nouvelle-Aquitaine , le chef de file de la droite aux régionales, Nicolas Florian, demande un moratoire sur tout nouveau projet éolien terrestre, comme Nicolas Forissier dans le Centre-Val de Loire et Gilles Platret en Bourgogne-Franche-Comté .
SOS Corail en danger
Il tapisse de ses couleurs le fond des mers et des océans pour le plus grand bonheur des plongeurs. Mais le corail est un animal en danger au niveau planétaire. Victimes du réchauffement climatique les récifs coralliens, écosystèmes millénaires exceptionnels, meurent. Et leur diminution accélérée a des conséquences. Avec les mangroves et les herbiers, également menacés, les récifs coralliens abritent un quart de la biodiversité marine. « Il faut imaginer qu'un km² de récif contient autant d'espèces que l'ensemble du littoral métropolitain français » pointe sur son site SOS Corail. Un programme que la Fondation de la mer vient de lancer pour la protection de ces écosystèmes. Quatorze projets de sauvegarde ont ainsi été sélectionnés et validés scientifiquement à travers le territoire français. Dont un programme de rénovation des mangroves Tsara tanana à Mayotte, un autre pour les supercoraux Criobe en Polynésie ou encore un projet d'éco ancrage à Baie Mahault en Guadeloupe. Ailleurs dans le monde, face à l'urgence des recherches ambitieuses sont lancées pour sauver le corail. En Floride, la biologiste Keri O'Neil est parvenue à faire pondre des coraux d'Atlantique en aquarium. Une prouesse et un espoir pour une possible reconstruction.
What’s New in Apple’s iOS 15: Top Features Coming to Your iPhone | WIRED
Apple's video-calling app is receiving some of the largest upgrades this year that turn it more into videoconferencing services like Zoom and Google Meet. For starters, there's a grid view for multi-person chats that works like Zoom's conference calls. There's a Portrait mode—like the similar feature in the Camera app, it keeps your face in focus but blurs out your messy room in the background. You can also create FaceTime links to share and invite others to a video chat, and these can be added to your calendar. Those with the link can join these calls through Google Chrome or Microsoft's Edge browser even if they're using an Android phone or a Windows laptop, and the calls are still end-to-end encrypted. Video calls sound more natural, with FaceTime using spatial audio to space out sounds based on where your friends are on the grid view of a group call, making it feel more like you're all in a room. And there are two new options for the microphone: Voice Isolation and Wide Spectrum. The former will cut out all ambient noise so whoever's on the other end just hears your voice. The latter will try and pick up all sounds in your surroundings. Then there's SharePlay, and as you might've guessed, it allows you to share movies, music, and your screen with anyone you're FaceTiming with. Want to listen to a new album with your friend in sync at the same time? You can bring in tunes from Apple Music. Maybe you want to watch a movie with your long-distance partner while video chatting? Easy. You can AirPlay the movie to your TV at the same time to watch it on the big screen. Apple says any other developer with a content streaming app will be able to add support for the SharePlay feature, though services like Disney+, HBOMax, ESPN+, and TikTok will already be on board when iOS 15 arrives this fall. The implementation gives a lot of control to the developer. It's unclear just yet, for example, if both video call users will need Disney+ accounts—Disney could allow the other user to sign up for a free trial, allow one free movie to stream via SharePlay a month to anyone, or block access completely if neither party has an account. New Ways to Focus Set up a profile for each part of your day: Work, lunchtime, sleepy time. PHOTOGRAPH: APPLE If you've ever felt overwhelmed by the endless list of notifications on your iPhone, well, worry no longer. In iOS 15, notifications have a new look and some new ways to manage them. There are contact photos for your messages, larger icons for notifications that come from apps, and a new Do Not Disturb mode to silence all notifications. A new Notification Summary function lets you check unimportant alerts at specific times of day, like in the morning or evening. The latter function is powered by on-device machine learning that identifies your phone usage patterns and parses what notifications should fall under the summary and when it should deliver them to you. Don't fret—your Messages and missed phone calls won't fall into Summary. That said, if you don't want to be disturbed, your friends and family will see when you have Do Not Disturb turned on in Messages, exactly like a status update. If they really need to reach you, they can send a message through, similar to Do Not Disturb in Slack. Perhaps the best new feature is a way to organize your entire iPhone's home screen to match your mood. You can choose between profiles like Work, Personal, and Sleep, (or create up to 10 Focuses) and your home screen will show apps and widgets related to the respective mode. So if it's 9 am and you switch to work, you can customize your home screen to show work apps, widgets, and messages from coworkers only. These modes can be turned on for an hour, start when you leave or enter a location, or can be timed to your calendar events. You'll still be able to access all your apps via the App Library, or you can switch to another profile quickly at any moment. Uniquely, your friends and family can see if you're in a Focus if you don't want to be disturbed via the Messages app, but a Status API will allow any messaging app to implement this functionality. Live Text, Photo Memories, and Better Safari Live text recognizes written words in photos, making them selectable and searchable. PHOTOGRAPH: APPLE One of the coolest features in iOS 15 is Live Text, and it's tied to upgrades in Apple's computer vision technology. Point your camera app at anything with text, and it will highlight the text, making it ready for you to easily copy it and paste it to another app. This works for images with text in your Photos library too—just swipe your finger across any line of text to copy it. And if there's a phone number in the photo or an address, Live Text will turn it into a link so you can tap it. Phone numbers seamlessly launch in the phone dialer and addresses launch in Maps. Perhaps a little stranger is the integration between Apple Music and the Photos app. When you open the Photos app, you'll be greeted to a new version of Memories—this feature automatically generates a mini-movie of specific trips or events and automatically chooses a relevant song from Apple Music. You can customize the movie as you view it by changing up the pace, switching songs, changing filters, or swapping images. It's not far off from a Google Photos feature introduced in 2018, but Apple gives you far greater control with music integration here. Safari is now easier to use with one hand. The URL bar is now situated on the bottom, and it hides away when you scroll to maximize your screen's real estate. You'll notice Safari looks a lot more similar to the interface on macOS or your iPad on the new tab page—there's your favorite websites, reading list, and content shared with you. You can swipe through tabs easily and group them together. And finally, for the first time, Safari extensions are coming to iOS. These will be available through the App Store. Digital Wallet and Improved Maps License and registration, please. PHOTOGRAPH: APPLE Apple is continuing its quest to take over your physical wallet. Last year it let you add car keys, but in iOS 15, you can add additional keys. Add a home key if you use a smart lock, an access card you may use to enter your office, or a hotel room key—Apple says Hyatt will roll this functionality out to 1,000 properties worldwide, and yes, you will be able to tap your Apple Watch to enter your room. Even better, you can scan your driver's license with the iPhone's camera and add it to the Wallet app, though this only is available in participating states. One of the first places you'll be able to make use of your digital ID is the airport; Apple says the Transportation Security Administration is enabling checkpoints that support the feature. Speaking of travel, the improved version of Apple Maps the company introduced last year is now rolling out to four new countries: Spain, Portugal, Italy, and Australia. Apple's map data is getting even more detailed again in iOS 15. You'll find more street-level details in commercial districts, elevation information in cities, as well as custom designs for landmarks like the Golden Gate Bridge. When driving, Maps will now show highway interchanges in 3D so you have a better idea of exactly which lane you need to be on. These features will come to CarPlay later this year. If you ride public transit, Maps will tell you when to get off your stop, and if you don't know which way to head once off the bus or outside the subway station, just point your phone at the buildings in front of you to have Apple's augmented reality point the way. It's similar to AR Live View in Google Maps.
Coline Debayle, co-fondatrice de Time for the Planet
Lancé il y a un an, Time for the Planet est un fonds à but non lucratif qui veut créer et financer 100 entreprises «open source» pour lutter contre les gaz à effet de serre. Ce projet fou hybride entre start up studio, fonds d’investissement et mouvement citoyen prévoit d’atteindre le milliard d’euros d’ici cinq à dix ans. Rencontre avec Coline Debayle, co-fondatrice de Time for the Planet, qui veut donner du sens à ses actions entrepreneuriales, sauver le climat et changer le monde avec bienveillance. The Good : Vous êtes co-fondatrice de Time for the Planet avec 5 associés – Mehdi Coly, Nicolas Sabatier, Laurent Morel, Arthur Auboeuf et Denis Galha Garcia. Où en est Time for the Planet après son lancement il y a un an ? Coline Debayle : Après un an d’existence, nous avons fédéré 22 000 associés qui ont signé pour plus de 7 millions d’euros et nous allons lever plus de 10M€ en 2021. Nous avons rassemblé le dernier million en un mois (au lieu de 10 mois) donc nous sentons une formidable accélération et Time For The Planet avance très vite. Nous avons des associés qui sont fiers d’appartenir au mouvement et qui sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. Le mouvement Time for the Planet est pensé comme un objet dont tout le monde peut s’emparer pour le porter encore plus haut. Nous misons vraiment sur l’intelligence collective et sur le fait que ce sont les citoyens qui regagnent du pouvoir sur le dérèglement climatique en passant à l’action. Nous préparons l’international mais cela va prendre du temps. En effet, comme nos frais ne doivent pas dépasser 10% maximum des fonds levés, si nous voulons le faire correctement, notre déploiement international va coûter cher et sera un peu plus long. Il faut savoir que l’essentiel des fonds sert à financer les entreprises. Les fondateurs de Time for The Planet ne se payent pas pour l’instant. Dès que nous aurons atteint les 10M€ de fonds, nous pourrons accepter de demander un salaire qui devra être impérativement validé en assemblée générale (avec un maximum de 4 smic). Nous sommes déjà une entreprise à mission mais aussi à but non lucratif. Dans cette formule originale nous avons réussi à faire en sorte qu’il ne soit pas possible de se verser des dividendes (sauf si on revenait à +0˚C de l’ère pré industrielle ce qui est bien sûr impossible). De plus, personne ne peut revendre ses actions plus chères. Notre gouvernance interdit toute spéculation.
Apple cherche à contrer Zoom et poursuit ses efforts dans la sécurité
La nouveauté la plus notable est une refonte de son outil d'appels audio et vidéo via Internet, FaceTime. Face au succès croissant des outils de visioconférence Zoom ou Microsoft Teams, Apple a d'abord choisi l'ouverture : réservé depuis ses débuts aux possesseurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac, FaceTime sera bientôt accessible sur les smartphones Android de Google ou les PC sous Windows. Comme avec Zoom, il sera possible de planifier un appel, et il suffira d'envoyer un lien à ses correspondants par mail ou SMS pour leur permettre de se connecter via le Web. Travail et loisirs à partager Le nouveau FaceTime sera aussi plus collaboratif : tous les participants pourront partager des documents de travail, mais aussi des films en streaming ou de la musique grâce à une nouvelle fonction, SharePlay. Celle-ci sera intégrée aux logiciels et services d'Apple, mais aussi à ceux de certains concurrents, comme les plateformes de streaming Disney+ et HBO Max, ou le réseau social TikTok. Apple promet aussi une amélioration du son et de l'image des appels « pour les rendre plus naturels que jamais », a indiqué Craig Federighi, senior vice-président chargé du software engineering. Autant d'innovations qui auraient été bienvenues au début de la pandémie, mais qui paraissent un peu à contretemps à l'heure où de nombreux pays lèvent les contraintes sanitaires … Covid : Apple demande à ses salariés de revenir trois jours par semaine au bureau Deux mois après une mise à jour d'iOS obligeant les éditeurs d'applications à demander le consentement des utilisateurs avant de les pister, Apple a également choisi d'aller un cran plus loin dans la protection des données personnelles. La prochaine version, qui sera disponible à l'automne pour le grand public, proposera un nouveau rapport de confidentialité qui fournira plus de détails sur la façon dont les applications installées accèdent à l'appareil photo, au micro ou à la géolocalisation du téléphone, et sur les adresses auxquelles elles envoient les informations. Et le suivi des utilisateurs par le biais de pixels invisibles contenus dans les courriers électroniques - une pratique marketing répandue, mais controversée - ne sera plus possible avec l'application Mail. Dans le même temps, le portefeuille électronique de l'iPhone et de l'Apple Watch, Apple Wallet, va contenir encore plus de données sensibles. En plus de remplacer les cartes bancaires sans contact et les cartes de transport en commun, voire les clés de voiture (avec les derniers modèles de BMW), Apple Wallet pourra héberger les badges d'accès professionnels, les cartes de chambres d'hôtels… Et, bientôt, les pièces d'identité : dans le courant de l'année, l'iPhone pourra stocker les permis de conduire de certains Etats américains, qui remplacent la carte nationale d'identité, inexistante aux Etats-Unis. Toujours plus d'intégration La conférence des développeurs a également mis en lumière la proximité de plus en plus grande entre les tablettes et les ordinateurs d'Apple. Il sera même possible de passer de l'un à l'autre sans voir la différence : si l'on utilise un Mac et un iPad côte à côte, la même souris et le même clavier permettront de naviguer et de saisir du texte comme s'il s'agissait d'un seul appareil, ou de glisser et déposer un document, grâce à une nouvelle fonction, appelée « Universal Control ». Une prouesse technique qui peut sembler anecdotique, mais qui montre à quel point Apple veut fournir la même expérience sur tous ses appareils, séparément ou ensemble. Dans le même esprit, iOS 12 permettra de projeter du son ou des vidéos directement d'un iPhone vers un ordinateur iMac. Et la plupart des nouveautés présentées lundi seront disponibles, en même temps, dans tous les environnements d'Apple.
Etude MOAÏ: un consommateur de plus en plus pluriel, « consoacteur », …
On le sait, les habitudes de consommation des Français sont en perpétuelle évolution. 80 % déclarent ainsi avoir changé leur mode de consommation au cours des deux dernières années et 70 % pensent encore les modifier à l’avenir. C’est le premier constat de l’étude menée en avril dernier par l'institut d’études MOAÏ*, qui a sondé les consommateurs sur leurs pratiques en matière de consommation, de circuits d’achat, d’attitudes face à la seconde main, la location, l’abonnement… Les Français tiraillés entre contraintes financières et plaisirs En ce début 2021, ces consommateurs hésitent entre contraintes financières et plaisirs : 82 % jugent que les prix ont augmenté et 84 % que leur pouvoir d’achat a diminué… amenant 93 % des Français à être attentifs à leur budget. Et pourtant ils ont - heureusement - envie de dépenser à la sortie de cette pandémie ! 83 % ont réellement un projet de dépenses « plaisir » avec un « revenge shopping » très axé sur les sorties culturelles et les voyages. Et la bonne nouvelle pour le retail qui a tellement souffert est qu’ils ont envie (87%) d’acheter dans les lieux physiques (marchés 58% ou commerces indépendants 50%) tout en appréciant également internet (sites internet 39%). « Quand on regarde de près ses attitudes et ses préférences, on se rend compte de la pluralité du consommateur, lequel est - souvent à la fois, et à des dosages différents : « consoacteur » : il recherche une consommation plus raisonnée ; « consotoyen » : usant de solutions pour consommer différemment et « consovicteur », car voulant donner du sens à sa consommation », explique Pascale Gourlot, directrice du développement de MOAÏ . En tant que consoacteur, il vise une consommation plus raisonnée et manifeste ses intentions dans... - les petits gestes du quotidien, qu’il s’agisse du tri (95 % des Français disent faire du tri sélectif et 85 % se rendre en points de collecte volontaire pour les piles, les ampoules ou le verre) de la vigilance sur leur consommation électrique (91 %) ou de l’affirmation d’une volonté aujourd’hui bien ancrée de réduire le gaspillage alimentaire (94%). Le consoacteur agit donc pour la planète… en préservant ses propres ressources financières. - Entre 2020 et 2021, les Français ont continué, voire accentué leur intérêt à l’égard de la santé et l’alimentation : la pandémie a renforcé cette attention. Les consommateurs de Bio continuent de croitre (+7 points, surtout des occasionnels) et le Nutriscore gagne des utilisateurs : 42% s’y réfèrent … et plus d’un utilisateur sur deux a déjà changé de produit pour un ‘mieux noté’ ! - Cette attention aux produits se retrouve également dans d’autres univers et sur d’autres critères comme la durabilité. Entrent aujourd’hui dans les critères de choix le nouvel indice de réparabilité des appareils électriques et électroniques ou encore les contenants consignés (respectivement deux tiers et 41% des Français les considèrent au moment du choix. Ou la provenance : 85% se renseignent sur la composition de produits alimentaires et 68 % sur la provenance des leurs vêtements ou appareils électriques et, bien entendu « consommer local » reste un leitmotiv pour 84% des Français… même si ce local ne se définit pas identiquement selon le produit. - Au-delà de la proximité, le consoacteur va acheter également différemment par exemple avec un recours au vrac (64%) ou au « direct to consumer » (65%), comportements essentiellement occasionnels aujourd’hui, mais probablement plus présents demain. En tant que consotoyen, il est en train d’adopter des modes de consommation différents - En optant pour des solutions qui vont lui permettre d’allonger la durée d’usage des produits : l’intérêt des Français à l’égard de la seconde main est toujours élevé (deux tiers achètent des produits d’occasion et deux tiers revendent leurs produits, et le déploiement par les enseignes elles-mêmes de cette économie circulaire est validée par plus de 8 Français sur 10). « Mais il ne faut pas s’y tromper, recourir à la seconde main, ce n’est pas uniquement pas altruisme … un tiers de ceux qui ont revendu ont utilisé cet argent pour boucler leur fin de mois », prévient Noëmie Evain, responsable du développement de MOAÏ. - Parmi les modes de consommation alternative on notera en outre toujours un fort intérêt de nos compatriotes pour la location (73%) et un intérêt non négligeable pour l’abonnement (43%). - Le DIY (Do It Yourself) fait une percée remarquée en 2021 (65%) - Enfin pour compléter ce panorama et sortir un peu de la consommation « pure », Pascale Gourlot souligne que de nombreux Français ont donné cette année des objets à des associations (84%) ou recycleries (79%), et qu’ils sont nombreux à approuver des actions visant à soutenir des projets plus responsables autour de l’économie circulaire (3ème main, plateforme de revente caritative type Trëmma) Enfin en tant que consovicteur, le Français affiche une volonté d’être plus réfléchi, dans sa façon de consommer, valorisant les engagements des marques… tout en restant très circonspect. Si les trois quarts de nos concitoyens (74 %) pensent être à l’avenir plus encore attentifs aux valeurs des enseignes et marques auprès desquelles ils achèteront, et 66% favorisent les commerces qui s’engagent dans des actions responsables et de développement durable, ils sont déjà aujourd’hui un quart à prioriser leurs achats auprès de celles qui se déclarent engagées. « La question n’est donc plus « faut-il s’engager ? » mais elle concerne plutôt les territoires sur lesquels nos compatriotes s’attendent à voir les marques prendre parti. « Cette année, les Français souhaitent en premier lieu un engagement sur les prix pratiqués. Engagement dont ils pourront bénéficier directement : un critère qui croit fortement après le vécu de cette période si singulière et prend même la tête des engagements attendus par les Français ! », détaille Pascale Gourlot. Au côté de « pratiquer des prix raisonnables » viennent s'ajouter des dimensions environnementales et sociales : environnement, empreinte carbone mais également condition de travail et emploi local restent des attentes prégnantes. Des consommateurs sur la réserve Mais si aujourd’hui les Français semblent plutôt à l’aise avec des expressions reflétant l’engagement ou les pratiques responsables (comme les mots « éthique », « écoresponsable », « durable », « green », « recyclable » ou « RSE ») ces vocables peuvent susciter l’envie d’en savoir plus ou inspirer confiance à moult Français (60% environ)…. A la seule nuance près que seuls 10% en sont convaincus: affirmer que l’on s’engage ne suffit plus, les marques devront définir et prouver les enjeux de leur engagement. Avertissement aux marques : pour 7 Français sur 10 cette notion d’engagement ne suffit pas, il faut la préciser ! Mieux encore 80 % des consommateurs vérifieront les engagements, et tout particulièrement ceux qui souhaitent sélectionner les marques engagées : parmi eux, ce sont 97 % qui vérifieront la véracité de l’engagement. Les personae 2021 Afin d’offrir une autre clé de lecture, réaliser une nouvelle photographie des comportements « types » des Français, MOAÏ a procédé à une analyse par personae. Au total 6 sont passés au crible avec 6 enjeux différents pour les marques. Coup de projecteur sur les 3 les plus représentatifs - Camille, le converti fragile (27% des Français). Il affiche plutôt un profil « famille » mais n’est pas typé au niveau de son âge ou de sa catégorie socioprofessionnelle. Il représente cette part de Français qui ont remis en question leur comportement « consumériste » depuis la pandémie. Au-delà de ses changements d’habitudes « conso » il a aussi pris le temps de mettre en place des gestes éco-responsables dans son quotidien, il est en revanche loin de se soucier de la notion d’engagement, encore trop floue pour lui. « Je suis en réflexion sur mes habitudes de consommation : j'essaye de changer petit à petit ma manière de consommer car je suis très préoccupé par les questions environnementales. » L’enjeu pour les marques : aider Camille dans son cheminement, il est aujourd’hui sensibilisé, il faut maintenant jouer sur le rationnel en lui apportant des preuves que ses différents changements sont importants, au risque qu’il se laisse happer par le dilemme fin du monde/fin du mois où la fin du mois aurait raison sur tout le reste... - Apolline, consommatrice engagée (13% des Français) 38 ans, mariée et des enfants à charge, un profil plutôt CSP+. La COVID-19 n’aura fait que renforcer ses convictions profondes : la cause environnementale. Elle n’hésite plus à signer des pétitions ou à boycotter des marques qui ne respecteraient pas ses engagements. Evidemment, chaque geste éco-responsable a été peaufiné depuis 2020, elle pratique l’économie circulaire comme jamais ! « Ma consommation quotidienne est basée sur des engagements éco-responsables, durables et éthiques et mes achats auprès des entreprises, des fabricants qui se comportent comme tel. Je lutte farouchement contre le gaspillage et n'hésite pas du tout à condamner publiquement (auprès de mes proches, sur mes divers réseaux ...), les entreprises qui n'ont aucun respect des biens et des personnes et qui jettent sans états d'âme » Comment les marques doivent-elles s’adresser à Apolline ? La notion d’engagement pour elle est essentielle à prendre en compte pour construire le monde de demain. Les marques se doivent de travailler sur leurs engagements, mais aussi sur la manière de les prouver. «Prioriser vos preuves en croisant les attentes d’Apolline avec les engagements de votre marque, notamment sur la façon de traiter vos invendus, sur la façon dont vous accompagnez vos clients à « mieux » consommer, et sur votre stratégie de réduction de votre empreinte carbone. Le soutien d’associations et la responsabilité sociale des entreprises sont 2 critères importants pour cette consommatrice engagée », conseille Noëmie Evain. - Inès ( 11% des Français) L’achat plaisir se fait sur internet pour cette digital native, âgée de 26 ans, de milieu plutôt aisé : site internet, applications mobiles ou réseaux sociaux. Le fruit de ses ventes de produits d’occasion lui sert à racheter de la meilleure qualité ou à financer des projets persos. Elle est curieuse d’en savoir plus sur l’engagement des entreprises, une notion qu’elle trouve intéressante, elle y est sensible… et compte s’y pencher plus sérieusement… « On vit dans une société de consommation, on consomme beaucoup trop. On achète certaines choses parfois inutiles. Depuis un an, je me pose la question si j'ai réellement besoin d’acheter tel ou tel produit. Je me laisse environ 1 mois ou 2 semaines de réflexion concernant l'objet désiré. Néanmoins, cela m'arrive encore d'avoir des achats compulsifs, surtout en vêtements, chaussures. C'est la seule chose où j'ai des difficultés, à me dire non ce n'est pas si utile Il me faudra du temps, pour parvenir à acheter seulement ce dont j'ai besoin. Les publicités, les influenceurs tout pousse à une surconsommation. » En attendant elle a hâte de pouvoir de nouveau voyager et de refaire des sorties culturelles en famille ou avec ses ami(e)s. Comment les marques doivent-elles s’adresser à Inès ? Elle se renseigne sur les ingrédients ou sur la composition de ses produits alimentaires ou cosmétiques, est attentive aux labels ou normes affichés par les marques, aux avis consos. Elle a besoin que les marques la nourrissent sur cette notion d’engagement, l’aident à mieux consommer. D’ailleurs, selon Inès, la notion d’engagement d’une marque passe par 2 critères : le respect de l’environnement (énergie verte, réduction du gaspillage) et la façon dont la marque aide ses clients à mieux consommer. *étude on line sur panel du 9 au 15 avril 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 1007 Français
Les Français ont gagné 500 millions d’euros sur le bitcoin en 2020
L'envolée des cryptomonnaies a fait des heureux dans l'Hexagone, l'an dernier. Les Français ont gagné 600 millions de dollars (500 millions d'euros) sur le bitcoin en 2020, se plaçant au 6e rang mondial à égalité avec les Allemands, selon le palmarès annuel établi par la société Chainalysis. De quoi susciter des vocations ? 3 % des Français ont déjà investi dans les cryptos et 14 % aimeraient le faire, selon un sondage réalisé en février par l'Ifop pour le compte de Cointribune. En tête du palmarès figurent les Etats-Unis où les gains des investisseurs sur le bitcoin se sont élevés à 4,1 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus qu'en Chine (1,1 milliard de dollars). Ils sont suivis par le Japon (900 millions) et le Royaume-Uni (800 millions). Les Canadiens ont gagné 400 millions de dollars et les Belges 200 millions. Les investisseurs des 25 premiers pays ont empoché un total 14 milliards de dollars grâce à la plus célèbre des cryptomonnaies. Compte tenu des difficultés économiques (inflation élevée, plongeon de leur monnaie ) les Turcs ont plébiscité le bitcoin et empoché 300 millions de dollars l'année dernière. Mais cette année le pays a connu une série d'arnaques et de fermetures de plateformes. Popularité du bitcoin La popularité du bitcoin est élevée même dans des petits pays comme le Vietnam ou la République tchèque. Figurant respectivement aux 53e et 54e rangs mondiaux pour leur produit intérieur brut, ils sont bien classés en termes de gains pour leurs investisseurs, avec 300 et 400 millions de dollars. A l'inverse, l'Inde, qui compte plus d'un milliard d'habitants n'est que 18e en termes de gains sur le bitcoin (241 millions de dollars). Cela s'explique notamment par « l'attitude historiquement peu favorable aux cryptos de la part du gouvernement, qui complique l'investissement », constate Chainalysis. Ce palmarès ne tient pas compte des profits réalisés sur les autres cryptos. En termes de performance, le leader du marché, le bitcoin , a été devancé par l'ether, ou de plus petites crypto comme Cardano, Chainlink, Polkadot, ou Stellar, Binance Coin en 2020 .

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.