 Une étude de « The Hustle » évalue à 63 % la proportion de dirigeants d’entreprise qui se sont déjà sentis épuisés après une journée de travail. Cela n’a rien d’étonnant : c’est vers eux que se tourne désormais la société pour répondre à ses attentes.
Une étude de « The Hustle » évalue à 63 % la proportion de dirigeants d’entreprise qui se sont déjà sentis épuisés après une journée de travail. Cela n’a rien d’étonnant : c’est vers eux que se tourne désormais la société pour répondre à ses attentes.
A mesure que l’environnement gagne en incertitude et en complexité, ces dirigeants voient leur rôle de leaders d’opinion et leur exposition médiatique se renforcer ; face à autant de pression, ils ressentent le besoin d’être épaulés. Voilà qui explique la montée en puissance d’un indispensable bras droit : le ou la Chief of Staff (COS), version moderne du classique directeur de cabinet des grands groupes, dont le modèle est calqué sur l’organisation des cabinets ministériels.
Dans le cockpit
Au nombre de 4.700 aux Etats-Unis, les Chiefs of Staff sont 800 en France – principalement dans la tech (35 %), la finance et l’assurance (18 %) et l’industrie (17 %) – nous apprend une étude inédite du cabinet de conseil Roland Berger et de l’Institut Choiseul, obtenue en exclusivité.
Au total, 67,5 % des organisations du CAC 40 et du Next40, 45 % des entreprises du SBF120 et 34 % de celles du Next120 font appel à eux. Tout comme les start-up en croissance , où leur dimension est moins politique et leur pérennité incertaine.
« Il me faut bien une minute et trente secondes pour expliquer ce que je fais », plaisante Stéphanie Cau, Chief of Staff pendant huit ans auprès de Didier Michaud-Daniel, CEO de Bureau Veritas de 2012 à juin prochain. Normal, dépendant de la personnalité et du parcours du CEO, la feuille de route du COS est protéiforme.
« J’étais dans le cockpit : j’ai ainsi accompagné le CEO dans ses projets de grosse transformation d’entreprise, dans ses voyages professionnels comme dans son quotidien. Etre Chief of Staff, c’est exercer un métier d’écoute, d’écoute des doutes du dirigeant, de ses questionnements, de ses allers-retours intellectuels… C’est aussi être amenée à lui donner un avis stratégique, à organiser des comités exécutifs, être très opérationnelle en préparant, par exemple, des slides pour le conseil d’administration », détaille Stéphanie Cau, qui renoue depuis peu avec sa formation d’origine – la communication -, au poste de directrice de la communication et de la RSE du groupe.
Stéphanie Cau fait partie des 10 % de COS qui évoquent « un métier » quand les autres 90 % y voient un tremplin de carrière à très court terme, plutôt une fonction à exercer de 2 à 5 ans.
Une fonction d’une grande intensité
Elsa Mainville, en charge du développement corporate B2B d’Orange, a été Chief of Staff de 2010 à 2013 au sein d’Orange Business Service. « Une fonction d’une grande intensité, en délégation du CEO, avec une vision à 360 degrés sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise », résume-t-elle. « C’est un poste ambigu : vous avez vue sur tout et êtes au courant de tout. Vous avez de l’influence et tout à la fois beaucoup et aucun pouvoir. Vous vous retrouvez sur une ligne de crête entre une grande autonomie et l’obligation de ne pas outrepasser vos prérogatives, car vous n’êtes pas le chef », ajoute-t-elle.
Une opinion que partage Stéphanie Cau : « Etre COS requiert un ego domestiqué . Ne pas être détenteur du pouvoir n’en fait pas un métier moins intéressant. La lumière doit être sur le CEO mais, fonctionnant en matriciel, vous devez être doté d’un certain leadership et d’un fort degré d’influence pour convaincre et engager des gens dans et à l’extérieur de l’entreprise. J’ai pu, par exemple, signaler à mon CEO les talents de femmes du réseau – pas très visibles – qui ont pu ensuite être davantage exposées. »
Rendez-vous ministériels, rencontres avec des collègues scientifiques ou dirigeants de groupes industriels pour des créations de chaires ou des laboratoires de recherche communs, animation d’équipes de direction comme opérationnelles en interne… Telle est, pour bonne partie, la feuille de route de Stéphane Potelle, depuis trois ans Chief of Staff au sein de Télécom Paris. « Exercer ce métier ‘couteau suisse’ est techniquement toujours possible, mais si on veut que ça irrigue toute l’organisation et que ça percole, il faut beaucoup de proximité avec le dirigeant. Une très grande confiance mutuelle doit être au coeur du réacteur », insiste celui qui accompagne Nicolas Glady, le directeur de Télécom Paris, dans la transformation de l’école d’ingénieurs sur ses volets de transition sociale et écologique, de communication et de transition numérique.
Lire l’article complet sur : www.lesechos.fr



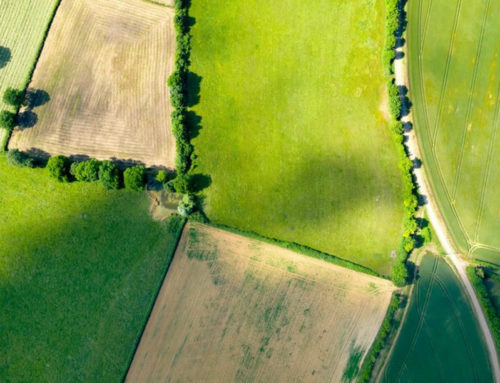
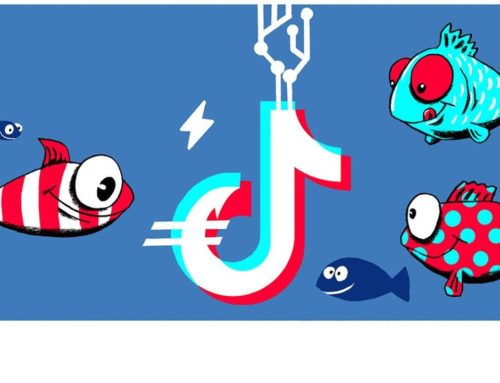


Leave A Comment