 Il est 17 heures, les cours sont finis, la rédaction du Harvard Crimson s’emplit doucement d’étudiants-journalistes. Ils posent leur ordinateur dans la salle commune aux murs cramoisis (« crimson »), la couleur officielle de l’université et de la gazette estudiantine créée en 1873. Le quotidien, qui fut présidé par Franklin Roosevelt et John Kennedy, siège dans une belle maison de ville à Cambridge, au coeur du campus de Harvard, dans le Massachusetts.
Il est 17 heures, les cours sont finis, la rédaction du Harvard Crimson s’emplit doucement d’étudiants-journalistes. Ils posent leur ordinateur dans la salle commune aux murs cramoisis (« crimson »), la couleur officielle de l’université et de la gazette estudiantine créée en 1873. Le quotidien, qui fut présidé par Franklin Roosevelt et John Kennedy, siège dans une belle maison de ville à Cambridge, au coeur du campus de Harvard, dans le Massachusetts.
Sellers Hill, actuel président de la publication, un géant dégingandé qui se destine à la médecine, a conscience de documenter un tournant historique pour Harvard. L’université la plus prestigieuse du monde, la fabrique de l’élite américaine, est au centre de multiples polémiques depuis une dizaine de mois. On lui reproche tout à trac de réprimer la liberté d’expression et la liberté académique, de laisser libre cours à l’antisémitisme, d’être un nid de gauchistes et, surtout, de saccager la méritocratie en faisant primer la défense des minorités raciales et sexuelles sur l’excellence universitaire. Aux yeux des Américains, Harvard est devenue l’incarnation du « woke ».
Il faut remonter à la guerre du Vietnam pour retrouver une telle ébullition sur le campus, avance le jeune homme. Avec quelque chose d’inédit : « L’université n’a jamais connu une telle crise auprès de l’opinion publique, une menace unique pour sa réputation », analyse-t-il. Le Crimson a donc changé d’approche éditoriale. Il s’est mis à guetter ce qui se disait ailleurs sur Harvard, pour démêler le vrai du faux. Tout en prenant de vitesse les médias nationaux sur l’actualité du campus.
Pari réussi pour les jeunes journalistes. « On a eu des millions de lecteurs ces cinq derniers mois, des journées avec dix ou vingt fois plus de visites sur nos pages que d’habitude », sourit Sellers Hill. Le président a aussi été bombardé de courriels désagréables de toutes obédiences, notamment au sujet de la guerre à Gaza.
Une période fascinante aussi pour le directeur de la rédaction, Miles Herszenhorn. L’ex-reporter aux ongles vernis bleu ciel et au sweat-shirt couleur parme s’est rendu au Congrès en décembre pour couvrir l’audition de la présidente de Harvard, Claudine Gay, par un comité parlementaire sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Comme ses consoeurs de Penn University et du MIT, la dirigeante est tombée dans le piège tendu par des députés républicains : elle n’a pas su dire clairement qu’appeler au génocide contrevenait aux règles de l’université. La grande confusion de l’élite « woke », en direct à la télévision.
Pression des donateurs
Le 3 janvier, Miles Herszenhorn a sorti un scoop, repris dans les médias du monde entier : la démission de Claudine Gay, après six mois tumultueux en poste. La présidence la plus courte de l’histoire d’une institution quatre fois centenaire. Ouch ! Le conseil a cessé de soutenir la présidente quand la pression des donateurs et des politiques est devenue trop forte. Les ennemis de Claudine Gay ont passé au peigne fin ses écrits afin d’y trouver des traces de ce qu’ils ont appelé du plagiat.
Dernière révélation dévastatrice du Crimson, en février : le comité qui avait recruté cette professeure de sciences politiques et d’études afro-américaines n’avait pas examiné ses compétences académiques, juste son expertise administrative. Un peu court.
L’affaire Gay a été le point culminant des ennuis de Harvard depuis l’an dernier. Tout a commencé par la défaite judiciaire de juin 2023, lorsque la Cour suprême a mis fin à l’« affirmative action », c’est-à-dire à la discrimination positive en faveur des minorités raciales et sexuelles pour l’admission à Harvard. L’université était poursuivie depuis des années par un activiste conservateur, Edward Blum, qui a juré de rendre les Etats-Unis « aveugles » à la couleur de peau. Le contrepied exact de la doctrine de la Corporation, cette structure administrative opaque qui gouverne l’université.
Puis arrive le 7 octobre 2023, date du massacre par le Hamas de 1.200 Israéliens. Une tragédie qui transforme le campus en chaudron contestataire. Le jour même, plusieurs organisations estudiantines pro-palestiniennes déclarent « considérer le régime israélien comme entièrement responsable de tout ce déploiement de violence » dans une lettre ouverte publiée sur Instagram. Un terrible manque de discernement, en ce jour de carnages et de viols.
Plusieurs signataires se rétracteront ensuite. Mais le mal était fait. Le gestionnaire de hedge fund Bill Ackman, un ancien élève et bienfaiteur qui a plus d’un million d’abonnés sur X, jure que ces étudiants ne trouveront jamais de travail à Wall Street. Une organisation conservatrice fait circuler sur le campus un camion avec la photo et le nom des leaders, désignés « chefs des antisémites à Harvard ». A la suite d’une recrudescence de tensions communautaires sur le campus, une plainte pour antisémitisme est déposée contre Harvard, prélude à une collection de procédures contre les universités d’élite, de Columbia à New York University.
Des anciens élèves juifs de Harvard, indignés, forment une alliance forte de 1.800 alumni. Elle appelle à suspendre les donations jusqu’à ce que l’université montre qu’elle protège ses étudiants juifs. « Ces histoires de diversité et d’inclusion, ça suffit, explique l’un de ces mécènes déçus. Harvard a fait ce qu’il fallait pour remédier à ce fléau de l’esclavage, peut-être pas assez, mais il y a des difficultés ailleurs, y compris pour les juifs. »
Avocat à la retraite, dans une famille où on est harvardien de père en fils, il a donné chaque année à son alma mater, pendant cinquante ans. Il avait même couché l’université sur son testament. Il a transféré ses dons à une association d’entraide juive, Harvard Hillel. Le milliardaire Kenneth Griffin, qui avait accordé 300 millions de dollars et dont le nom est gravé sur la façade de plusieurs bâtiments du campus, a également interrompu ses donations. Une très mauvaise publicité pour l’université et une lourde menace financière.
Ne pas heurter les bien-pensants inclusifs
En cette fin mars, au retour de la pause universitaire du printemps, on a du mal à croire qu’il y a eu ici des manifestations monstres en soutien à Gaza, où les négateurs d’Israël chantaient « du fleuve [Jourdain] jusqu’à la mer [Méditerranée] ». Les drapeaux et les banderoles ont été rangés ; les petites annonces purgées. Une bonne odeur d’humus monte des plates-bandes amoureusement entretenues. Le « yard », cette cité interdite verdoyante où se concentrent les étudiants de la première à la quatrième année, a retrouvé sa tranquillité multiséculaire.
John F. Kennedy en juin 1940, lors de la cérémonie de remise des diplômes. Parmi les « harvardiens » célèbres, on recense aussi les présidents George W. Bush et Barack Obama, les entrepreneurs Bill Gates et Mark Zuckerberg, les acteurs Matt Damon et Natalie Portman. Et, côté français, l’entrepreneuse Apollonia Poilâne.Alamy/Abaca
Tout le monde n’a pas été choqué par les actions protestataires de l’automne. « Ça a vraiment été une période intéressante. J’espère que Harvard est persuadé comme moi que chacun doit pouvoir exprimer ses idées, tant que cela ne fait de mal à personne », commente Raquel, une étudiante noire de troisième année en histoire et en économie. Cette avocate de la liberté d’expression n’ose cependant pas dire si elle se sent libre de s’exprimer à Harvard, car la question lui paraît « trop sensible ».
A Harvard, on ne cesse de s’autocensurer, confirme Joey, un jeune homme en short qui court sur le gazon avec un sac à dos chargé. Déjà diplômé du « college », il poursuit ses études à la fac de droit. C’est un oiseau rare par ici : un conservateur, sur un campus où 77 % des élèves se disent de gauche. « Je dois mesurer en permanence si cela vaut le coup de voler un peu dans les plumes de quelqu’un, ou s’il vaut mieux me taire, raconte-t-il. En cours, quand les autres se moquent du capitalisme, qui n’est pas fiable, bla-bla, si tu prends sa défense, on va te critiquer. » L’étudiant est affilié à la Federalist Society, étiquetée conservatrice, et sait que cela fait jaser, car « il y a une stigmatisation ».
Rien de bien dramatique pour Joey, qui en rit. Mais parfois, la censure exercée par les étudiants se fait menaçante. En 2021, la professeure de biologie Carole Hooven a été prise à partie après avoir expliqué que certes, les identités de genre devaient être respectées, mais qu’il existait bien deux sexes biologiquement distincts, déterminés « par les gamètes que nous produisons ». Un commentaire « transphobique et nocif » a clamé sur les réseaux sociaux un étudiant responsable de la diversité et de l’inclusion dans sa faculté. Ses cours ont été boycottés, elle n’a pas pu recruter d’assistant. Faute de soutien de l’administration, elle a quitté son poste en 2023.
« Elle aurait dû être défendue », juge Eric Maskin, qui enseigne les maths et l’économie à Harvard, et qui a eu pour élève le Français Jean Tirole – les deux sont récipiendaires d’un prix Nobel. Il y a un an, Eric Maskin a participé à la création du Conseil de la liberté académique à Harvard, qui regroupe plus de 170 membres. « Il m’a semblé que la liberté académique était attaquée dans les grandes universités et pas seulement à Harvard, justifie-t-il. Cette montée graduelle des restrictions de ce que l’on peut dire vient de la gauche du spectre politique – la droite crée d’autres problèmes. »
Chaque jour, les membres du Conseil rapportent de nouveaux incidents, via la messagerie interne du groupe, assure Eric Maskin. Ils confient choisir soigneusement leurs mots pour ne pas bousculer des élèves à l’identité fragile et très susceptibles. Ici, on a peur de dire « femme », un terme jugé trop agressif, par opposition à « personne s’identifiant comme femme ». Là, il faudrait dire « personne enceinte » plutôt que « femme enceinte » pour ne pas heurter les bien-pensants inclusifs.
« A un moment, dans les années 2010, il est devenu courant pour les étudiants de dire qu’ils ne se sentaient pas en sécurité quand ils entendaient des choses qui les offensaient », relate la professeure de droit de Harvard Jeannie Suk Gersen, dans un essai paru en janvier dans le New Yorker. Des élèves lui ont d’abord suggéré de retirer de son cours la loi pénale applicable au viol, car cela implique d’étudier également les arguments juridiques pour la défense du violeur – intolérable.
« Après cela, les étudiants m’ont demandé de les dispenser de discuter ou d’être interrogés sur les armes, les gangs, la violence domestique, la peine de mort, les problématiques LGBTQ, la brutalité policière, le kidnapping, le suicide, l’avortement », poursuit-elle. Elle a refusé, « mais des professeurs à travers le pays ont accepté des demandes similaires », se désole cette coprésidente du Conseil sur la liberté académique.
Des institutions submergées par la culpabilité
Puis est arrivé l’assassinat de l’Afro-Américain George Floyd par un policier blanc, en 2020, suivi d’une puissante vague « Black Lives Matter ». Soudain, il a fallu réparer des siècles de torts causés aux minorités, de l’esclavage au patriarcat. En dépit des bonnes intentions initiales, cela a abouti à diviser la société, les opprimés d’un côté, les oppresseurs de l’autre, chacun enfermé dans une identité figée, tout débat empoisonné.
« C’est bien de s’affirmer en tant que noir, ou juif, ou gay, et d’être reconnu comme tel. Mais s’il y a un déséquilibre perçu dans la façon de traiter chaque groupe, vous préparez le terrain pour les conflits », observe Harry Lewis. Ce mathématicien semi-retraité enseigne l’informatique à l’école d’ingénieurs John Paulson. C’est sa cinquantième année à Harvard. Il a notamment formé Bill Gates et Mark Zuckerberg. Aujourd’hui, il compare l’atmosphère sur le campus à « de la poudre inflammable ».
« Nous avons en partie créé cela, nous, les enseignants et l’administration, regrette-t-il. L’accent mis pas seulement sur l’identité, mais aussi sur notre devoir protecteur, a incité les gens à exiger d’être protégés de tout ce qu’ils ne voulaient pas entendre. » Après le meurtre de George Floyd, la culpabilité a en effet submergé les institutions. Elles se sont mises à multiplier les gages de repentance. Par conséquent, les départements « diversité, équité et inclusion » (DEI) ont pris de l’ampleur, pour sensibiliser mais aussi policer les attitudes.
Les universités, voulant se montrer exemplaires, sont descendues dans l’arène politique. « Quand il y a eu les grandes manifestations nationales en 2020, la direction de Harvard a pris des positions assez fortes. Résultat, aujourd’hui, les gens ont le sentiment que la réaction de l’administration aurait été plus déterminée si les victimes du 7 octobre n’avaient pas été des juifs », note Harry Lewis. Autrement dit, une minorité qui n’a pas besoin d’être protégée. « Je pense que la présidence de Harvard devrait cesser de prendre position publiquement sur des sujets qui ne sont pas directement en lien avec notre système éducatif », en conclut l’enseignant. La « neutralité institutionnelle », pratiquée à l’université de Chicago, est d’ailleurs une piste étudiée par le nouveau duo dirigeant, le président temporaire de Harvard, Alan Garber, et son numéro 2 John Manning, qui présente la particularité d’être un conservateur.
L’autre réforme qui va être scrutée de très près, c’est bien sûr la procédure d’admission, post- « affirmative action ». Elle a été mise en conformité et la direction de Harvard a annoncé le 11 avril qu’elle restaurait les tests standardisés à l’admission, pour favoriser la méritocratie et la diversité sociale. La proportion de noirs va-t-elle dramatiquement chuter à l’arrivée de la nouvelle promotion, en mai ? Les Asiatiques vont-ils tout rafler ? L’an dernier, Harvard avait révélé fin mars avoir admis en procédure avancée 15 % d’Afro-Américains, 30 % d’Asio-Américains, 11 % de Latinos et 2 % d’indigènes, des proportions à peu près stables au fil des ans. La publication des statistiques 2024 a opportunément été repoussée à l’été.
Kate (le prénom a été modifié), une étudiante asiatique de troisième année en économie, est persuadée que la discrimination positive va se perpétuer sous d’autres formes : « Les responsables des admissions vont traquer tous les petits détails pour identifier les candidats noirs, par exemple l’endroit où ils vivent », suppose-t-elle. Il y a d’autres privilèges que la race, insinue-t-elle : « Si vos parents sont allés à Harvard et qu’ils sont dans les 1 % les plus riches, vos chances d’entrer à Harvard sont quasiment de 50 %, bravo ! » Dans cette grande université éprise de justice sociale mais égarée en chemin, il y a encore de beaux chantiers à ouvrir.
Lire l’article complet sur : www.lesechos.fr





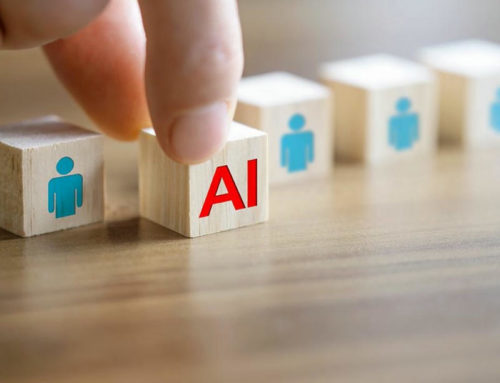

Leave A Comment