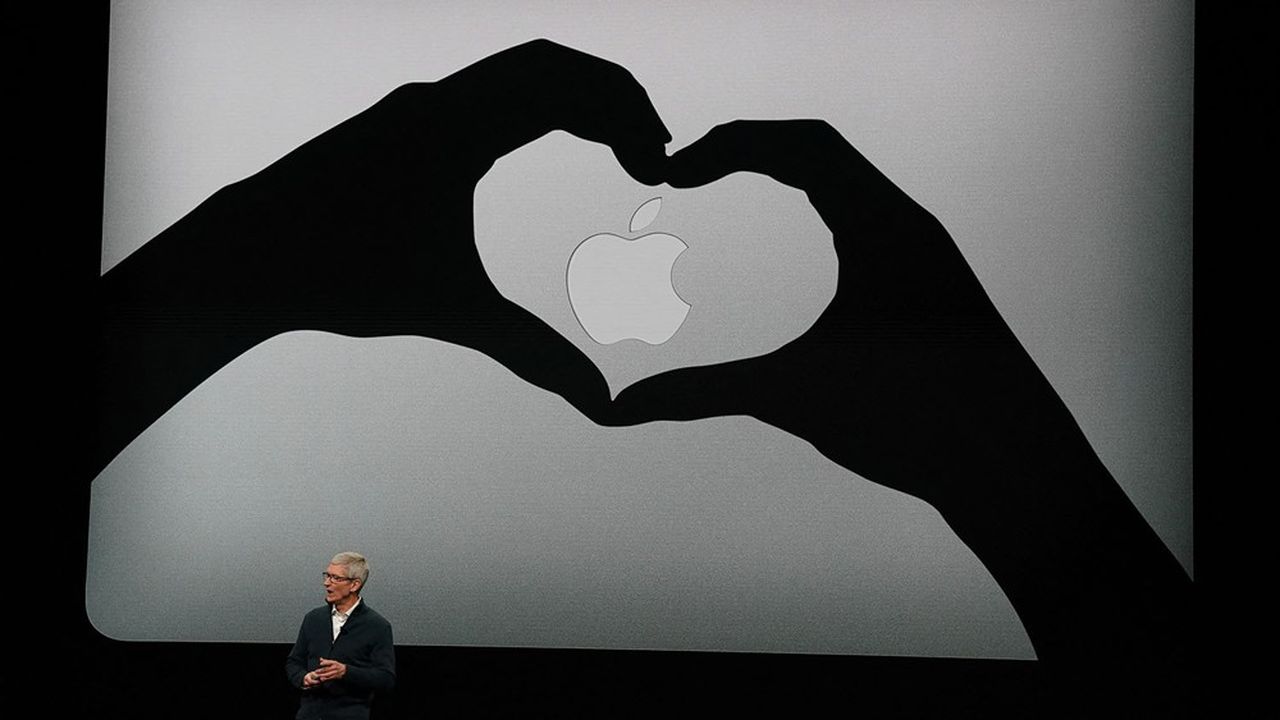A quoi ressemblera le tourisme à horizon 2050 ? –
Le monde à horizon 2050 Avant de rentrer dans le vif du sujet, Frédéric Weill, Directeur d’études pour le centre de prospective Futuribles, est venu donner quelques points de repères concernant le monde à horizon 2050. Climat et écosystèmes : d’ici 2050, le risque d’emballement climatique existe. Jusqu’où peut-on aller dans la déstabilisation ? Va-t-on atteindre un point de bascule irréversible ? Si des actions fortes sont réalisées en matière de sobriété, de décarbonation, à l’échelle individuelle et collective, il pourrait être possible de ralentir ou stopper le dérèglement climatique. Démographies et migrations : La population mondiale devrait progresser de deux milliards à horizon 2050 et les disparités dans le niveau de développement des pays du monde pourraient s’accentuer. D’ici là, la population européenne est amenée à stagner et celles des zones à bas niveau de revenus à augmenter. En revanche, après 2050, la population mondiale pourrait décroître. Géopolitique et mobilités internationales : il est probable que d’ici 2050, nous soyons confrontés à une raréfaction des ressources naturelles, ce qui pourrait accentuer la compétition pour leur maîtrise. Le trafic aérien devrait augmenter de 3% chaque année entre 2021 et 2040. Société : de nouvelles formes d’engagement pourraient voir le jour, en même temps qu’une remise en cause de la légitimité du système politique. Selon Futuribles, on pourrait voir un développement rapide des outils de surveillance de masse. Technologies : d’ici 2050, l’économie de la donnée prendra davantage d’importance. Une explosion des flux qui pourrait entraîner une augmentation de 8% de la consommation énergétique par an. Une tendance à contre-courant des enjeux de sobriété. Un risque d’exclusion pour 15% des Français qui ne maîtrisent pas les outils numériques sera également présent. Le tourisme à horizon 2050 Comment évoluera le tourisme d’ici 30 ans ? Quels seront les attentes, les comportements des voyageurs ? Comment les pros du Tourisme y répondront ? Toutes ces questions ont été posées aux experts invités. Dans le scénario prospectif de Pierre Torrente, les enfants apprennent à être touristes dès l’école primaire. Le tourisme est devenu durable, inclusif, de proximité et proche du monde des loisirs. Ce ne sont pas les habitants qui décident où se rendre en vacances, mais ce sont les destinations qui déterminent quand il est possible de venir. Dans la continuité de l’évolution du monde du travail, les habitant possèdent des jours de vacances illimités à condition d’avoir effectué les tâches qui leur incombent. Dans le scénario de Prosper Wanner, nous assistons à un retour du Grand Tour en 2050, en référence au long voyage en Europe effectué par des jeunes hommes fortunés au 18e siècle. Le rapport au monde, aux autres, a changé pour revenir à des choses plus simples et moins intermédiées. La notion de confort n’est plus centrale et la politique de la colonie de vacances a elle aussi fait son retour. Dans le scénario de Dominique Hummel, le tourisme de campagne s’est développé en 2050, poussé par un besoin de reconnexion à la nature et le réchauffement climatique. Le télétravail a créé de nouvelles formes de mobilité et le slow tourisme représente 7 à 8% du chiffre d’affaires du secteur touristique. Une nouvelle dynamique qui réduit les problème de concentration dans les grandes villes. Dans le scénario de TOM.travel, deux comportements opposés se sont accentués. D’un côté, les touristes cherchent à « faire » le plus de destination et à partager leur plus beaux selfies sur Instagram. De l’autre, des voyageurs veulent sortir de leur quotidien tout en se reconnectant à la nature. Ils privilégient les expériences locales et authentiques. Les jeunes générations, conscientes des enjeux climatiques, oscilleront entre ces deux comportements, quitte à souffrir de dissonance cognitive (action en contradiction avec ses convictions qui provoque un inconfort).
Ouverture à la concurrence du ferroviaire : Qu’en pensent les voyageurs Français ?
Actée par la loi Nouveau Pacte ferroviaire de 2018, la libéralisation du rail en France est devenue une réalité depuis 2021. Renfe, Trenitalia ou bien encore Le Train, les compagnies françaises ou internationales commencent à être nombreuses à vouloir concurrencer l’historique SNCF. Selon une étude, 80% des Français ont déjà entendu parler de cette ouverture à la concurrence, 80% la plébiscitent sur les lignes nationales et 77% sur les lignes régionales. Pour 61% des sondés, cette ouverture est synonyme d’avantages pour le pays et 55% y voient des avantages pour leur région. Baisse des prix et crainte de la disparition du service public Dans un contexte inflationniste, le principal avantage qu’y voient les voyageurs est une baisse des prix, notamment sur la ligne Paris-Lyon (exploitée aujourd’hui par la SNCF et Trenitalia- NDRL). En moyenne, la baisse sur les trajets Paris-Lyon est de l’ordre de 44% par rapport à 2019 et de 30% pour les trajets Paris-Milan. Mais cette ouverture à la concurrence suscite également son lot de craintes et d’interrogations. Selon l’étude, les Français craignent la disparition du service public (38%), la saturation du réseau ferroviaire (33%) ou la suppression des emplois en France (25%). Ils sont aussi 29% à estimer que le manque d’informations sur les acteurs du marché est un inconvénient. A lire aussi : Ch. Michau (Trainline) : « La concurrence, ce sont des prix plus bas, de nouvelles offres et plus de voyageurs » Enfin, côté distribution, 26% des Français déclarent avoir déjà réservé un billet de train sur une autre plateforme que SNCF Connect, dont 15% sur Trainline, 2% sur Trenitalia et 1% pour Booking ou Omio. Reste que si les Français devaient demain réserver un billet pour un voyage dans leur région sur une plateforme autre que SNCF Connect, ils privilégieraient en premier lieu le site de la compagnie ferroviaire nationale (38%), se rendraient en gare (26%) ou consulteraient le site internet de leur région (19%). Ils ne seraient que 13% à avoir recours à un agrégateur d’offres. Pour Trainline, « un important travail de pédagogie reste donc à faire. »
Apple franchit la barre des 3.000 milliards de dollars en Bourse
3.000 milliards de dollars de valorisation boursière ! De quoi donner le vertige… Apple vient de franchir cette barre symbolique, inscrivant un nouveau record (elle avait déjà été passée en janvier 2022, mais très brièvement). L'action a dépassé 192 dollars à l'ouverture de Wall Street ce vendredi. Pour donner un ordre de grandeur dans ces nombreux zéros, la firme à la pomme vaut désormais plus que le PIB de la France… L'action Apple a enregistré une progression phénoménale de 53 % depuis le début de l'année. La société dirigée par Tim Cook tire les fruits de son modèle imparable depuis les années 1980, avec des produits - de l'Apple II à l' « ordinateur spatial » - ayant révolutionné leur segment de marché et désormais agrémentés de services. Une capacité que la sortie de son casque de réalité virtuelle Vision Pro met à nouveau au défi. Cette hausse illustre aussi la montée en puissance des grosses valeurs de la technologie américaine, souvent regroupées dans l'acronyme Gafa. Google (Alphabet) a bondi de plus de 30 % depuis le début de l'année, Amazon de presque 50 % et Meta (la maison mère de Facebook) de quasiment 130 % ! Microsoft a progressé d'environ 40 % et pèse plus de 2.500 milliards, et Nvidia, qui a rejoint récemment le club très fermé des valeurs à plus de 1.000 milliards dollars de capitalisation, a grimpé de quelque 190 % ! 9.000 milliards de dollars Face à elles, l'indice américain S&P 500 n'a pris que 14 % tandis que les start-up ont beaucoup plus de mal à lever des fonds si elles ne sont pas dans l'intelligence artificielle (IA)… Ensemble (avec Microsoft), les Gafam valent presque 9.000 milliards de dollars de capitalisation. Ce sont en très grande partie ces géants du Net qui ont permis à Wall Street d'afficher un bon premier semestre, contre toute attente, étant donné le resserrement monétaire et les craintes de ralentissement. Des envolées spectaculaires qui peuvent être expliquées par plusieurs facteurs. D'abord, la plupart des valeurs de la tech avaient connu une année 2022 chaotique, ce qui explique un rebond. Ensuite, les gros acteurs du secteur sont « considérés comme des valeurs refuge, alors que le marché a des craintes sur la conjoncture, sur les banques… » souligne Jacques-Aurélien Marcireau, coresponsable de la gestion actions d'Edmond de Rothschild Asset Management. Hausse des valorisations Comme l'expliquent les spécialistes du marché, la hausse est avant tout liée à « une expansion des multiples ». Autrement dit, le marché est prêt à payer plus cher pour ces valeurs. Apple vaut par exemple environ 30 fois ses résultats prévus, alors qu'il en valait autour de 20 avant la pandémie de Covid-19, selon les données de Carmignac. Car pour la plupart de ces valeurs, les derniers résultats « n'ont pas été extraordinaires, à l'exception de ceux de Meta », reprend le gérant. « Les valeurs technologiques ont toutefois fait beaucoup d'efforts pour miser sur leur profitabilité », nuance David Older, responsable de la gestion actions de Carmignac.
Apple à 3.000 milliards ou l’emprise démesurée de la tech sur les Bourses mondiales
Retour aux années 1990 : Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson sont les valeurs phares du New York Stock Exchange. Dans un parfait équilibre, avec chacun 13 % de poids dans le S&P 500, ce secteur chéri des consommateurs américains rivalise avec l'industrie - General Electric et General Motors en tête - et le pétrole dont Exxon, Chevron, BP et Mobil se partagent le marché. Bien qu'IBM soit la première capitalisation du S&P 500 (avec 64 milliards de dollars, loin des excès actuels), la technologie n'arrive alors qu'en avant-dernière position des dix sous-secteurs de l'indice. LIRE AUSSI : Apple franchit la barre des 3.000 milliards de dollars en Bourse DECRYPTAGE - Apple à 3.000 milliards : la consécration d'un modèle économique imparable Une photographie qui tranche avec l'hétérogénéité des composantes du S&P 500 aujourd'hui. Les technologies représentent plus de 28 % de sa pondération, suivies, loin derrière, de la santé, du secteur financier et de la consommation discrétionnaire (luxe, loisirs, automobile, etc.). Tendance mondiale Même tendance au niveau mondial, où les entreprises de la tech sont passées de 6 % du MSCI World au milieu des années 1990 à 22 % aujourd'hui. « Mais en réalité, il s'agit de plus de 31 % de la capitalisation mondiale, car les entreprises technologiques sont peu à peu intégrées aux secteurs dont elles se rapprochent le plus », explique David Rainville, gérant chez Sycomore AM. Ainsi, Alphabet (Google), Tencent ou Netflix sont rangés dans les services de communication, tandis qu'Amazon, Tesla ou Alibaba se retrouvent classés dans la consommation. Déjà, à la fin des années 1990, les sociétés de la tech avaient été portées aux nues par les excès de la bulle Internet. Cette ascension fulgurante les avait propulsées au premier rang des secteurs les plus lourds du MSCI et du S&P 500 (respectivement 21 % et 29 %). LIRE AUSSI : Nvidia : l'avènement du nouveau bijou de la tech en sept dates clés L'IA, puissant mais unique moteur de Wall Street Après l'éclatement de la bulle, les valeurs financières se sont rapidement imposées, grâce aux profits juteux des banques d'affaires et à la vigueur du marché immobilier américain. Pas pour longtemps. La crise des subprimes a balayé ces deux vecteurs de croissance, avec l'effondrement de l'immobilier et les mesures de régulation du système bancaire. Ascension des SMACS C'est aussi à cette période qu'ont émergé les SMACS, acronyme barbare désignant à la fois la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, l'analyse de données - ancêtre de l' intelligence artificielle - et l'informatique à distance. Une source de profits inespérée pour les groupes de technologie que certains dinosaures, comme IBM, n'ont pas su saisir à temps. En revanche, les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont peu à peu pris le relais pour peser près d'un quart du S&P 500 dès 2020. « Désormais, c'est l'appétit pour les technologies qui dicte les tendances régionales », note Emmanuel Cau, chez Barclays. C'est ce qui explique l'ascension des Bourses américaines et asiatiques depuis le début de l'année, tandis que le Footsie londonien, dépourvu de ce type de valeurs, en est réduit à faire du sur-place.
Vedettes de Paris : “Notre 1er bateau électrique circulera en juillet 2023”
A l’occasion des Trophées Horizons, organisés par Acteurs du Tourisme Durable, nous avons interrogé Marie Bozzoni Egret, DG de Vedettes de Paris, afin de revenir sur le projet lauréat dans la catégorie « Maîtrise de l’énergie ». L’objectif de la compagnie de croisière fluviale est d’électrifier 4 bateaux électriques d’ici 2024.
La France n’est pas encore prête à faire face au réchauffement climatique
Les trois quarts du pays accablés par une sécheresse exceptionnelle des sols, des rendements agricoles qui plongent de 10 % à 30 %, une production d'hydroélectricité inférieure de 20 %, une facture « catastrophes naturelles » de près de 3 milliards d'euros pour les assureurs, 72.000 hectares partis en fumée, plus de 2.800 décès supplémentaires… Dans son cinquième rapport annuel publié ce mercredi soir, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a choisi d'égrener les ravages de l'été dernier dès les toutes premières pages. Car s'il fut hors norme, l'été 2022 risque fort de devenir un été banal en 2040 , prévient l'instance installée par Emmanuel Macron en 2018 pour scruter la stratégie du gouvernement en matière de climat. Or, la France, pourtant plus exposée aux conséquences du réchauffement que la moyenne, « n'est pas prête à y faire face, comme 2022 l'a démontré », a alerté la présidente du HCC, Corinne Le Quéré lors de la présentation de ce document de 200 pages qui comporte plus d'une centaine de recommandations, remis à l'exécutif quelques jours avant des annonces très attendues sur les grandes lignes de la planification écologique . Changer d'échelle Malgré un engagement exceptionnel de moyens, « les dispositifs de prévention et de gestion de crise n'ont pas permis d'éviter toutes les conséquences des événements » de l'année dernière, souligne la climatologue. Cette année « emblématique de l'intensification des effets du changement climatique » illustre de manière flagrante le besoin « d'acter l'urgence », exhorte le HCC. LIRE AUSSI : Climat : la France doit se préparer à l'éventualité d'un violent réchauffement INTERVIEW - « Les températures extrêmes actuelles sont toutes liées au changement climatique » Mais aujourd'hui, « l'adaptation se fait largement dans un mode réactif, ce qui ne suffit pas à prévenir les impacts futurs », pointe Corinne Le Quéré, qui met en garde : « il est probable que l'équilibre du système d'assurance en France, dans sa configuration actuelle, ne soit pas pérenne compte tenu de l'accroissement de la sinistralité au fil des décennies ». L'adaptation doit « changer d'échelle », dit-elle, et devenir « transformatrice » en s'appuyant sur les connaissances scientifiques des impacts pour les années à venir. Le cadre de référence annoncé par le gouvernement de s'adapter selon une trajectoire à +4 °C est un bon premier pas, estime le HCC. Baisse des gaz à effet de serre Dans ce contexte, la baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre est « plus que jamais essentielle » pour contenir l'intensification des risques, selon le HCC. En 2022, les émissions ont encore reculé de 2,7 % par rapport à 2021 (en excluant les puits de carbone). Les efforts sont là, mais le rythme reste insuffisant : pour atteindre les objectifs fixés pour 2030, il doit « presque doubler », alerte le Haut Conseil pour le climat. Pour l'heure, seul le secteur du bâtiment voit ses gaz à effet de serre diminuer suffisamment (-17 % en 2022). Selon le scénario du partage de l'effort entre secteurs qui sera déterminé par le gouvernement, le HCC estime que le rythme de baisse des émissions devra être multiplié par un facteur 3,5 à 5 pour les transports et l'énergie, 1,25 à 3,5 pour l'agriculture, 1,4 à 1,6 pour l'industrie et 1,6 à 1,9 pour les déchets.
Ces nouveaux métiers de plus en plus recherchés dans la French Tech
L'écosystème des start-up participe à la création et la mise en avant de nouvelles compétences. Avec un vocabulaire singulier et parfois complexe, de nouveaux métiers émergent dans le milieu, quand d'autres viennent du monde plus traditionnel, comme le directeur des affaires publiques. Un poste qui figure parmi les cinq métiers les plus recherchés dans la French Tech dans les prochaines années, d'après une étude de France Digitale avec Actual Group. Portrait de trois d'entre eux. 1- X-Ops Les « ops » garantissent que chaque individu puisse se concentrer pleinement sur son domaine d'expertise sans devoir s'occuper des tâches des autres. « A l'origine, ce métier est né et a grandi dans le milieu du développement, en étant axé sur l'optimisation de la livraison de code avec les devOps » explique Cécile Plessis, la dirigeante et fondatrice de HR4Team, une start-up qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs enjeux de ressources humaines. Mais ce métier a désormais pris une nouvelle dimension et englobe tous les aspects de l'efficacité organisationnelle. On les appelle « MLOps », « DataOps », « FinOps »… « On en voit également de plus en plus apparaître dans les ventes pour que les commerciaux se concentrent mieux sur leur métier. Dans les ressources humaines, le 'people ops', va par exemple gérer l'ensemble de la partie administrative pour que les équipes se concentrent sur leurs compétences », ajoute Cécile Plessis. Les X-Ops doivent disposer d'une vision globale de l'ensemble des activités de l'entreprise. Leur objectif principal ? Transformer une start-up en scale-up prospère. 2- Comptable carbone et diversité Avec l'obligation faite aux sociétés de plus de 500 salariés de réaliser un bilan carbone (et de 250 salariés d'ici à 2024), les questions énergétiques et environnementales sont plus que jamais sur la table des start-up. Dans les démarches de RSE, la prise en compte de la diversité et de l'inclusion est également devenue incontournable. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE Comment les start-up se ruent sur le marché des bilans carbone des entreprises Ces nouvelles start-up qui verticalisent la mesure carbone « L'accélération vient en partie des demandes de reporting des fonds de capital-risque dans le cadre de leurs propres obligations liées à SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), mais aussi et surtout, à l'anticipation de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), cette directive européenne qui va venir bouleverser les relations commerciales entre start-up et grands groupes », explique France Digitale. Pour collecter et analyser toutes ces données extra-financières, les start-up doivent se doter de nouveaux métiers, comme les comptables carbone et diversité. Car pour France Digitale, « les traditionnels experts-comptables » ne sont pas formés pour ça. « Il y a urgence à faire émerger de nouveaux experts avec une forte connaissance financière et opérationnelle pour devenir les nouveaux alliés du comex, et tout particulièrement des directeurs financiers », estime l'association. 3- Chief free-lance officer 73 % des salariés du digital en contrat à durée indéterminée (CDI) envisagent de changer de poste d'ici deux à trois ans et, parmi ceux qui ont déjà franchi le pas, 7 free-lances sur 10 souhaitent le rester, selon une étude réalisée par le cabinet BCG pour Malt, la plateforme de mise en relation entre indépendants et entreprises. Pour Vincent Huguet, le fondateur de Malt, cette mutation du rapport au travail a permis à de nombreuses petites structures d'accéder à des compétences extrêmement recherchées sans avoir à s'engager outre mesure, met en avant l'étude. Dans les start-up en croissance, on observe une hausse des prestations ponctuelles dans l'infographie, le développement, le community management… « Il y a une vraie diversification des profils et du modèle contractuel, entre les salariés, les free-lances et les prestataires » ajoute-t-elle. « Actuellement, ce sont les DRH qui chapeautent l'ensemble, car il est important de les traiter exactement de la même manière pour maintenir une culture unique d'entreprise », souligne la dirigeante. D'après France Digitale, le chief free-lance officer peut avoir la responsabilité de l'intégralité du processus ou travailler avec le service des ressources humaines pour la rédaction de l'offre, le sourcing, le tri des candidatures et la sélection. Un rôle qui doit permettre à l'entreprise d'optimiser la flexibilité de sa masse salariale.
Automobile : le long et dur chemin vers la rentabilité des voitures électriques
La route vers l'électrification de l'industrie automobile est droite, mais la pente est forte. En treize ans, la part de l'électrique dans les ventes de voitures neuves doit passer de 12 % à 100 % en 2035. A cette date, la vente de voitures thermiques sera interdite sur le Vieux Continent . Le défi des constructeurs sera de trouver, ce faisant, le chemin de la profitabilité pour cette nouvelle motorisation, ressort-il d'une étude présentée mardi par AlixPartners. Passer du moteur thermique à la « voiture à batterie » nécessite en effet de très lourds investissements, que les volumes de ventes ne pourront pas amortir dans un premier temps. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Aston Martin espère s'inventer un brillant avenir dans l'ultra-luxe et l'électrique Automobile : Lordstown, ancienne coqueluche de Wall Street, fait faillite Renault mise plus que jamais sur Ampere, sa future filiale électrique Les investissements annoncés ont doublé ces deux dernières années, relèvent les consultants d'AlixPartners. Ils atteignent 616 milliards de dollars sur la période 2023-2027, contre 330 milliards entre 2021 et 2025. « La plus grande partie de cette somme est allouée à la construction d'usines de batteries », précise Alexandre Marian, directeur associé chez AlixPartners. Effets d'échelle hors de portée à court terme Les volumes de ventes ne seront pas au rendez-vous pour rentabiliser à moyen terme cette mise de fonds initiale. « Les effets d'échelle demeureront hors de portée de la plupart des constructeurs ces prochaines années, le nombre de voitures fabriquées par type de plateforme restant en deçà de ce qu'ils connaissent dans le thermique jusqu'en 2030 », explique Laurent Petizon, également directeur associé chez AlixPartners. LIRE AUSSI : DECRYPTAGE - Fin du thermique : ces constructeurs automobiles qui avancent plus vite que l'Europe EN CHIFFRES - La croissance des ventes de voitures électriques va faire diminuer la demande mondiale de pétrole En 2023, les groupes automobiles écouleront en moyenne 109.000 unités pour une plateforme électrique , contre 227.000 pour une plateforme thermique. Cet écart ne se comblera, progressivement, qu'à la fin de la décennie. Aucun constructeur généraliste ne publie pour l'instant sa rentabilité par type de motorisation, sauf un. Ford a dévoilé au printemps qu'il tablait sur une perte de 3 milliards de dollars en 2023 sur son activité électrique, baptisée « Ford Model e ». De manière générale, préviennent les analystes de Moody's Investor Services dans une étude récente, « la rentabilité des voitures électriques restera pendant des années en deçà de leurs cousines thermiques, jusqu'à ce que leurs volumes de production décollent ».
TGV vs vols court-courriers : la France pourrait économiser près de 200 000 tonnes de CO2 par an
Un mois après la publication du décret entérinant la suppression des lignes aériennes en cas d’alternative en train de moins de 2h30, qui concerne trois liaisons en France, Mabrian Technologies a voulu imaginer un déploiement plus large de cette mesure. « Nous ne souhaitons pas alimenter la controverse, mais aller au-delà de cette information. Cela permet d’éveiller les consciences et de montrer que la France peut se doter de moyens pour aller encore plus loin », explique Christophe Ramaciotti, Responsable développement France de Mabrian Technologies. Dans son étude, l’entreprise affirme que la France pourrait économiser jusqu’à 194 000 tonnes de CO2 par an en remplaçant l’avion par le train à grande vitesse pour des trajets inférieurs à 500 km. Une restriction qui pourrait concerner 3,7 millions de passagers par an sur 78 liaisons. Cinq liaisons aériennes sont particulièrement concernées dans cette hypothèse car à elles seules, elles représentent 60% des émissions de CO2 : Paris CDG – Lyon, Paris CDG – Nantes, Lyon – Bordeaux, Lyon -Toulouse et Bordeaux – Marseille. Pour effectuer ce calcul, Mabrian Technologies se base sur son propre outil de calcul des émissions de CO2 dans l’aérien (basé sur le type d’appareil utilisé et le taux d’occupation moyen) et sur les données de son partenaire Ecopassenger.org pour la partie ferroviaire. Plusieurs sources qui lui permettent d’évaluer que le CO2 total émis par les avions pour les trajets courts en France (500 km ou moins) est de 216 000 tonnes par an. Le train à grande vitesse émettrait, lui, 22 000 tonnes par an pour les mêmes trajets. Une culture du train à développer L’étude rappelle que la différence d’émissions de CO2 entre l’avion et le train est particulièrement élevée en France en raison du pourcentage élevé d’électricité verte consommée par le train. Cette exception française est un avantage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre selon Mabrian Technologies. Autre particularité, la culture du train assez ancrée chez les Français. « Je pense que les Français sont plus enclins à favoriser le train que leurs homologues européens. Nous sommes les pionniers du TGV et convertir ces liaisons demanderait moins d’effort », observe Christophe Ramaciotti. Pour lui, le développement de l’offre des trains de nuit montre une volonté des passagers de reconsidérer le voyage. Un défi majeur pour l’Hexagone L’entreprise identifie néanmoins plusieurs freins à l’extension de cette mesure. Tout d’abord, l’infrastructure ferroviaire actuelle en France ne serait pas en mesure de couvrir toutes les liaisons concernées avec des TGV. Cela demande du temps et de l’argent. Si de nouvelles lignes ferroviaires voyaient le jour, les émissions produites lors de leur construction pourraient mettre des années à être compensées, ce qui ajoute une couche de complexité à l’évaluation de l’impact sur l’environnement de la mesure. Mais pour Mabrian Technologies, « il s’agit sans aucun doute d’un défi majeur pour l’Hexagone ». L’extension de cette restriction pourrait aider à faire de la France la première destination touristique durable au monde d’ici 2030, comme le souhaite le gouvernement.

 GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
GDPR : L’hospitalité des marques fait loi en Europe.
 Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM.
Selon une étude récente de la Commission Européenne(3), 72% des Européens s’inquiètent en effet de laisser trop de données personnelles aux entreprises, souvent à leur insu, et surtout de ne pas en recevoir de réelle contrepartie. D’ailleurs, la connaissance plus précise du client semble ne faciliter en rien la capacité de l’entreprise à mieux cibler ses offres : selon tous les indicateurs(4), le taux d’ouverture des mails diminue alors que les désabonnements (opt-out) augmentent, ce qui fragilise largement la rentabilité des investissements lourds consentis dans le CRM. Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche.
Accueillir un consommateur “libre” est sans doute une perspective qui effraie bon nombre de marques, tant elle ont été construites sur la notion d’un marketing manipulateur et insidieux, capable d’influencer jusqu’aux émotions pour enfermer les clients dans un tunnel de vente dont la seule issue est l’achat du produit. Avec la GDPR, ce n’est plus le produit qu’il va falloir vendre, c’est la marque qui doit apprendre à se faire acheter. Et pour cela, il va falloir qu’elle se montre hospitalière vis à vis de ses clients : bienveillante, humaine et proche. Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.
Ce serait peine perdue pour les marques que de se contenter de « mettre en conformité » leur bases de données tout en espérant garder les mêmes pratiques relationnelles. Car la GDPR est d’abord une invitation à renverser ses pratiques relationnelles pour faire montre d’hospitalité vis à vis de ses clients ; et c’est ce renversement d’attitude qui est lui même porteur de croissance pour les marques. Avec la GDPR, l’hospitalité ouvre pour les marques de nouvelles perspectives de croissance.